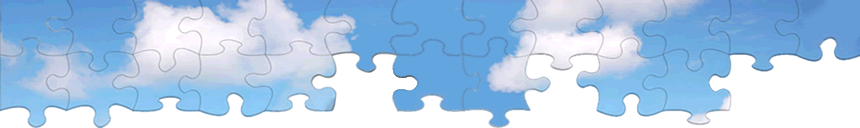


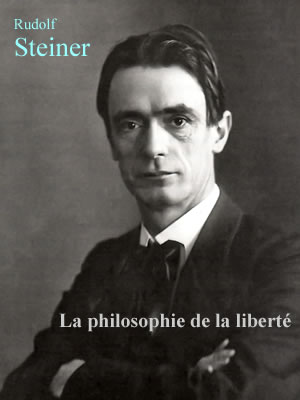
Auteur: Rudolf Steiner (1894)
Edition : BnF (domaine public libre)
Principes d'une conception moderne du monde (r├®sultats de l'exp├®rience int├®rieure conduite selon les m├®thodes de la science naturelle) traduit de l'allemand par Germaine Claretie.
Table des mati├©res
LA SCIENCE DE LA LIBERTE:
1. L'action humaine consciente
2. Le besoin organique de la connaissance
3. La pens├®e instrument de la conception du monde
4. Le monde comme perception
5. La connaissance du monde
6. LŌĆÖindividualit├® humaine
7. Y a-t-il des limites ├Ā la connaissance ?
LA R├ēALIT├ē DE LA LIBERT├ē:
8. Les facteurs de la vie
9. LŌĆÖid├®e de la libert├®
10. La philosophie de la libert├® et le monisme
11. La finalit├® dans lŌĆÖunivers et dans lŌĆÖhomme
12. LŌĆÖimagination morale
13. La valeur de la vie
14. LŌĆÖindividualit├® et lŌĆÖesp├©ce
DERNIERS PROBLEMES:
15. Les cons├®quences du monisme
Note de l'├®diteur
Rudolf Steiner (1861-1925) est un penseur social, fondateur de l'anthroposophie (1913) qu'il qualifie de ┬½chemin de connaissance┬╗ ou ┬½science de l'esprit┬╗, une tentative d'├®tudier les ph├®nom├©nes spirituels (intuition, sentiment, art...) avec la m├¬me pr├®cision et clart├® avec lesquelles la science ├®tudie le monde physique. Les premiers travaux philosophiques de Rudolf Steiner, dont "La Philosophie de la libert├®" sont consacr├®s ├Ā l'├®laboration de son concept dont l'homme doit pouvoir tirer en toute autonomie le motif de ses actions et agir alors librement. L'anthroposophie se fonde sur l'affirmation d'un d├®passement possible de la vision mat├®rialiste de la nature et du monde en y ajoutant les niveaux suprasensibles de l'existence (esprit, ├óme...).
Selon Rudolf Steiner l'interpr├®tation correcte du mot ┬½anthroposophie┬╗ n'est pas ┬½sagesse de l'homme┬╗, mais ┬½conscience de son humanit├®┬╗, c'est-├Ā-dire ├®duquer sa volont├®, cultiver la connaissance, vivre le destin de son temps afin de donner ├Ā son ├óme une orientation de conscience. L'anthroposophie cherche ├Ā d├®velopper en l'homme les forces n├®cessaires pour appr├®hender ce qui existerait au-del├Ā des sens. Pour Kant, l'homme ne peut pas conna├«tre ce qui est au-del├Ā des perceptions sensorielles. Pour l'anthroposophie, l'homme peut d├®velopper en lui les facult├®s qui lui permettent de d├®passer cette limite. Sur ce chemin, la connaissance de soi et le d├®veloppement des forces morales sont pr├®sent├®s comme indispensables. En se basant sur les r├®sultats de l'investigation spirituelle, l'anthroposophie propose dans tous les domaines de l'existence, des applications pratiques qui se veulent en harmonie avec la nature profonde de l'homme : ├®ducation, m├®decine, th├®rapies artistiques, pharmacie, agriculture, ├®conomie,
vie sociale, arts, etc.
Rudolf Steiner inspira par la suite la cr├®ation de plus de 1000 ├®coles dans le monde (dont 22 en France - voir http://steiner-waldorf.org) sur la base d'une ┬½p├®dagogie fond├®e sur lŌĆÖid├®e de la libert├® de lŌĆÖhomme, convaincue que la confiance et lŌĆÖenthousiasme plut├┤t que la crainte et la comp├®tition dotent les enfants de forces qui leur sont pr├®cieuses pour avancer dans un monde incertain et r├®aliser leurs projets dŌĆÖexistence.┬╗
Pr├®face de la nouvelle ├®dition (1918)
Les sujets qui ont ├®t├® trait├®s dans ce livre se ram├©nent ├Ā deux questions primordiales concernant la vie de l'├óme humaine.
La premi├©re est celle-ci Est-il possible de se former de l'├¬tre humain une conception qui permette de fonder sur lui, comme sur un point d'appui in├®branlable, les donn├®es diverses de l'exp├®rience et de la science ? En effet, ces donn├®es nous donnent l'impression de ne point pouvoir se fonder sur elles-m├¬mes le doute et le jugement critique les rel├©guent dans le domaine de l'incertitude. Quant ├Ā la seconde question, nous la formulerons ainsi L'homme, en sa qualit├® d'├¬tre volontaire, a-t-il le droit de s'attribuer la libert├®, ou bien cette libert├® n'est-elle qu'une pure illusion, due ├Ā ce que l'homme ignore les liens par lesquels la n├®cessit├® encha├«ne sa volont├® comme elle encha├«ne tous les ph├®nom├©nes naturels ? Cette derni├©re question n'a pas ├®t├® pos├®e ├Ā la suite d'op├®rations logiques artificielles. Dans certaines conditions de la vie int├®rieure, elle se pr├®sente tout naturellement ├Ā l'esprit humain; et l'on a le sentiment qu'il manquerait quelque chose au d├®veloppement complet de l'├óme s'il ne lui arrivait point une fois, au cours de sa vie, d'envisager avec le plus grand s├®rieux le dilemme que nous venons de poser libert├® ou d├®termination de la volont├® humaine.
Il sera montr├® dans cet ouvrage que les exp├®riences int├®rieures qui sont li├®es, pour l'├¬tre humain, ├Ā la seconde de ces questions, diff├©rent selon la r├®ponse qu'il a pu donner ├Ā la premi├©re. Nous tenterons de prouver qu'il existe une conception de la nature humaine selon laquelle on peut fonder sur cette nature, avec s├╗ret├®, tout le reste de nos connaissances et nous tenterons ensuite d'indiquer que cette conception-l├Ā permet de justifier enti├©rement l'id├®e de la libert├® du vouloir humain, ├Ā condition seulement que l'on trouve l'acc├©s du domaine de l'├óme o├╣ cette libre volont├® peut r├®ellement s'├®panouir.
La conception dont nous parlons, qui permet de r├®pondre aux deux questions pos├®es, se transforme dans l'├óme qui l'acquiert en v├®ritable force vivante. Elle ne fournit pas une r├®ponse th├®orique que l'intelligence puisse simplement admettre, et la m├®moire conserver. Une r├®ponse de cette sorte ne serait, du point de vue de ce livre, qu'une apparence de r├®ponse. Aussi n'a-t-on point ├®mis ici des conclusions achev├®es et d├®finitives mais on a montr├® le chemin exp├®rimental d'un domaine int├®rieur o├╣ l'activit├® de l'├óme humaine peut, ├Ā chaque fois qu'il en est besoin, trouver elle-m├¬me la solution renouvel├®e et revivifi├®e de ces probl├©mes. En effet, il suffit que nous ayons eu l'acc├©s du domaine int├®rieur o├╣ ces deux questions se posent, pour que la v├®ritable connaissance de ce domaine nous procure tous les ├®l├®ments n├®cessaires ├Ā leur solution, et nous permette ensuite d'explorer l'ampleur et la profondeur des myst├©res de la vie, dans la mesure o├╣ notre d├®sir et notre destin├®e nous invitent ├Ā le faire.
Il semble donc que l'on a d├®fini, en cet ouvrage, une connaissance qui, par sa nature propre, et par l'├®troite parent├® la reliant ├Ā toute la vie de l'├óme humaine, porte en elle-m├¬me sa l├®gitimation et sa valeur. C'est ainsi que je concevais le contenu de ce livre alors que je l'├®crivis, il y a vingt-cinq ans. Et je ne puis aujourd'hui que r├®p├®ter, en ce qui le concerne, les m├¬mes phrases. Au temps o├╣ je l'├®crivis, je me fis une r├©gle de ne rien dire qui ne f├╗t en rapport ├®troit avec les deux questions fondamentales dont il traite. S'il est quelqu'un pour s'├®tonner de ce qu'on ne trouve encore, en ce livre, aucune allusion au domaine d'exp├®rience spirituelle dont j'ai parl├® dans mes ouvrages suivants, je le prierai de consid├®rer que je ne voulais pas encore, en ce temps-l├Ā, d├®crire les r├®sultats de l'exp├®rience spirituelle, mais seulement ├®tablir les fondements sur lesquels cette exp├®rience peut s'├®difier. Cette ┬½Philosophie de la Libert├®┬╗ ne renferme aucun r├®sultat sp├®cial ni de l'exp├®rience spirituelle, ni de l'exp├®rience naturelle mais ce qu'elle renferme est, ├Ā mon avis, la premi├©re condition de la certitude que l'on tient ├Ā ├®tablir en ces deux ordres de science. Les expos├®s de ce livre peuvent parfaitement ├¬tre admis par ceux qui, pour des raisons dont ils sont les seuls juges, ne veulent rien accepter du r├®sultat de mes investigations spirituelles. Mais pour ceux qui se sentent attir├®s, au contraire, par ces investigations spirituelles, la tentative faite en cet ouvrage pourra ├®galement para├«tre d'une grande importance on a essay├® d'y d├®montrer qu'un examen libre et sinc├©re, s'appliquant uniquement aux deux questions que nous avons signal├®es ici comme ├®tant la base de toute connaissance, fournit la certitude que la vie de l'homme plonge dans un v├®ritable monde spirituel. Ce livre tente de l├®gitimer la connaissance du domaine spirituel avant que l'on ait l'acc├©s de ce domaine. Et cette l├®gitimation a ├®t├® faite de telle mani├©re qu'on n'ait ├Ā aucun moment, en lisant ce livre, le besoin de justifier ce qui s'y trouve en y raccordant les exp├®riences dont j'ai donn├® communication plus tard pour admettre ce qui est dit ici, il suffit que l'on puisse, ou que l'on veuille bien entrer dans la m├®thode m├¬me selon laquelle ces consid├®rations ont ├®t├® con├¦ues. Ce livre me para├«t donc, d'un c├┤t├®, occuper une place tout ├Ā fait ├Ā part de mes ├®crits de science spirituelle d'un autre c├┤t├®, il leur est ├®troitement li├®. Toutes ces raisons m'ont amen├® ├Ā publier maintenant, apr├©s vingt..cinq ann├®es, cette nouvelle ├®dition dont le texte ne diff├©re presque pas de la premi├©re. J'ai seulement ajout├® des appendices ├Ā certains de mes chapitres. Car la compr├®hension erron├®e de ce que j'avais ├®crit m'avait averti de la n├®cessit├® de ces explications suppl├®mentaires. Je n'ai chang├® mon texte que lorsqu'il m'a sembl├® aujourd'hui, avoir exprim├® maladroitement ce que je voulais dire il y a un quart de si├©cle (il faudrait ├¬tre bien mal intentionn├® pour d├®duire de ces corrections que j'aie alt├®r├® en quoi que ce soit mes convictions premi├©res).
Cet ouvrage est ├®puis├® depuis de nombreuses ann├®es. Quoique, comme il ressort de ce que je viens de dire, il me paraisse extr├¬mement utile d'exprimer aujourd'hui encore ce que j'ai dit il y a vingt..cinq ans de ces questions fondamentales, J'ai longtemps h├®sit├® ├Ā livrer au public cette nouvelle ├®dition. Je me demandais constamment si je ne devais pas, dans tel ou tel passage, discuter les innombrables conceptions philosophiques qui sont apparues depuis la premi├©re ├®dition de mon livre.
Mais, accapar├® par mes recherches purement spirituelles, j'ai ├®t├® emp├¬ch├® de le faire comme je l'aurais souhait├®. D'ailleurs je me suis convaincu, par un examen aussi s├®rieux que possible des travaux philosophiques contemporains, que, si s├®duisante qu'e├╗t ├®t├® expos├®, d'un point de vue analogue ├Ā celui de cette ┬½Philosophie de la Libert├®┬╗, tout ce qu'il m'a paru n├®cessaire de dire des tendances nouvelles de la philosophie on trouvera cet expos├® dans le second volume de mes ┬½Enigmes de la Philosophie┬╗.
Rudolf STEINER
Avril 1918
LA SCIENCE DE LA LIBERTE
1. L'action humaine consciente
LŌĆÖhomme, alors quŌĆÖil pense ou quŌĆÖil agit, peut-il ├¬tre consid├®r├® comme un ├¬tre spirituel libre ? Subit-il au contraire les lois inflexibles de la n├®cessit├® naturelle ? Plus que tout autre, ce probl├©me a exerc├® la sagacit├® des penseurs. La libert├® du vouloir humain a ├®t├®, par les uns, passionn├®ment d├®fendue, par les autres, obstin├®ment contest├®e. Certaines personnes, choqu├®es dans leurs plus ch├©res convictions morales, estiment quŌĆÖil faut ├¬tre dŌĆÖesprit born├® pour mettre en doute cette libert├® qui, dŌĆÖapr├©s eux, se manifeste avec toute la force de lŌĆÖ├®vidence. Certains, au contraire, trouvent supr├¬mement anti-scientifique de supposer en faveur des actes humains une discontinuit├® de lŌĆÖencha├«nement naturel des effets et des causes. La libert├® semble donc, aux premiers, le plus noble privil├©ge de lŌĆÖhomme, - aux seconds, sa plus vaine illusion. Pour expliquer que lŌĆÖacte libre de lŌĆÖhomme puisse sŌĆÖins├®rer dans lŌĆÖordre de la nature, ├Ā laquelle lŌĆÖhomme lui-m├¬me appartient, les philosophes du libre-arbitre ont invent├® des subtilit├®s infinies. Leurs adversaires, avec non moins de peine, ont montr├® comment lŌĆÖid├®e illusoire de la libert├® avait pu germer dans la conscience humaine.
Il faudrait ├¬tre bien d├®nu├® de r├®flexion pour ne pas se rendre compte que cette question philosophique est le pivot m├¬me de toutes nos conceptions morales, religieuses, scientifiques, bref, de toute notre existence. Et, parmi les sympt├┤mes les plus attristants de la mentalit├® contemporaine, il faut signaler le ton superficiel avec lequel David Fr├®d├®ric Strauss, dans un ouvrage o├╣ il pr├®tend fonder sur les donn├®es de la science moderne une ┬½foi nouvelle┬╗, ├®crit ce qui suit : ┬½Nous nŌĆÖavons pas ├Ā envisager ici la question de la libert├® de la volont├® humaine. La pr├®tendue libert├® de choisir indiff├®remment entre des actions a toujours ├®t├® consid├®r├®e comme illusoire par toutes les philosophies dignes de ce nom. Mais la valeur morale des actions et des intentions humaines ne d├®pend aucunement de ce probl├©me┬╗ [voir: "Der alte und neue Glaube" par David Fr├®d├®ric Strauss]. Si jŌĆÖai cit├® ce passage, ce nŌĆÖest pas que jŌĆÖattribue une importance sp├®ciale au livre dont il est tir├®, mais cŌĆÖest que jŌĆÖy trouve r├®sum├®e en peu de mots lŌĆÖopinion courante jusquŌĆÖ├Ā laquelle la plupart de nos contemporains savent sŌĆÖ├®lever en ce qui concerne ce probl├©me capital. Pour peu quŌĆÖils pr├®tendent ├Ā une culture qui d├®passe lŌĆÖ├®cole primaire, ils savent que la libert├® humaine ne saurait consister en un choix arbitraire entre deux actions ├®galement possibles. ├Ć tout acte de lŌĆÖhomme, leur a-t-on dit, il faut un mobile. CŌĆÖest ce mobile qui, de plusieurs actions possibles, en fait choisir une seule.
Voil├Ā ce qui para├«t ├®vident. Et cependant, cŌĆÖest contre le dogme du libre-arbitre (entendu comme une facult├® de choisir) que se dirigent, de nos jours encore, presque toutes les attaques des d├®terministes. ├ēcoutons par exemple Herbert Spencer, dont les opinions se r├®pandent actuellement de plus en plus : ┬½Que chacun de nous puisse, ├Ā son choix, d├®sirer ou ne pas d├®sirer┬╗, comme il est en somme sous-entendu par le dogme de la libre volont├®, cŌĆÖest une chose que r├®fute aussi bien mon analyse de la conscience humaine, que les r├®sultats de notre pr├®c├®dent chapitre [voir: "Les Principes de la Psychologie" par Herbert Spencer]. Ce point de d├®part est, en g├®n├®ral, adopt├® par tous ceux qui combattent lŌĆÖid├®e de libert├®. Toutes leurs th├®ories se trouvent dŌĆÖailleurs ├®nonc├®es en germe chez Spinoza. Les d├®terministes nŌĆÖont gu├©re fait que r├®p├®ter inlassablement le tr├©s simple raisonnement de leur pr├®curseur, mais en lŌĆÖenveloppant de th├®ories si compliqu├®es quŌĆÖon nŌĆÖaper├¦oit plus bien la simplicit├® de lŌĆÖerreur initiale.
Spinoza ├®crit, dans une lettre dŌĆÖoctobre ou novembre 1674 :
┬½Je nomme libre une chose qui nŌĆÖexiste et nŌĆÖagit que par la n├®cessit├® de sa nature, et contrainte une chose qui re├¦oit dŌĆÖune autre chose la d├®termination de son existence et de ses actions, et ceci dŌĆÖune mani├©re pr├®cise et fixe. Par exemple Dieu, quoique n├®cessaire, est libre, parce quŌĆÖil nŌĆÖexiste que par la n├®cessit├® de sa propre nature. Dieu se conna├«t librement, comme il conna├«t librement toute chose, parce quŌĆÖil sŌĆÖensuit seulement de la n├®cessit├® de sa nature quŌĆÖil connaisse toute chose. Vous voyez donc que je ne place pas la libert├® dans une libre d├®cision, mais dans une libre n├®cessit├®. Mais descendons aux choses cr├®├®es qui, toutes, sont d├®termin├®es, par des causes ext├®rieures, ├Ā exister et ├Ā agir dŌĆÖune mani├©re pr├®cise et fixe. Pour bien, comprendre ce fait, nous allons envisager un exemple tr├©s simple. Une pierre re├¦oit, de la cause ext├®rieure qui la heurte, une certaine quantit├® de mouvement, gr├óce ├Ā laquelle elle continue ensuite n├®cessairement ├Ā se mouvoir, quoique le heurt de la cause initiale ait cess├®. Cette inertie de la pierre, qui lui fait poursuivre son mouvement, est contrainte plut├┤t que n├®cessaire, parce quŌĆÖon la d├®finit par le heurt dŌĆÖune cause ext├®rieure. Ce qui est dit ici de la pierre vaut de toutes les choses en particulier, fussent-elles tr├©s compos├®es et aptes ├Ā toutes sortes dŌĆÖeffets : toute chose est d├®termin├®e n├®cessairement, par une cause ext├®rieure, ├Ā exister et ├Ā agir dŌĆÖune mani├©re pr├®cise et fixe. Admettez un instant, je vous prie, que la pierre, tandis quŌĆÖelle se meut, pense, et sache quŌĆÖelle sŌĆÖefforce tant quŌĆÖelle peut de poursuivre son mouvement. Cette pierre qui nŌĆÖest consciente que de son effort, et qui ne se comporte pas du tout avec indiff├®rence, croira quŌĆÖelle est absolument libre et que si elle poursuit son mouvement, cŌĆÖest exclusivement parce quŌĆÖelle le veut. Telle est cette libert├® humaine que tous pr├®tendent poss├®der, et qui consiste seulement en ceci que les hommes sont conscients de leurs d├®sirs, mais quŌĆÖils ignorent les causes qui les d├®terminent. Ainsi, lŌĆÖenfant croit quŌĆÖil d├®sire librement du lait, et le col├®reux croit quŌĆÖil crie librement vengeance, et le peureux croit prendre librement la fuite. De m├¬me, lŌĆÖivrogne croit se d├®cider librement ├Ā dire des choses quŌĆÖil ne dirait certainement pas volontiers sŌĆÖil ├®tait dans son ├®tat normal, et comme ce pr├®jug├® est inn├® ├Ā tous les hommes, il est fort difficile de sŌĆÖen lib├®rer. Car, quoique lŌĆÖexp├®rience nous enseigne que les hommes sont tr├©s peu capables de mod├®rer leurs d├®sirs et que, lorsque des passions contraires les agitent, ils con├¦oivent le mieux et font le pire, il nŌĆÖemp├¬che quŌĆÖils se tiennent pour des ├¬tres libres, et ceci parce quŌĆÖils ont des d├®sirs plus forts les uns que les autres, et parce que maints de leurs d├®sirs sont ├®mouss├®s par le souvenir de quelque autre chose ├Ā laquelle on ne prend pas bien garde┬╗.
Cette th├®orie est si pr├®cise et si simplement expos├®e quŌĆÖelle permet de toucher du doigt lŌĆÖerreur fondamentale sur laquelle elle repose. Spinoza nous dit de m├¬me quŌĆÖune pierre, apr├©s avoir re├¦u un choc, accomplit n├®cessairement un certain mouvement, de m├¬me lŌĆÖhomme agit toujours sous la pouss├®e dŌĆÖun mobile qui le d├®termine. Mais parce quŌĆÖil prend conscience de son action, il sŌĆÖen croit la libre cause, il ne voit pas la cause v├®ritable, le mobile d├®terminant auquel sa volont├® ob├®it. Tout ceci contient une faute de raisonnement facile ├Ā d├®couvrir : Spinoza, comme tous ses successeurs, omet de dire que lŌĆÖhomme prend conscience non seulement de son action, mais aussi, souvent, des mobiles qui lŌĆÖont amen├®e. Nul ne pr├®tend que le petit enfant soit libre lorsquŌĆÖil r├®clame son lait, ni lŌĆÖivrogne lorsquŌĆÖil prononce des paroles dont il aura ├Ā se repentir. Tous deux se soumettent aveugl├®ment aux tendances qui se font valoir dans les profondeurs de leur organisme, et dont ils nŌĆÖont pas clairement notion. Mais faut-il jeter dans le m├¬me sac les actions de cette sorte et celles de lŌĆÖhomme pleinement conscient, qui conna├«t non seulement la chose quŌĆÖil fait, mais encore les raisons pour lesquelles il la fait ? Les actes des hommes sont-ils dŌĆÖune seule et m├¬me esp├©ce ? Celui du soldat sur le champ de bataille, celui du savant dans le laboratoire, celui de lŌĆÖhomme dŌĆÖ├ētat au sein des inextricables complications diplomatiques, peuvent-ils ├¬tre assimil├®s ├Ā celui de lŌĆÖenfant qui r├®clame du lait ? ├ēvidemment, lorsquŌĆÖon cherche la solution dŌĆÖun probl├©me, il est bon de le poser sous sa forme la plus ├®l├®mentaire, mais le manque de discernement conduit aux confusions les plus graves, et, ici, il est capital de discerner entre lŌĆÖhomme qui conna├«t les mobiles de son acte et lŌĆÖhomme qui ne les conna├«t pas. Cette question qui sŌĆÖimpose, les d├®terministes ont omis de sŌĆÖen soucier. Ils nŌĆÖont jamais cherch├® ├Ā savoir si un motif dŌĆÖaction, lorsquŌĆÖon le conna├«t et lŌĆÖexamine en toute lucidit├®, exerce la m├¬me contrainte que le ph├®nom├©ne organique sous lŌĆÖinfluence duquel un enfant se met ├Ā r├®clamer du lait.
├ēd. von Hartmann, dans sa ┬½Ph├®nom├®nologie de la conscience morale┬╗, ├®crit que le vouloir humain d├®pend de deux principaux facteurs : les motifs et le caract├©re. Tant que lŌĆÖon croit tous les hommes semblables, ou quŌĆÖon leur attribue des diff├®rences de caract├©re insignifiantes, leur vouloir para├«t d├®termin├® du dehors, par les contingences ext├®rieures. Mais, en r├®alit├®, lŌĆÖhomme plac├® devant une id├®e ou une repr├®sentation nŌĆÖen fait un motif dŌĆÖaction que si cette id├®e, cette repr├®sentation, sŌĆÖaccordent avec son caract├©re et suscitent un d├®sir en lui... cet homme alors croit que la d├®termination vient des profondeurs de son ├¬tre, il sŌĆÖimagine ├¬tre libre des contingences ext├®rieures. ┬½Mais, dit ├ēd. von Hartmann, m├¬me lorsque nous transformons une id├®e ou repr├®sentation en un motif, nous ne saurions le faire arbitrairement, mais par la n├®cessit├® de notre idiosyncrasie ; par cons├®quent nous ne sommes absolument pas libres.┬╗ Ici encore, comme on le voit, lŌĆÖauteur n├®glige de distinguer les mobiles dŌĆÖaction que lŌĆÖon accepte apr├©s un lucide examen de ceux que lŌĆÖon subit sans en avoir une claire connaissance.
Et ceci nous conduit au point de vue qui dor├®navant sera le n├┤tre : a-t-on le droit de poser dŌĆÖune mani├©re unilat├®rale le probl├©me de la libert├® du vouloir humain ? Et si lŌĆÖon nŌĆÖa pas ce droit, ├Ā quel autre probl├©me doit on le rattacher ?
Du moment que lŌĆÖon admet une diff├®rence entre les motifs conscients et les impulsions inconscientes, une action change de valeur selon quŌĆÖelle est d├®termin├®e par ceux-l├Ā ou par celles-ci. D├©s lors, il sŌĆÖagit avant tout de bien d├®finir cette diff├®rence, car elle seule nous permettra de poser le probl├©me de la libert├® sur ses v├®ritables bases.
Conna├«tre ses raisons dŌĆÖagir, quŌĆÖentend-on par l├Ā ? Si les philosophes nŌĆÖont gu├©re examin├® cette face du probl├©me, cŌĆÖest que leur habitude est malheureusement de sectionner le tout indivisible quŌĆÖest lŌĆÖ├¬tre humain. DŌĆÖun c├┤t├®, ils posent lŌĆÖ├¬tre pensant. De lŌĆÖautre, lŌĆÖ├¬tre agissant. Et ils ├®liminent celui qui importe avant tout lŌĆÖ├¬tre qui agit en connaissance de cause.
On a dit : ┬½lŌĆÖhomme est libre lorsquŌĆÖil se soumet ├Ā sa raison plut├┤t quŌĆÖ├Ā ses impulsions animales┬╗ ; ou encore : ┬½├¬tre libre, cŌĆÖest pouvoir en toute occasion d├®terminer ses actes dŌĆÖapr├©s des buts et des d├®cisions raisonnables┬╗.
Mais ces pr├®ceptes ne m├©nent ├Ā rien, car ce quŌĆÖil sŌĆÖagit pr├®cis├®ment de savoir, cŌĆÖest si la raison, les buts et les d├®cisions de lŌĆÖhomme exercent sur lui la m├¬me in├®vitable contrainte que les besoins instinctifs. Si la d├®cision raisonnable surgit en moi sans ma collaboration, avec la m├¬me force tyrannique quŌĆÖune sensation de soif ou de faim, alors il faut bien que jŌĆÖob├®isse et ma libert├® nŌĆÖest quŌĆÖillusion.
Il y a encore une autre mani├©re de voir, cŌĆÖest celle-ci : ┬½├¬tre libre, dit-on, ce nŌĆÖest pas avoir la possibilit├® de vouloir ce que lŌĆÖon veut, mais de faire ce que lŌĆÖon veut┬╗.
Cette id├®e a ├®t├® d├®velopp├®e dŌĆÖune mani├©re frappante par le po├©te-philosophe Robert Hamerling : ┬½LŌĆÖhomme, certes, peut faire ce quŌĆÖil veut, mais il ne peut pas vouloir ce quŌĆÖil veut, car sa volont├® est d├®termin├®e par des motifs. Il ne peut vouloir ce quŌĆÖil veut, examinons cette proposition de plus pr├©s. A-t-elle un sens raisonnable ? La libert├® de vouloir devrait donc consister ├Ā pouvoir vouloir une chose sans raison, sans motif ? Mais que signifie donc vouloir si ce nŌĆÖest avoir une raison de faire ou de d├®sirer ceci plut├┤t que cela ? Vouloir quelque chose sans raison, sans motif, cela signifierait vouloir quelque chose sans le vouloir. Au concept de volont├® est indissolublement li├® le concept de motif. Sans un motif d├®terminant, la volont├® nŌĆÖest quŌĆÖun pouvoir inutile. Il ne devient actif et r├®el que gr├óce au motif. Il est donc parfaitement exact que la volont├® humaine nŌĆÖest pas libre, en ce sens que sa direction est toujours d├®termin├®e par le motif le plus fort. Mais il faut conc├®der dŌĆÖautre part quŌĆÖil est absurde dŌĆÖopposer ├Ā cette non-libert├® une libert├® imaginaire qui consisterait ├Ā pouvoir vouloir ce quŌĆÖon ne veut pas┬╗ [voir: "Atomistique de la volont├®" par Robert Hamerling].
Hamerling, lui encore, parle de ┬½motifs┬╗ en g├®n├®ral, sans pr├®ciser sŌĆÖil sŌĆÖagit de motifs conscients ou inconscients. Or, d├©s lŌĆÖinstant quŌĆÖun motif exerce sur moi une pression invincible, peu importe que je puisse accomplir, ou non, ce que ce motif me prescrit : lŌĆÖid├®e de libert├® a perdu toute signification. Quelle importance cela peut-il avoir pour moi de pouvoir faire une chose ou non, si je suis oblig├® par le motif ├Ā la faire ? Ce qui importe, ce nŌĆÖest pas de savoir si je puis r├®aliser ensuite ce que le motif mŌĆÖa impos├®, mais de savoir sŌĆÖil nŌĆÖexiste que des motifs dou├®s de cette autorit├® n├®cessaire et absolue. Si je suis oblig├® de vouloir quelque chose, il peut mŌĆÖ├¬tre extr├¬mement indiff├®rent de le pouvoir aussi r├®aliser. Il peut m├¬me arriver que le motif impos├® de la sorte par les circonstances et par mon caract├©re apparaisse tout ├Ā fait d├®raisonnable ├Ā lŌĆÖexamen de mon intelligence dans ce cas, je serai tr├©s heureux dŌĆÖ├¬tre emp├¬ch├® de faire ce que je veux ! Il ne sŌĆÖagit pas de savoir si lŌĆÖhomme peut, ou ne peut pas, mettre ses desseins ├Ā ex├®cution, mais de comprendre de quelle mani├©re ces desseins naissent en lui.
Ce qui le diff├®rencie des autres cr├®atures organis├®es, cŌĆÖest son intelligence, sa facult├® de penser. LŌĆÖaction, au contraire, lui est commune avec les autres organismes. Pour ├®lucider le probl├©me de la libert├®, les savants modernes aiment ├Ā ├®tablir des analogies avec le r├©gne animal. La science, ├Ā notre ├®poque, se pla├«t ├Ā ce genre de comparaisons. LorsquŌĆÖelle a trouv├® parmi les gestes des animaux quelque chose qui ressemble ├Ā la conduite des hommes, elle se croit en possession des derniers secrets de la nature humaine. Or, cette attitude conduit ├Ā des malentendus dont la citation suivante donnera une id├®e: ┬½Il est facile dŌĆÖexpliquer pourquoi le mouvement dŌĆÖune pierre nous semble n├®cessaire, et le vouloir dŌĆÖun ├óne, non n├®cessaire. Les causes qui meuvent la pierre sont au dehors et bien visibles. Mais les causes par lesquelles un ├óne veut sont ├Ā lŌĆÖint├®rieur de cette ├óne, et invisibles. Entre nous et le lieu de leur causalit├® se trouve le cr├óne de lŌĆÖ├óne... on ne voit pas cette causalit├® et lŌĆÖon imagine quŌĆÖelle nŌĆÖexiste pas. La volont├®, dit-on, est cause que lŌĆÖ├óne se retourne, et lŌĆÖon croit quŌĆÖelle nŌĆÖest conditionn├®e par rien, quŌĆÖelle est un commencement absolu.┬╗ [voir: "LŌĆÖillusion de la libert├®" par P. R├®e]
Ici encore, il est enti├©rement fait abstraction des actes dont la conscience humaine conna├«t les mobiles, car R├®e d├®clare : ┬½entre nous et le lieu de leur causalit├®, il y a le cr├óne de lŌĆÖ├óne┬╗. QuŌĆÖil existe des actions, non point de lŌĆÖ├óne, mais de lŌĆÖhomme, o├╣ le motif devenu conscient sŌĆÖinterpose entre nous et lŌĆÖaction, R├®e ne sŌĆÖen doute pas. Il le prouve encore en ├®crivant, quelques pages plus loin : ┬½Nous ne percevons pas les causes qui n├®cessitent notre volont├® et cŌĆÖest pourquoi nous croyons quŌĆÖelle nŌĆÖest pas n├®cessit├®e┬╗.
Mais assez de ces exemples. Ils d├®montrent quŌĆÖun grand nombre de penseurs attaquent la conception de la libert├® sans m├¬me savoir ce quŌĆÖon entend par ce mot. Il va de soi quŌĆÖune action nŌĆÖest jamais libre tant que son auteur en ignore les causes. Mais que se passe-t-il lorsque ces causes sont au contraire connues ? Et ceci nous am├©ne ├Ā nous demander : quelle est lŌĆÖorigine et la nature de la Pens├®e ? Tant que nous nŌĆÖaurons pas bien compris ce quŌĆÖest lŌĆÖactivit├® pensante de lŌĆÖ├óme, nous ignorerons ce que signifie ┬½conna├«tre┬╗ ou ┬½savoir quelque chose┬╗, f├╗t-ce une action. Au contraire, lorsque nous aurons ├®tabli ce quŌĆÖest la Pens├®e, le r├┤le quŌĆÖelle joue dans lŌĆÖaction humaine appara├«tra clairement. Hegel a dit : ┬½CŌĆÖest seulement avec la Pens├®e que lŌĆÖ├óme, (dont les animaux sont dou├®s comme les hommes), sŌĆÖ├®l├©ve au rang dŌĆÖesprit┬╗. Rien de plus juste, et cŌĆÖest ├®galement la Pens├®e qui donne ├Ā lŌĆÖaction humaine son caract├©re propre.
Nous sommes bien ├®loign├®s de croire que tous nos actes d├®coulent dŌĆÖun froid calcul et nous ne tendons pas ├Ā d├®finir comme proprement humaines les d├®cisions issues du raisonnement abstrait. Cependant, d├©s que nous nous ├®levons au-dessus de la simple satisfaction des besoins physiques, nos motifs dŌĆÖaction sont toujours plus ou moins ├®clair├®s par notre pens├®e. LŌĆÖamour, la piti├®, le patriotisme, sont des motifs qui, certes, ne ressemblent pas ├Ā des concepts abstraits. Le coeur, le sentiment, y jouent le r├┤le principal. Mais le sentiment ne saurait cr├®er ├Ā lui tout seul des motifs dŌĆÖaction. Il les pr├®suppose et il les fait entrer dans sa sph├©re. La piti├®, par exemple, ne peut sŌĆÖemparer de mon coeur que lorsque jŌĆÖai eu la repr├®sentation dŌĆÖune personne malheureuse. Le chemin du coeur passe par la t├¬te... LŌĆÖamour lui-m├¬me est bien loin de faire exception ├Ā cette loi. D├©s quŌĆÖil cesse dŌĆÖ├¬tre la simple manifestation de lŌĆÖinstinct sexuel, il repose sur les repr├®sentations que lŌĆÖon se fait de la personne aim├®e. Et, plus ces repr├®sentations paraissent id├®ales, plus lŌĆÖamour sŌĆÖexalte. La pens├®e, ici encore, pr├®c├©de le sentiment. Un dicton pr├®tend que lŌĆÖamour nous rend aveugle aux d├®fauts de lŌĆÖ├¬tre aim├® ; mais on peut intervertir les choses et dire au contraire que lŌĆÖamour nous ouvre les yeux sur les qualit├®s de cet ├¬tre. Les hommes passent aupr├©s de ces qualit├®s sans les remarquer... un seul les aper├¦oit, et de l├Ā na├«t son amour. Si les autres nŌĆÖont point ├®prouv├® cet amour, cŌĆÖest quŌĆÖils nŌĆÖont pas eu la m├¬me repr├®sentation.
Sous quelque face que lŌĆÖon envisage le probl├©me, on en revient toujours ├Ā se dire que lŌĆÖaction humaine ne peut ├¬tre comprise sans quŌĆÖon ait ├®tabli dŌĆÖabord lŌĆÖorigine et lŌĆÖessence de la Pens├®e. Commen├¦ons donc par traiter ce chapitre essentiel.
2. Le besoin organique de la connaissance
┬½En moi jŌĆÖai l├Ā deux ├ómes, je le sens,
Et lŌĆÖune loin de lŌĆÖautre voudrait ├¬tre.
LŌĆÖune ├Ā la terre avec passion se prend
Et sŌĆÖy cramponne par tous ses organes ;
De sa poussi├©re lŌĆÖautre sŌĆÖarrachant,
Monte aux r├®gions o├╣ les anc├¬tres planent.┬╗
[nota: Faust, I, 1112-1117 - trad. Fran├¦ois Sabatier sur le m├©tre de lŌĆÖoriginal]
Ces vers de Goethe expriment un des caract├©res les plus profonds de la nature humaine. LŌĆÖorganisation de lŌĆÖhomme nŌĆÖest pas simple. Ce que lŌĆÖunivers lui offre spontan├®ment ne lui suffit pas. Il d├®sire toujours plus. Autrement dit, parmi les besoins dont la Nature nous a dou├®s, il en est un grand nombre quŌĆÖelle nous laisse le soin de satisfaire par nos propres moyens. Certes, ses dons sont abondants, mais nos ambitions les d├®passent. Il semble que nous soyons n├®s pour d├®sirer sans cesse. Un cas particulier de ce perp├®tuel d├®sir, cŌĆÖest notre soif de connaissance. Nous regardons un arbre ├Ā deux moments diff├®rents. Une fois, nous voyons ses branches au repos, lŌĆÖautre fois, en mouvement. Cette observation est loin de nous satisfaire. Il nous faut savoir pourquoi lŌĆÖarbre appara├«t tant├┤t immobile et tant├┤t agit├®. Ainsi, ├Ā chaque regard que nous jetons dans la nature environnante, dŌĆÖinnombrables questions sŌĆÖ├®l├©vent en nous. Chaque ph├®nom├©ne, en nous apparaissant, nous impose une t├óche. Chaque exp├®rience nous devient ├®nigme. Nous voyons sortir de lŌĆÖoeuf un animal semblable ├Ā sa m├©re, et nous nous demandons la cause de cette ressemblance. Nous suivons, dans tout ├¬tre vivant, les progr├©s de la croissance et du d├®veloppement jusquŌĆÖ├Ā un certain degr├® de perfection, et nous nous demandons quelles sont les lois de ce progr├©s. Jamais nous ne nous estimons satisfaits par ce que la Nature d├®ploie devant nos sens. En tout, nous cherchons ├Ā obtenir ce que nous appelons ┬½lŌĆÖexplication┬╗ du ph├®nom├©ne.
Ce que nous exigeons des choses, ├®tant infiniment plus vaste que ce quŌĆÖelles nous donnent imm├®diatement, cr├®e dans notre ├¬tre une division : nous prenons conscience de former un certain contraste avec le monde. Nous nous opposons ├Ā lui, en tant quŌĆÖ├¬tres ind├®pendants. LŌĆÖunivers nous appara├«t d├©s lors dans sa polarit├® : Moi et le Monde.
Nous ├®difions donc une cloison entre le monde et nous, et ceci d├©s que notre conscience sŌĆÖ├®veille. N├®anmoins, nous ne perdons jamais le sentiment dŌĆÖappartenir malgr├® tout ├Ā ce monde, de lui ├¬tre li├®s, de demeurer non pas ext├®rieurs ├Ā lui, mais englob├®s en lui.
Ce sentiment nous incite ├Ā r├®soudre lŌĆÖopposition qui existe entre lŌĆÖunivers et nous. Jeter un pont sur cet ab├«me, cŌĆÖest le but m├¬me de toutes les activit├®s spirituelles de lŌĆÖhumanit├®. LŌĆÖhistoire de lŌĆÖesprit humain ne relate, somme toute, que cette recherche constante dŌĆÖunit├®. Elle est ├Ā la base de la religion, de lŌĆÖart, de la science. Le croyant esp├©re, gr├óce ├Ā la r├®v├®lation divine, r├®soudre le probl├©me que sŌĆÖest pos├® son moi, que le monde des apparences ne contentait pas. LŌĆÖartiste cherche ├Ā imprimer dans la mati├©re les inspirations de ce moi ; il tente donc une r├®conciliation du monde ext├®rieur et de son ├¬tre intime. Lui non plus nŌĆÖest pas satisfait par le monde des apparences et veut lŌĆÖenrichir des formes que son moi rec├©le. Le penseur, de son c├┤t├®, transformant les r├®sultats de lŌĆÖobservation pure et simple, sŌĆÖefforce de trouver les lois qui r├®gissent les ph├®nom├©nes. Lorsque du contenu du monde nous faisons le contenu de notre pens├®e, le pont est franchi, le rapport que nous avions bris├® est r├®tabli. Mais nous verrons par la suite que ce but nŌĆÖest r├®ellement atteint que si le penseur con├¦oit sa t├óche dŌĆÖune mani├©re plus profonde quŌĆÖon ne le fait g├®n├®ralement. La situation que je viens dŌĆÖexposer se manifeste nettement dans lŌĆÖhistoire de la philosophie. Nous y trouvons un perp├®tuel conflit entre la conception unitaire, ou monisme, et la th├®orie des deux mondes, ou dualisme.
Le dualisme envisage uniquement cette s├®paration que la conscience humaine a trac├®e entre le monde et le moi. CŌĆÖest en vain quŌĆÖil sŌĆÖefforce de r├®concilier ces deux termes oppos├®s, quŌĆÖil les appelle ┬½esprit et mati├©re┬╗, ┬½sujet et objet┬╗, ou ┬½pens├®e et ph├®nom├©ne┬╗. Il pressent quŌĆÖun rapport existe entre les deux sph├©res, mais il demeure incapable de le d├®finir. LŌĆÖhomme, alors quŌĆÖil se sent un moi, ne peut faire autrement que de ranger ce moi du c├┤t├® de lŌĆÖesprit. Puis, opposant ├Ā ce moi le monde ext├®rieur, il implique en ce dernier lŌĆÖensemble des perceptions sensibles, cŌĆÖest-├Ā-dire le monde mat├®riel. Par l├Ā lŌĆÖhomme sŌĆÖintroduit lui-m├¬me dans lŌĆÖopposition entre lŌĆÖesprit et la mati├©re, et il y est dŌĆÖautant plus oblig├® que son propre corps appartient ├®videmment au monde mat├®riel. Ainsi, le moi est partie int├®grante du monde spirituel, tandis que les choses et les ph├®nom├©nes mat├®riels, per├¦us par les sens, constituent le monde. Toutes les ├®nigmes qui concernent lŌĆÖesprit et la mati├©re se retrouvent donc dans lŌĆÖ├®nigme fondamentale de la nature humaine. Le monisme au contraire ne consid├©re que lŌĆÖunit├®, et sŌĆÖefforce de nier ou dŌĆÖatt├®nuer toute opposition. Or, aucune de ces deux conceptions ne rend bien compte des faits. Le dualisme envisage lŌĆÖesprit (moi) et la mati├©re (monde) comme deux entit├®s profond├®ment diff├®rentes, et, ce faisant, il se condamne ├Ā ne point expliquer leurs actions r├®ciproques. Comment lŌĆÖesprit saura-t-il ce qui se passe dans la mati├©re, si celle-ci lui est absolument ├®trang├©re ? Comment arrivera-t-il ├Ā exercer sur elle une influence, cŌĆÖest-├Ā-dire ├Ā r├®aliser des intentions ? En r├®ponse ├Ā ces questions, on a ├®chafaud├® les hypoth├©ses les plus habiles et les plus insens├®es.
Le monisme, dŌĆÖailleurs, se trouve jusquŌĆÖ├Ā pr├®sent tout aussi embarrass├®. Il a essay├® de sŌĆÖen tirer par trois m├®thodes : ou bien il nie lŌĆÖesprit, et se nomme mat├®rialisme, ou bien il nie la mati├©re et devient spiritualisme ; ou encore il affirme que la mati├©re et lŌĆÖesprit sont indissolublement li├®s jusque dans le plus petit atome et que, ne se s├®parant jamais, ils apparaissent tout naturellement unis jusque dans lŌĆÖhomme.
Le mat├®rialisme ne pourra jamais fournir une explication rationnelle du monde. Car toute explication commence par ce fait quŌĆÖon con├¦oit des id├®es sur les ph├®nom├©nes. Le mat├®rialisme lui-m├¬me part dŌĆÖid├®es sur la mati├©re, dŌĆÖid├®es sur les ph├®nom├©nes mat├®riels. Il se trouve donc devant un double ordre de faits : dŌĆÖune part, le monde mat├®riel, dŌĆÖautre part, les id├®es que lŌĆÖon se fait de lui. Or, il cherche ├Ā expliquer ces derni├©res comme des ph├®nom├©nes purement mat├®riels, estimant que la pens├®e se produit dans le cerveau comme la digestion dans lŌĆÖappareil digestif. CŌĆÖest attribuer ├Ā la mati├©re, en plus de ses facult├®s m├®caniques et organiques, celle de penser lorsque certaines conditions sont remplies. Mais, ce faisant, on d├®place le probl├©me : lŌĆÖhomme, au lieu de sŌĆÖattribuer ├Ā lui-m├¬me la facult├® pensante, en doue la mati├©re, et le voici revenu ├Ā son point de d├®part : comment la mati├©re est-elle amen├®e ├Ā penser sur elle-m├¬me ? pourquoi nŌĆÖest-elle pas simplement satisfaite dŌĆÖelle-m├¬me et de son existence ? Le mat├®rialisme a d├®tourn├® son regard du vrai sujet, du moi pensant, et il est arriv├® devant une fiction n├®buleuse, ind├®termin├®e. L├Ā, la premi├©re ├®nigme est revenue se poser ├Ā lui, car le probl├©me, loin dŌĆÖavoir ├®t├® r├®solu, avait ├®t├® seulement transpos├®.
Quant au pur spiritualiste, il nie que la mati├©re ait une existence ind├®pendante, et lŌĆÖenvisage comme un produit de lŌĆÖesprit. Appliqu├®e au probl├©me de la nature humaine, cette conception aboutit ├Ā une impasse. En effet, avec un moi rel├®gu├® de la sorte du c├┤t├® de lŌĆÖesprit, le monde sensible nŌĆÖa plus aucun lien. Pour ce monde sensible, en fait, il nŌĆÖy a pas de chemin dŌĆÖacc├©s spirituel vers ce moi ; il lui faut se manifester par lŌĆÖinterm├®diaire de ph├®nom├©nes mat├®riels. Or, ces ph├®nom├©nes mat├®riels, comment le moi les trouvera-t-il en lui, qui est dŌĆÖessence purement spirituelle ? Comment ce quŌĆÖil ├®labore de sa propre activit├® spirituelle, contiendra-t-il le monde de la mati├©re ? En v├®rit├®, ce moi devra renoncer ├Ā conna├«tre lŌĆÖunivers sŌĆÖil ne se rattache pas ├Ā lui par des liens non spirituels. Et, de m├¬me, il ne pourra jamais agir sŌĆÖil nŌĆÖemploie pas des ├®nergies et des substances non spirituelles. Il est constamment ramen├® ├Ā reconna├«tre lŌĆÖexistence objective du monde sensible.
Un penseur, en partant de lŌĆÖid├®alisme absolu, est arriv├® ├Ā pousser le spiritualisme jusquŌĆÖ├Ā ses extr├¬mes limites : cŌĆÖest J.-G. Fichte. Il a voulu d├®duire du moi tout lŌĆÖ├®difice universel. Il a r├®ussi ├Ā construire un magnifique tableau id├®al du monde, mais en en retranchant toute r├®alit├® exp├®rimentale. Pas plus que le mat├®rialiste nŌĆÖa le droit de contester lŌĆÖexistence de lŌĆÖesprit, le spiritualiste ne peut d├®cr├®ter la suppression de la mati├©re.
La philosophie spiritualiste commet une erreur fr├®quente qui est de confondre le monde de lŌĆÖesprit et le monde des id├®es. En effet, lorsque lŌĆÖhomme ├®tudie son propre moi, ses id├®es lui apparaissent tout dŌĆÖabord comme le produit le plus direct de son activit├® spirituelle. Le spiritualisme se convertit de la sorte en un id├®alisme ├®troit, incapable dŌĆÖatteindre, au del├Ā des id├®es, le v├®ritable esprit ; il croit que celles-l├Ā contiennent celui-ci, et sa conception du monde sŌĆÖen trouve paralys├®e, emprisonn├®e pour ainsi dire dans les limites de lŌĆÖactivit├® du moi.
Citons une d├®viation curieuse de lŌĆÖid├®alisme. CŌĆÖest la doctrine de F. A. Lange, telle quŌĆÖil lŌĆÖexpose dans son "Histoire du Mat├®rialisme". Il admet que le mat├®rialisme a raison de consid├®rer la pens├®e comme un produit des ph├®nom├©nes mat├®riels. Mais inversement, ces derniers sont des produits de la pens├®e. ┬½Nos sens nous pr├®sentent des effets des choses et non leurs images exactes, ni ces choses elles-m├¬mes. Parmi ces effets, il faut compter aussi nos sens, notre cerveau, les vibrations qui sŌĆÖy produisent...┬╗ Autrement dit : notre pens├®e est engendr├®e par les ph├®nom├©nes mat├®riels, et ceux-ci par la pens├®e. La doctrine de Lange est une transposition philosophique de la fameuse histoire du baron de Munchhausen qui se suspendit en lŌĆÖair ├Ā sa propre chevelure.
La troisi├©me forme du monisme est celle qui consid├©re lŌĆÖ├®l├®ment primitif (atome) comme r├®unissant en lui les deux r├®alit├®s de lŌĆÖesprit et de la mati├©re. Ceci nŌĆÖest pas une solution, cŌĆÖest seulement un d├®placement de la question. Pourquoi lŌĆÖatome, sŌĆÖil est une unit├®, se manifeste-t-il selon deux modes ?
Toutes ces doctrines semblent perdre de vue que lŌĆÖopposition dont il sŌĆÖagit se produit tout dŌĆÖabord dans notre conscience. CŌĆÖest nous-m├¬mes qui nous d├®tachons du sein originel de la nature, cŌĆÖest nous qui opposons notre moi au monde. Goethe a exprim├® cette pens├®e dŌĆÖune mani├©re qui peut sembler peu scientifique, mais qui est de la plus pure beaut├®, dans un essai intitul├® La Nature : ┬½Nous vivons en elle et lui sommes ├®trangers. Elle nous parle sans cesse et ne nous r├®v├©le pas son secret.┬╗ Mais Goethe conna├«t aussi lŌĆÖenvers de cette pens├®e : ┬½Les hommes sont tous en elle et elle est en tous.┬╗
SŌĆÖil est vrai que nous nous sommes exil├®s de la nature, il est non moins certain que nous nous sentons encore en elle, et que nous savons lui appartenir. NŌĆÖest-ce pas sa propre activit├® cr├®atrice qui vit en nous ?
Il sŌĆÖagit de retrouver le chemin qui nous reconduira vers elle ; la simple r├®flexion enseigne ce chemin : en nous d├®tachant de la nature, nous avons emport├® quelque chose dŌĆÖelle et lŌĆÖavons gard├® au tr├®fonds de notre ├¬tre. CŌĆÖest ce quelque chose quŌĆÖil nous faut rechercher pour renouer le lien bris├® entre lŌĆÖunivers et nous. Le dualisme, qui consid├©re la vie int├®rieure de lŌĆÖhomme comme ├®trang├©re au monde sensible, sŌĆÖefforce en vain dŌĆÖaccoupler ces deux termes ; rien dŌĆÖ├®tonnant ├Ā ce quŌĆÖil ne trouve pas entre eux dŌĆÖinterm├®diaire. Mais lorsque nous aurons connu la Nature en nous-m├¬mes il nous sera facile de la retrouver ├Ā lŌĆÖext├®rieur. Ce qui, dans notre ├¬tre intime, lui est semblable, nous servira de guide. Notre voie est donc trac├®e nous ne sp├®culerons pas sur les actions r├®ciproques du monde et de lŌĆÖesprit ; nous descendrons dans les profondeurs de notre ├óme et nous y rechercherons les ├®l├®ments originels qui y subsistent. CŌĆÖest par lŌĆÖinvestigation int├®rieure que nous tenterons de r├®soudre lŌĆÖ├®nigme qui se pose et nous arriverons ├Ā un point o├╣ nous pourrons nous dire : - Ici, je ne suis plus simplement moi, ici je rencontre quelque chose qui est plus que le moi.
Je suis certain que plus dŌĆÖun lecteur, mŌĆÖayant suivi jusquŌĆÖici, aura trouv├® mes d├®veloppements en d├®saccord avec le point de vue scientifique actuel. Je lui r├®pondrai que, jusquŌĆÖ├Ā pr├®sent, je nŌĆÖai pas eu ├Ā me pr├®occuper de ce point de vue. JŌĆÖai d├╗ purement et simplement d├®crire ce que chacun de nous peut ├®prouver dans sa propre conscience. SŌĆÖil sŌĆÖest gliss├® parmi ces consid├®rations quelques allusions ├Ā une r├®conciliation de la conscience humaine et du monde ext├®rieur, ce fut seulement pour rendre mon expos├® plus clair. Je nŌĆÖai pas non plus cru devoir attribuer ├Ā des expressions telles que ┬½moi┬╗, ┬½esprit┬╗, ┬½monde┬╗, ┬½nature┬╗, etc., le sens pr├®cis quŌĆÖon a coutume de leur donner dans la psychologie. La conscience courante de lŌĆÖhomme ignore ces distinctions subtiles, et il ne sŌĆÖagissait pour moi que de d├®crire des faits quotidiens, accessibles ├Ā tous. Je nŌĆÖai pas eu ├Ā savoir comment la philosophie a interpr├®t├® jusquŌĆÖici le ph├®nom├©ne de la conscience, mais ├Ā montrer de quelle fa├¦on ce ph├®nom├©ne se produit r├®ellement ├Ā chaque instant de la vie humaine.
3. La pens├®e instrument de la conception du monde
Soit une boule de billard qui, ayant re├¦u un choc, se meut et transmet son mouvement ├Ā une seconde boule. Le ph├®nom├©ne que jŌĆÖobserve sŌĆÖaccomplit sans que jŌĆÖy sois pour rien. La direction et la vitesse de la seconde boule d├®pendent uniquement de la direction et de la vitesse de la premi├©re. En tant que simple observateur, je ne puis rien pr├®sumer du mouvement de cette seconde boule avant lŌĆÖinstant o├╣ celle-ci sŌĆÖ├®branle.
Mais que je commence ├Ā r├®fl├®chir sur lŌĆÖobjet de mon observation, et tout change. Ma r├®flexion se propose de construire des concepts du ph├®nom├©ne observ├®. Je combine le concept dŌĆÖune boule ├®lastique avec certains autres, tir├®s de la m├®canique, et je p├©se les diff├®rents facteurs qui interviennent en ce cas particulier. JŌĆÖessaye donc dŌĆÖajouter au ph├®nom├©ne, qui sŌĆÖaccomplit sans moi, un second ph├®nom├©ne dont le th├®├ótre est la sph├©re conceptuelle. Ce second ph├®nom├©ne d├®pend de moi : en effet, je puis, si bon me semble, me contenter de lŌĆÖobservation et renoncer ├Ā toute recherche de pens├®e. Si, au contraire, jŌĆÖen ├®prouve le besoin, je ne serai point satisfait avant dŌĆÖavoir ├®tabli une certaine relation entre les concepts de boule, dŌĆÖ├®lasticit├®, de mouvement, de choc, de vitesse, etc., - ceci en rapport ├®troit avec le ph├®nom├©ne observ├®. Autant il appert que le ph├®nom├©ne mat├®riel est ind├®pendant de moi, autant il est certain que le processus conceptuel nŌĆÖexiste que par mon intervention.
Remettons ├Ā plus tard la question de savoir si cette intervention r├®sulte vraiment de notre propre initiative, ou si les physiologistes modernes affirment ├Ā juste titre que nous pensons non pas ce que nous voulons, mais ce que nos id├®es et associations dŌĆÖid├®es pr├®c├®dentes nous obligent ├Ā penser [voir: "Leitfaden der physiologischen Psychologie" par Ziehen, I├®na 1893. p. 171]. Pour lŌĆÖinstant, retenons cette tendance que nous avons ├Ā surajouter des concepts et des associations de concepts aux objets et aux ph├®nom├©nes qui nous sont donn├®s : que cet acte soit v├®ritablement n├┤tre, ou quŌĆÖil soit command├® par une inalt├®rable n├®cessit├®, peu importe ici : il appara├«t comme n├┤tre, voil├Ā lŌĆÖessentiel. Nous savons parfaitement que les concepts des objets ne nous sont pas donn├®s en m├¬me temps que les objets. Que nous les ├®laborions nous-m├¬mes, cŌĆÖest une illusion peut-├¬tre, mais cŌĆÖest pourtant ainsi que la chose se pr├®sente ├Ā notre observation imm├®diate. Or, quŌĆÖavons-nous gagn├® lorsque nous avons trouv├® lŌĆÖensemble de concepts qui correspond ├Ā un ph├®nom├©ne ?
Il y a une profonde diff├®rence entre la mani├©re dont se comportent ├Ā nos yeux les divers ├®l├®ments dŌĆÖun ph├®nom├©ne avant et apr├©s notre construction de son correspondant conceptuel. La simple observation peut suivre les phases du ph├®nom├©ne une ├Ā une, mais elle ne jette aucune lumi├©re sur leurs rapports : je vois la premi├©re boule de billard se mouvoir dans une certaine direction, avec une certaine vitesse. CŌĆÖest seulement lorsquŌĆÖelle a heurt├® la seconde boule que je puis conna├«tre les cons├®quences du choc, et ces cons├®quences m├¬mes, je ne fais que les suivre du regard. Supposons que quelquŌĆÖun me cache le tapis du billard au moment pr├®cis o├╣ le choc se produit : en ce cas, si je suis simple observateur, jŌĆÖignore totalement ce qui arrive. Si au contraire jŌĆÖai trouv├®, avant lŌĆÖinterception, les concepts relatifs au ph├®nom├©ne, cela me permet dŌĆÖindiquer ce qui se passe, bien que mon observation ait ├®t├® interrompue. Un objet ou un fait, tant quŌĆÖils sont purement et simplement observ├®s, nŌĆÖenseignent rien sur leurs rapports avec dŌĆÖautres objets ou dŌĆÖautres faits. Mais que la pens├®e se joigne ├Ā lŌĆÖobservation, et les rapports apparaissent.
LŌĆÖobservation et la pens├®e sont les deux points de d├®part de toute lŌĆÖactivit├® spirituelle de lŌĆÖhomme, au moins dans les limites o├╣ celui-ci prend conscience dŌĆÖelle. Le bon sens commun repose sur ces deux piliers de notre esprit aussi bien que les recherches scientifiques les plus complexes. Les philosophes ont pris leur point de d├®part dans certaines antith├©ses telles que lŌĆÖid├®e et la r├®alit├®, le sujet et lŌĆÖobjet, lŌĆÖapparence et la chose en soi, le moi et le non-moi, lŌĆÖid├®e et la volont├®, le concept et la mati├©re, la force et la mati├©re, le conscient et lŌĆÖinconscient. Nous allons montrer que lŌĆÖopposition de lŌĆÖobservation et de la pens├®e est infiniment plus importante du point de vue de lŌĆÖhomme, et quŌĆÖelle doit primer toutes les autres.
Quelque principe que nous ├®tablissions, il faut toujours : ou que nous d├®clarions lŌĆÖavoir observ├® quelque part, ou que nous lŌĆÖ├®mettions sous forme dŌĆÖune pens├®e bien claire, que tout autre homme soit capable de concevoir apr├©s nous. Le philosophe qui commence ├Ā parler de ses ┬½principes┬╗ est oblig├® de se servir de la forme conceptuelle, donc de la pens├®e. Cela implique quŌĆÖ├Ā tous ses principes il pr├®suppose lŌĆÖexistence de la pens├®e. Que la pens├®e soit ou ne soit pas lŌĆÖ├®l├®ment fondamental de lŌĆÖunivers, nous nŌĆÖen discutons pas ici. Mais il est certain que le philosophe nŌĆÖaurait, sans elle, aucune connaissance de cette question. Il se peut que la pens├®e joue seulement un r├┤le accessoire dans la gen├©se du monde, mais dans la gen├©se de notre opinion sur ce sujet, elle tient certainement la toute premi├©re place.
Pour ce qui est de lŌĆÖobservation, disons que notre constitution humaine nous en donne le besoin. Les r├®flexions que nous pouvons faire sur un cheval, et lŌĆÖobjet ┬½cheval┬╗ lui m├¬me, sont deux choses qui nous apparaissent s├®par├®ment. Et lŌĆÖobjet ┬½cheval┬╗ ne nous est accessible que par lŌĆÖobservation. SŌĆÖil est vrai que lŌĆÖacte de fixer un cheval ne peut, ├Ā lui tout seul, nous en fournir le concept, il est ├®galement vrai que la pens├®e, seule, se montrerait incapable dŌĆÖengendrer un objet qui lui corresponde.
Il faut m├¬me ajouter que, dans le temps, lŌĆÖobservation pr├®c├©de la pens├®e. En effet, cŌĆÖest seulement par lŌĆÖobservation que nous pouvons apprendre ├Ā conna├«tre la pens├®e. LorsquŌĆÖau d├®but de ce chapitre nous avons montr├® la pens├®e surgissant ├Ā lŌĆÖoccasion dŌĆÖun ph├®nom├©ne et d├®passant la sph├©re des objets simplement donn├®s, nous avons fait, somme toute, la description dŌĆÖune observation. Tout ce qui entre dans le cercle de nos exp├®riences se fait conna├«tre ├Ā nous par cet interm├®diaire. La sensation, la perception, la conception, le sentiment, lŌĆÖacte volontaire, le r├¬ve et la cr├®ation imaginaire, la repr├®sentation, le concept, lŌĆÖid├®e, tout le contenu de notre vie int├®rieure, y compris les illusions et les hallucinations, tout nous est donn├® ├Ā travers lŌĆÖobservation.
Cependant, notre pens├®e est un objet dŌĆÖobservation qui se distingue essentiellement de tous les autres. LŌĆÖobservation dŌĆÖune table, dŌĆÖun arbre, se produit en nous d├©s que ces objets surgissent dans notre champ de perception. Mais, en ce qui concerne la pens├®e que jŌĆÖai de ces objets, je ne lŌĆÖobserve pas au m├¬me instant. JŌĆÖobserve une table et je pense cette table, mais je nŌĆÖobserve pas imm├®diatement la pens├®e que jŌĆÖen ai. Si je d├®sire lŌĆÖobserver, elle aussi, il me faut prendre un point de vue ext├®rieur ├Ā ma propre activit├®. Tandis que lŌĆÖobservation des objets et ph├®nom├©nes et lŌĆÖacte de les penser sont absolument communs et remplissent notre vie courante, lŌĆÖobservation de la pens├®e est au contraire comme un ├®tat dŌĆÖexception. Voici un fait dont nous devons reconna├«tre toute lŌĆÖimportance, car il donne ├Ā la pens├®e sa vraie place par rapport aux autres objets dŌĆÖobservation. Le proc├®d├® que lŌĆÖon emploie pour observer la pens├®e serait un proc├®d├® normal si nous lŌĆÖappliquions ├Ā nŌĆÖimporte quel autre objet de lŌĆÖunivers, mais lorsquŌĆÖon lŌĆÖ├®tend ├Ā lŌĆÖ├®tude de la pens├®e, on sŌĆÖaffranchit, pour ainsi dire, de la marche normale des choses.
Une objection se pr├®sente : on trouvera peut-├¬tre que ce que je dis ici de la pens├®e serait tout aussi vrai du sentiment et des autres activit├®s spirituelles. Lorsque, par exemple, jŌĆÖ├®prouve de la joie, cette joie provient, elle aussi, dŌĆÖun objet ; lŌĆÖon trouvera que jŌĆÖobserve bien cet objet, mais non pas le sentiment de joie lui-m├¬me.
Cette objection repose sur une erreur. Car la joie ne se comporte pas du tout vis-├Ā-vis de son objet comme se comporte le concept forg├® par la pens├®e. Je suis absolument certain que le concept dŌĆÖune chose est produit en moi par ma propre activit├® ; mais si cette chose engendre en moi de la joie, cŌĆÖest ├Ā la mani├©re dont la chute dŌĆÖune pierre, par exemple, engendre certains r├®sultats sur le corps qui la re├¦oit. Pour lŌĆÖobservation, la joie est un fait qui sŌĆÖoffre au m├¬me titre que le ph├®nom├©ne qui la provoque ; je ne saurais en dire autant du concept. Je puis me demander pourquoi tel ou tel ph├®nom├©ne provoque en moi de la joie ; mais il serait absurde de me demander pourquoi il suscite en moi tel ou tel concept. Lorsque je r├®fl├®chis ├Ā un ├®v├®nement, il ne sŌĆÖagit aucunement dŌĆÖun effet que cet ├®v├®nement produit sur moi. Lorsque, par exemple, jŌĆÖai vu jeter une pierre contre une vitre et que jŌĆÖai con├¦u tous les concepts relatifs ├Ā cette suite de faits, je nŌĆÖai rien appris sur moi-m├¬me. Mais lorsque jŌĆÖai observ├® le sentiment quŌĆÖun ├®v├®nement provoque en moi, jŌĆÖai parfaitement acquis une nouvelle notion de ma personnalit├®. Dire dŌĆÖun objet : ┬½ceci est une rose┬╗, ce nŌĆÖest rien d├®clarer qui me concerne. Mais dire du m├¬me objet : ┬½ceci me cause de la joie┬╗, cŌĆÖest me caract├®riser moi-m├¬me dans mon rapport avec la rose.
Il ne peut donc ├¬tre question dŌĆÖ├®tablir une ├®quivalence entre la pens├®e et le sentiment, en ce qui regarde lŌĆÖobservation, pas plus quŌĆÖentre la pens├®e et les autres activit├®s de lŌĆÖ├óme. Toutes ces activit├®s occupent vis-├Ā-vis de la pens├®e le m├¬me rang que les divers objets et ph├®nom├©nes. Car un des caract├©res frappants de la pens├®e, cŌĆÖest quŌĆÖelle est une activit├® dirig├®e sur les autres objets, mais non point sur la personne pensante. Ceci se manifeste nettement par la mani├©re dissemblable dont nous exprimons, dŌĆÖune part, nos pens├®es, dŌĆÖautre part, nos sentiments et nos volitions. Lorsque je reconnais quŌĆÖun objet est une table, je ne me dis g├®n├®ralement pas ┬½je pense une table┬╗ mais : ┬½ceci est une table┬╗. Au contraire, je dis : ┬½je me r├®jouis de voir cette table┬╗. Dans le premier cas, il ne me vient pas ├Ā lŌĆÖid├®e dŌĆÖexprimer mon rapport personnel avec la table. Dans le second cas, cŌĆÖest le rapport seul qui mŌĆÖimporte.
Au cas o├╣ je me dis : ┬½je pense une table┬╗, jŌĆÖentre dans lŌĆÖ├®tat exceptionnel dont il a ├®t├® parl├® plus haut. Quelque chose qui est toujours compris dans mon activit├® spirituelle sans que je lŌĆÖobserve, devient soudainement lŌĆÖobjet de mon observation.
Le fait saillant en tout ceci, cŌĆÖest que la personnalit├® pensante oublie la pens├®e pendant le temps quŌĆÖelle lŌĆÖexerce. LŌĆÖobjet de sa pens├®e lŌĆÖoccupe, mais non sa pens├®e elle-m├¬me.
La premi├©re observation que nous puissions faire sur la pens├®e, cŌĆÖest celle-ci : elle est lŌĆÖ├®l├®ment inobserv├® de notre vie spirituelle ordinaire.
Pourquoi demeure-t-elle g├®n├®ralement inobserv├®e ? Parce quŌĆÖelle est issue de notre propre activit├®. Les choses que je nŌĆÖengendre pas moi-m├¬me se dressent en face de moi dŌĆÖune mani├©re objective. Je me per├¦ois dans mon opposition avec ces choses qui sont survenues sans mon aide. Elles viennent ├Ā ma rencontre. Il me faut les prendre comme conditions premi├©res de mon processus pensant. Tant que je mŌĆÖoccupe dŌĆÖelles, elles accaparent mon regard. Tant que jŌĆÖexerce sur elles ma facult├® pensante, mon attention se fixe, non point sur cette facult├® en exercice, mais sur elles qui lui fournissent un objet. En dŌĆÖautres termes : pendant que je pense, je ne vois pas ma pens├®e que jŌĆÖengendre, mais je vois les objets de ma pens├®e, que je nŌĆÖengendre pas.
M├¬me alors que jŌĆÖentre dans lŌĆÖ├®tat exceptionnel qui a ├®t├® d├®fini ci-dessus, et que je me mets ├Ā penser ├Ā ma pens├®e, les faits restent les m├¬mes : il mŌĆÖest impossible dŌĆÖobserver ma pens├®e actuelle. Je ne puis prendre, comme sujet de r├®flexion, que les exp├®riences faites au moment o├╣ je pensais. Pour quŌĆÖil en soit autrement, il faudrait que je me scinde en deux personnalit├®s : lŌĆÖune qui penserait, lŌĆÖautre qui la regarderait penser. Cela, je ne le puis. Les deux actes ne se peuvent accomplir que s├®par├®ment. La pens├®e que je me propose dŌĆÖobserver nŌĆÖest jamais celle qui va sŌĆÖexercer pour cette observation, mais une autre : ce sera, si je veux, la pens├®e que jŌĆÖai eue ant├®rieurement, ou encore le processus pensant tel que je puis le suivre chez une autre personne, ou enfin un processus fictif, tel quŌĆÖon en a pos├® un, tout au d├®but de ce chapitre (lŌĆÖexemple des boules de billard).
Il y a deux actes qui sŌĆÖexcluent mutuellement : engendrer une chose, et sŌĆÖopposer ├Ā cette chose dans la lumi├©re de la connaissance. Cette incompatibilit├® trouve d├®j├Ā son expression dans la Gen├©se, o├╣ Dieu emploie six jours ├Ā cr├®er le monde ; et cŌĆÖest seulement lorsque le monde est fait que Dieu acquiert la possibilit├® de le contempler.
Il en va de m├¬me pour notre pens├®e. Il faut quŌĆÖelle soit l├Ā, avant que nous puissions commencer ├Ā lŌĆÖobserver.
De cette particularit├® m├¬me, il r├®sulte que notre pens├®e nous semble ├¬tre une activit├® plus imm├®diate et plus intime que toute autre. La produisant nous-m├¬mes, nous connaissons enti├©rement les caract├®ristiques de son devenir. Pour tous les autres domaines dŌĆÖobservation, nous ne pouvons trouver que m├®diatement les rapports effectifs des choses, les relations entre les parties s├®par├®es. Ici, au contraire, nous les saisissons de la mani├©re la plus imm├®diate. Je ne sais pas, dŌĆÖabord, pourquoi la perception du tonnerre suit celle de lŌĆÖ├®clair ; mais pourquoi le concept de tonnerre est li├® ├Ā celui dŌĆÖ├®clair, cela r├®sulte du contenu m├¬me de ces deux pens├®es. Peu importe que jŌĆÖaie du tonnerre et de lŌĆÖ├®clair des concepts vrais ou faux, ceux que jŌĆÖai mŌĆÖapparaissent dans un rapport bien clair, et qui d├®coule de leur nature m├¬me.
Cette clart├®, cette transparence inh├®rentes aux ph├®nom├©nes de la pens├®e, ne d├®pendent pas de la connaissance que nous avons, ou que nous nŌĆÖavons pas, de leur substratum physiologique. Il sŌĆÖagit ici de la pens├®e telle quŌĆÖelle se pr├®sente ├Ā lŌĆÖintrospection spirituelle. LŌĆÖencha├«nement des ph├®nom├©nes mat├®riels qui se produisent dans mon cerveau tandis que je pense nŌĆÖa rien ├Ā voir avec ce qui nous occupe. Ce que jŌĆÖobserve nŌĆÖest pas le processus mat├®riel qui, dans mon cerveau, sert ├Ā relier les deux concepts de tonnerre et dŌĆÖ├®clair. CŌĆÖest ce qui mŌĆÖam├©ne ├Ā mettre ces concepts dans une certaine relation. Or, pour ├®tablir cette relation, la seule chose qui me guide est le contenu m├¬me de mes pens├®es. Ce ne peut ├¬tre, en aucun cas, le processus mat├®riel dont mon cerveau est le si├©ge.
Cette remarque serait tout ├Ā fait superflue si nous ne vivions ├Ā une ├®poque aussi mat├®rialiste. Actuellement, il y a des gens qui raisonnent comme suit : ┬½Lorsque nous saurons ce quŌĆÖest la mati├©re, nous saurons aussi comment la mati├©re pense.┬╗ Pour ceux-l├Ā, il est n├®cessaire dŌĆÖaffirmer quŌĆÖon peut parler de la pens├®e sans heurter aussit├┤t les conceptions de la physiologie c├®r├®brale. Beaucoup de nos contemporains ont de la difficult├® ├Ā embrasser le concept de ┬½pens├®e┬╗ dans toute sa puret├®. Celui qui, en face de lŌĆÖimage que jŌĆÖen donne ici, dresse lŌĆÖaphorisme de Cabanis : ┬½Le cerveau secr├©te les pens├®es comme le foie secr├©te la bile...┬╗, prouve simplement quŌĆÖil ignore ce dont je parle. Celui-l├Ā pr├®tend trouver la pens├®e par un simple processus dŌĆÖobservation, comme il le ferait pour un objet quelconque. Mais il ne saurait y r├®ussir, car elle ├®chappe forc├®ment ├Ā lŌĆÖobservation normale. LorsquŌĆÖon nŌĆÖarrive pas ├Ā se lib├®rer du mat├®rialisme, cŌĆÖest quŌĆÖon est incapable dŌĆÖentrer dans lŌĆÖ├®tat exceptionnel qui a ├®t├® caract├®ris├® plus haut, et de prendre conscience de lŌĆÖactivit├® g├®n├®ralement inobserv├®e, sous-entendue, quŌĆÖest la pens├®e. Tant quŌĆÖon ne sera pas dispos├® ├Ā se placer ├Ā ce point de vue, on sera aussi peu apte ├Ā parler dŌĆÖelle quŌĆÖun aveugle ├Ā parler des couleurs. Mais quŌĆÖon nŌĆÖaille pas sŌĆÖimaginer que lorsque nous parlons de concepts, ce peuvent ├¬tre, ├Ā nos yeux, des ph├®nom├©nes physiologiques. Le mat├®rialiste ne sŌĆÖexplique pas la pens├®e, pour la raison bien simple quŌĆÖil ne la voit m├¬me pas.
Cependant, tout ├¬tre humain, normalement dou├®, peut arriver ├Ā lŌĆÖobserver, sŌĆÖil y met de la bonne volont├®. Et cŌĆÖest l├Ā lŌĆÖexp├®rience la plus importante quŌĆÖil lui soit donn├® de faire. Car il saisit alors une chose dont lui-m├¬me est lŌĆÖauteur. Il cesse de sŌĆÖopposer ├Ā un objet ├®tranger, pour se trouver en face de sa propre activit├®. Cette chose quŌĆÖil observe, il sait comment elle se produit. Les circonstances et les relations, tout lui est transparent. Il a gagn├® un sol ferme, un point de d├®part certain, et, d├©s lors, il lui est permis dŌĆÖesp├®rer une explication du reste de lŌĆÖunivers.
CŌĆÖest ce sentiment qui a dict├® au fondateur de la philosophie moderne, ├Ā Ren├® Descartes, son principe de toutes les connaissances humaines : Je pense, donc je suis. Toutes les autres choses que la pens├®e, tout le reste de lŌĆÖunivers, existent sans moi et je ne puis savoir si leur existence est r├®alit├®, illusion ou r├¬ve. Mais je sais quŌĆÖune chose est certaine parce que je lui donne moi-m├¬me une existence certaine : ma pens├®e. QuŌĆÖelle ait une autre origine encore, quŌĆÖelle provienne de Dieu, par exemple, peu mŌĆÖimporte ici : je sais, ├Ā coup s├╗r, que ma pens├®e existe en tant quŌĆÖelle est issue de moi. Toute autre interpr├®tation de ce principe est, de prime abord, injustifi├®e. Tout ce que Descartes pouvait affirmer, cŌĆÖ├®tait quŌĆÖau sein du devenir universel il se saisissait lui-m├¬me dans sa pens├®e comme dans son activit├® personnelle et originelle.
Le sens de la petite conclusion : ┬½donc je suis┬╗ a ├®t├® discut├® bien souvent. Elle ne nous para├«t valable quŌĆÖ├Ā une condition, qui est de lŌĆÖexpliquer comme suit : La plus simple d├®claration quŌĆÖon puisse faire au sujet dŌĆÖune chose, cŌĆÖest de dire que cette chose est, quŌĆÖelle existe. Mais pr├®ciser ce quŌĆÖest cette existence, voil├Ā ce quŌĆÖon ne peut imm├®diatement pour aucun des objets de lŌĆÖexp├®rience usuelle. Pour savoir ├Ā quel titre on doit les consid├®rer comme existants, il faut rechercher leurs rapports avec dŌĆÖautres objets. Une exp├®rience peut ├¬tre une somme de perceptions, mais elle peut ├¬tre aussi un r├¬ve, une hallucination, etc.. Bref, je ne puis pas dire ├Ā quel point elle existe, tant que je ne lŌĆÖai pas mise en rapport avec dŌĆÖautres exp├®riences. Et tout ce que jŌĆÖarrive ├Ā conna├«tre alors, cŌĆÖest ce rapport, rien de plus. Je nŌĆÖobtiendrai une solution plus ferme que lorsque jŌĆÖaurai trouv├® un objet qui, de lui-m├¬me, me fournira la certitude de son existence. Cet objet, je le suis moi-m├¬me lorsque je pense, car je donne alors ├Ā mon existence le contenu le plus certain, celui qui nŌĆÖest bas├® que sur lui-m├¬me : ce contenu, cŌĆÖest lŌĆÖactivit├® pensante. D├©s lors, je puis poursuivre mes recherches en partant de ce point de vue, et me demander si les autres objets existent dans le m├¬me sens que ma pens├®e, ou autrement.
Lorsque nous faisons de notre pens├®e lŌĆÖobjet de notre observation, le cercle habituel de nos exp├®riences sŌĆÖaugmente de quelque chose qui jusquŌĆÖalors nous ├®chappait. Mais notre attitude vis-├Ā-vis des autres choses ne se transforme pas. Le nombre de nos objets dŌĆÖobservation a chang├®, mais non point notre m├®thode. Tant que nous continuons ├Ā consid├®rer le reste du monde, il se m├¬le au devenir universel (dans lequel je comprends lŌĆÖacte dŌĆÖobserver) un processus inaper├¦u. Il y a l├Ā un ├®l├®ment qui diff├©re de tout le reste du devenir, et dont nous ne tenons pas compte. Mais alors que nous nous mettons ├Ā consid├®rer notre pens├®e elle-m├¬me, aucun ├®l├®ment inobserv├® ne subsiste. Car ce qui occupe alors lŌĆÖarri├©re-plan de notre pens├®e, cŌĆÖest encore et toujours la pens├®e. LŌĆÖobjet que lŌĆÖon consid├©re, et lŌĆÖactivit├® qui sŌĆÖoriente sur lui, sont qualitativement les m├¬mes. Ceci est une nouvelle caract├®ristique de la pens├®e : pour lŌĆÖobserver, il nŌĆÖest point besoin dŌĆÖemployer une activit├® qualitativement diff├®rente dŌĆÖelle : on demeure dans un seul et m├¬me ├®l├®ment.
Lorsque jŌĆÖintroduis dans le r├®seau de mes pens├®es un objet ext├®rieur, je d├®passe les limites de mon observation, et je suis en droit de me demander si cŌĆÖest ├Ā juste titre : pourquoi nŌĆÖai-je pas laiss├® lŌĆÖobjet agir simplement sur moi ? quels rapports r├®els a-t-il avec ma pens├®e ? Ces questions, que tout homme peut se poser tant quŌĆÖil applique sa pens├®e aux objets ext├®rieurs, tombent d├©s que cette pens├®e sŌĆÖexerce sur elle-m├¬me. Car, dans ce cas, on ne lui ajoute rien qui lui soit ├®tranger, et il est inutile de se justifier.
Schelling dit : Conna├«tre la nature, cŌĆÖest la cr├®er. Prendre ├Ā la lettre cette parole de lŌĆÖaudacieux philosophe, ce serait renoncer pour toujours ├Ā la connaissance de la nature. Car elle se trouve devant nous, toute faite, et, pour la cr├®er une seconde fois, il faudrait dŌĆÖabord poss├®der les principes selon lesquels elle le fut une premi├©re. Cette seconde nature que lŌĆÖon voudrait cr├®er, il faudrait emprunter les conditions de son existence ├Ā la nature actuellement donn├®e. Cette ├®tude qui pr├®c├®derait lŌĆÖacte cr├®ateur, ce serait pr├®cis├®ment la connaissance de la nature, et cela, m├¬me au cas o├╣, la le├¦on apprise, on renoncerait ├Ā cr├®er. Sans connaissance pr├®alable, on ne pourrait cr├®er quŌĆÖune Nature non donn├®e actuellement. Mais ce qui est impossible quant ├Ā la nature la cr├®ation pr├®c├®dant la connaissance, est au contraire de r├©gle quant ├Ā la pens├®e. Si nous voulons attendre, pour penser, que la pens├®e nous soit connue, nous nŌĆÖy arriverons jamais. Il faut commencer par se mettre r├®solument ├Ā penser, et, ensuite, gr├óce ├Ā lŌĆÖobservation de ce quŌĆÖon a fait, on en vient ├Ā conna├«tre lŌĆÖactivit├® pensante. Il faut dŌĆÖabord cr├®er lŌĆÖobjet, puis lŌĆÖobserver. Pour tous les autres objets de lŌĆÖunivers cŌĆÖest le contraire qui arrive, car leur pr├®sence est fournie la premi├©re et sans notre aide.
Lorsque je dis : il faut penser avant de pouvoir observer la pens├®e, on pourrait me r├®pondre quŌĆÖil faut ├®galement dig├®rer avant de pouvoir observer le processus de la digestion. Cette objection rappellerait celle que Pascal fit ├Ā Descartes, ├Ā savoir quŌĆÖon peut dire aussi : Je me prom├©ne, donc je suis. Certes, il nous est n├®cessaire de dig├®rer avant que nous ayons ├®tudi├® le processus physiologique de la digestion. Mais pour quŌĆÖon puisse comparer ce fait ├Ā celui que jŌĆÖai ├®nonc├® plus haut, il faudrait quŌĆÖil f├╗t question, non pas de penser la digestion, mais de la manger, de la dig├®rer ! Il est pr├®cis├®ment impossible de faire de la digestion un objet de digestion, tandis quŌĆÖon fait de la pens├®e un objet de pens├®e.
Il est donc incontestable que la pens├®e est une apparition dŌĆÖun genre unique : l├Ā, le devenir universel nous appartient, il d├®pend de nous, et, sans nous, rien ne surviendrait. CŌĆÖest cela qui nous importe tellement, car le caract├©re ├®nigmatique des choses ext├®rieures provient de ce que nous ne participons pas ├Ā leur venue au monde nous les trouvons toutes donn├®es. Par contre, nous savons parfaitement comment la pens├®e vient au monde et comment elle se fait. CŌĆÖest donc en elle quŌĆÖon trouvera le point de d├®part vraiment primitif pour la consid├®ration du reste de lŌĆÖunivers.
QuŌĆÖon me permette de signaler encore une erreur tr├©s r├®pandue, qui est de pr├®tendre que la pens├®e ┬½en soi┬╗ nŌĆÖest donn├®e nulle part : lŌĆÖactivit├® qui relie nos observations les unes aux autres, et les entrem├¬le dŌĆÖun r├®seau de concepts, ne serait aucunement celle que nous isolons ensuite pour lŌĆÖexaminer ; il faudrait distinguer ce que lŌĆÖon m├¬le dŌĆÖabord inconsciemment au devenir, ce quŌĆÖon isole ensuite consciemment.
En raisonnant de la sorte, on omet quŌĆÖon se trouve dans lŌĆÖimpossibilit├® absolue de sortir de la pens├®e : il nŌĆÖexiste aucun moyen de se d├®gager dŌĆÖelle, lorsquŌĆÖon veut la consid├®rer. Distinguer la pens├®e ant├®rieurement consciente de la pens├®e post├®rieurement consciente, cŌĆÖest faire une diff├®rence toute ext├®rieure, qui ne concerne pas la chose elle-m├¬me. Je ne change pas une chose par le fait que jŌĆÖy applique ma pens├®e. Un ├¬tre qui diff├®rerait profond├®ment de moi par ses organes des sens et par son intelligence pourrait avoir dŌĆÖun cheval une autre repr├®sentation que moi ; mais je ne puis croire, en aucun cas, que ma pens├®e soit, elle aussi, un objet qui se modifie du fait quŌĆÖil est soumis ├Ā mon observation. Je contemple moi-m├¬me ce que jŌĆÖaccomplis moi-m├¬me. Il ne sŌĆÖagit pas de savoir comment ma pens├®e se comporte vis-├Ā-vis dŌĆÖune autre intelligence, mais vis-├Ā-vis de moi. DŌĆÖailleurs, lŌĆÖimage de ma pens├®e ne peut ├¬tre plus vraie dans une autre intelligence que dans la mienne. Si je nŌĆÖ├®tais pas moi-m├¬me lŌĆÖ├¬tre pensant, si la pens├®e se pr├®sentait devant moi comme lŌĆÖactivit├® dŌĆÖun autre ├¬tre, alors je pourrais dire que lŌĆÖimage de la pens├®e se forme en moi dans telles ou telles conditions, et je nŌĆÖarriverais jamais ├Ā savoir ce que la pens├®e de cet autre ├¬tre serait v├®ritablement.
Contempler ma pens├®e dŌĆÖun point de vue ext├®rieur ├Ā elle-m├¬me, cŌĆÖest une chose dont je ne puis avoir nulle occasion. Ne contempl├®-je pas tout le reste de lŌĆÖunivers gr├óce ├Ā son aide ? Comment ferais-je exception en ce qui la concerne ?
JŌĆÖen ai assez dit pour me croire autoris├® dor├®navant ├Ā consid├®rer lŌĆÖunivers ├Ā partir de la pens├®e. Lorsque Archim├©de eut invent├® le levier, il crut pouvoir soulever le cosmos entier, ├Ā condition dŌĆÖavoir un point dŌĆÖappui pour son outil. Il lui fallait une chose qui se support├ót dŌĆÖelle-m├¬me et sans aucune aide. Telle est la pens├®e, elle existe par elle-m├¬me. Reste ├Ā savoir si, gr├óce ├Ā elle, les autres choses deviendront compr├®hensibles.
JusquŌĆÖici, jŌĆÖai parl├® de la pens├®e sans faire allusion ├Ā la conscience humaine qui en est le porteur. La plupart des philosophes contemporains mŌĆÖobjecteront ceci : ┬½Avant quŌĆÖil y ait pens├®e, il faut quŌĆÖil y ait conscience. Vous devez donc prendre votre point de d├®part dans la conscience.┬╗ Voici ce que je leur r├®pondrai : ┬½Pour mŌĆÖexpliquer le rapport qui existe entre la conscience et la pens├®e, il faut que je pense ce rapport. Je pose donc la pens├®e avant tout┬╗. ├Ć ceci on pourra r├®pliquer : ┬½Le philosophe qui veut comprendre la pens├®e la pose au d├®but, mais, dans le cours habituel de la vie, la pens├®e na├«t dans la conscience et, par cons├®quent, apr├©s cette derni├©re┬╗. Si cette r├®plique sŌĆÖadressait au cr├®ateur de lŌĆÖunivers, elle serait parfaitement juste ; on ne peut ├®videmment faire appara├«tre la pens├®e sans avoir cr├®├® dŌĆÖabord la conscience. Mais le philosophe nŌĆÖest pas charg├® de cr├®er le monde, il doit seulement le comprendre. Il lui faut rechercher, par cons├®quent, non point les principes de la cr├®ation, mais ceux de la compr├®hension. Il serait ├®trange quŌĆÖon reproch├ót au philosophe de se pr├®occuper avant tout de la justesse de ses principes, plut├┤t que dŌĆÖaborder imm├®diatement les objets quŌĆÖil veut comprendre. Le Cr├®ateur, certes, avait ├Ā savoir comment il donnerait un porteur ├Ā la pens├®e, mais le philosophe a tout dŌĆÖabord ├Ā se trouver un point dŌĆÖappui, un point de d├®part inattaquable dŌĆÖo├╣ il puisse marcher ├Ā la compr├®hension des choses. Serions-nous vraiment avanc├®s si, partant de la conscience, nous soumettions celle-ci ├Ā lŌĆÖexamen de la pens├®e sans savoir si cette derni├©re est qualifi├®e pour comprendre quoi que ce soit ?
Il nous faut, avant tout autre ├®tude, consid├®rer la pens├®e dŌĆÖune fa├¦on tout ├Ā fait neutre, sans la rapporter ├Ā un sujet pensant ni ├Ā un objet pens├®, car sujet et objet sont des concepts form├®s d├®j├Ā par cette pens├®e. Il est ind├®niable quŌĆÖavant de comprendre quoi que ce soit, il faut comprendre la pens├®e. Le contester, cŌĆÖest oublier quŌĆÖon est un ├¬tre humain, cŌĆÖest-├Ā-dire non point le premier terme de la cr├®ation, mais le dernier. On ne peut, ├Ā cause de cela, pour sŌĆÖexpliquer le monde, partir de ce qui fut son origine dans le temps, mais il faut sŌĆÖadresser au contraire ├Ā ce que nous trouvons, nous hommes, de plus intime et de plus proche. Impossible de nous transporter dŌĆÖun bond au commencement du monde pour y entreprendre notre ├®tude. Il faut partir de lŌĆÖinstant pr├®sent et tenter de remonter le cours des temps. Tant que les g├®ologues, pour expliquer lŌĆÖ├®tat actuel de la terre, parlaient de ┬½r├®volutions┬╗ pass├®es, plus ou moins imaginaires, leur science t├ótonna dans lŌĆÖobscurit├®. Mais d├©s quŌĆÖils se mirent ├Ā ├®tudier les ph├®nom├©nes dont le globe est actuellement le si├©ge, ils purent en d├®duire nettement lŌĆÖhistoire du pass├®. De m├¬me, la philosophie restera dans le vague tant quŌĆÖelle admettra toutes sortes de principes premiers, tels que lŌĆÖatome, le mouvement, la mati├©re, la volont├®, lŌĆÖinconscient. Elle nŌĆÖatteindra son but que lorsquŌĆÖelle prendra comme terme initial ce qui, dans le temps, est le terme dernier. Or, ce terme dernier de lŌĆÖ├®volution universelle, cŌĆÖest la pens├®e.
Il y aura des gens pour objecter que la justesse ou la fausset├® de nos pens├®es sont choses impossibles ├Ā certifier, et que, par cons├®quent, notre point de d├®part est suspect. CŌĆÖest l├Ā faire preuve dŌĆÖun aussi maigre bon sens que si lŌĆÖon se demandait, pris de scrupules : Cet arbre est-il juste ou faux ? La pens├®e est un fait. Parler de la justesse ou de la fausset├® dŌĆÖun fait, cŌĆÖest un non-sens. Tout ce quŌĆÖon peut faire, cŌĆÖest douter que la pens├®e soit employ├®e avec justesse, comme on peut douter quŌĆÖun arbre fournisse du bon bois pour la fabrication dŌĆÖun outil vraiment pratique. JusquŌĆÖ├Ā quel point lŌĆÖapplication de notre pens├®e au monde est-elle juste, cŌĆÖest l├Ā pr├®cis├®ment ce que nous nous proposons dŌĆÖ├®tudier dans cet ouvrage. Nous comprenons parfaitement quŌĆÖon se demande si la pens├®e est bien capable de nous faire savoir quelque chose de lŌĆÖunivers r├®el mais nous ne saurions comprendre que lŌĆÖon doute de la justesse de la pens├®e elle-m├¬me.
4. Le monde comme perception
La pens├®e donne naissance ├Ā des concepts et ├Ā des id├®es.
QuŌĆÖest-ce quŌĆÖun concept ? On ne peut en donner la d├®finition. On peut seulement faire remarquer ├Ā lŌĆÖhomme quŌĆÖil a des concepts. Lorsque quelquŌĆÖun voit un arbre, sa pens├®e r├®agit sur son observation ; ├Ā lŌĆÖobjet sŌĆÖadjoint une sorte de pendant id├®el, et lŌĆÖhomme consid├©re que cet objet et son pendant id├®el sŌĆÖappartiennent lŌĆÖun ├Ā lŌĆÖautre.
Lorsque lŌĆÖobjet dispara├«t du champ dŌĆÖobservation, son pendant id├®el demeure seul pr├®sent. CŌĆÖest le concept de cet objet. Plus notre exp├®rience sŌĆÖaccro├«t, plus la somme de nos concepts sŌĆÖaugmente. Mais les concepts ne sont pas isol├®s les uns des autres. Ils se relient pour former un tout harmonieux. Par exemple, le concept ┬½organisme┬╗ est reli├® ├Ā ceux dŌĆÖ┬½├®volution r├®guli├©re┬╗, de ┬½croissance┬╗. DŌĆÖautres concepts, form├®s ├Ā lŌĆÖobservation dŌĆÖobjets particuliers, se fondent enti├©rement en un seul. Par exemple, tous les concepts que jŌĆÖai pu me former des lions forment le concept global de ┬½lion┬╗. CŌĆÖest de la sorte que les concepts isol├®s se rassemblent en un syst├©me conceptuel total, en lequel chacun dŌĆÖeux occupe une place d├®termin├®e. Les id├®es ne diff├©rent pas qualitativement des concepts. Elles sont seulement des concepts plus riches, plus amples. Je tiens essentiellement ├Ā faire remarquer ici que je nŌĆÖai pas pris mon point de d├®part philosophique dans les concepts ni dans les id├®es que la pens├®e acquiert, mais dans la pens├®e elle-m├¬me. Les concepts, les id├®es, pr├®supposent lŌĆÖexistence de la pens├®e. On ne saurait donc ├®tendre aux concepts ni aux id├®es ce que jŌĆÖai dit de la nature absolument irr├®ductible et spontan├®e de la pens├®e. (JŌĆÖinsiste sur ce point parce que cŌĆÖest l├Ā que je me s├®pare de Hegel. Celui-ci pose le concept comme un terme premier irr├®ductible.)
Le concept ne saurait ├¬tre tir├® de lŌĆÖobservation. Ceci ressort, d├©s lŌĆÖabord, du fait que lŌĆÖhomme en voie de croissance ne se forme que peu ├Ā peu les concepts correspondant aux objets qui lŌĆÖentourent. Les concepts sŌĆÖajoutent ├Ā lŌĆÖobservation.
Un philosophe qui est actuellement tr├©s lu, Herbert Spencer, d├®crit comme suit le processus spirituel qui sŌĆÖaccomplit en nous lors dŌĆÖune observation : ┬½Lorsque, par une journ├®e de septembre, en nous promenant dans les champs, nous entendons un bruit ├Ā quelques pas devant nous, et quŌĆÖaupr├©s du foss├® dont ce bruit semblait venir, nous voyons lŌĆÖherbe se mouvoir, il y a toutes les chances pour que nous allions voir de plus pr├©s ce qui a bien pu causer ce bruit et ce mouvement. ├Ć notre approche, une perdrix sŌĆÖenvole du foss├®, et d├©s lors notre curiosit├® est satisfaite nous avons ce que nous appelons lŌĆÖexplication du ph├®nom├©ne. Cette explication, remarquons-le bien, sŌĆÖobtient comme suit : nous avons observ├® dŌĆÖinnombrables fois, dans la vie, que des perturbations survenant dans la position des corps de petite taille sont accompagn├®es du mouvement des corps plus grands qui se trouvent parmi eux, et parce que nous avons g├®n├®ralis├® ce rapport entre ces perturbations et ce mouvement, nous trouvons que la perturbation particuli├©re dont il sŌĆÖagit ici est expliqu├®e d├©s quŌĆÖelle se r├®v├©le comme un cas sp├®cial de notre g├®n├®ralisation.┬╗
Mais ├Ā lŌĆÖexaminer de pr├©s, la chose se passe tout autrement quŌĆÖHerbert Spencer ne le d├®crit. Lorsque jŌĆÖentends un bruit, je cherche tout dŌĆÖabord le concept correspondant ├Ā cette observation. CŌĆÖest ce concept seulement qui mŌĆÖinvite ├Ā d├®passer mon observation. Celui qui ne r├®fl├®chit pas, ├®coute simplement le bruit et se trouve satisfait. Mais, gr├óce ├Ā la r├®flexion, je sais quŌĆÖil faut voir en ce bruit un effet de quelque chose. Donc, cŌĆÖest seulement lorsque jŌĆÖai uni le concept dŌĆÖeffet ├Ā celui de mon observation, que je me sens port├® ├Ā d├®passer cette observation et ├Ā chercher sa cause. Le concept dŌĆÖeffet appelant celui de cause, je me mets ├Ā chercher lŌĆÖobjet-cause, et je trouve la perdrix. Or, ces concepts dŌĆÖeffet et de cause, je ne puis aucunement les avoir tir├®s de la simple observation, f├╗t-elle ├®tendue ├Ā des milliers de cas. LŌĆÖobservation suscite la pens├®e, mais cŌĆÖest seulement cette derni├©re qui nous apprend ├Ā relier nos exp├®riences les unes aux autres.
LorsquŌĆÖon exige dŌĆÖune ┬½science strictement objective┬╗ quŌĆÖelle ne puise ses donn├®es quŌĆÖ├Ā lŌĆÖobservation, on exige en m├¬me temps quŌĆÖelle renonce ├Ā toute pens├®e. Car cette derni├©re tend, de par sa nature, ├Ā d├®passer les r├®sultats de lŌĆÖobservation.
Il nous faut ├Ā pr├®sent transporter notre ├®tude, de la pens├®e, ├Ā lŌĆÖ├¬tre qui pense. Car cŌĆÖest par ce dernier que la pens├®e est reli├®e ├Ā lŌĆÖobservation. La conscience humaine est le champ sur lequel se rencontrent concept et observation, et sur lequel ils se rattachent lŌĆÖun ├Ā lŌĆÖautre. Ceci est, en m├¬me temps, la caract├®ristique de cette conscience humaine. Elle est la m├®diatrice entre la pens├®e et lŌĆÖobservation. Tant quŌĆÖil observe les objets, lŌĆÖhomme aper├¦oit ces objets comme donn├®s ; lorsquŌĆÖil pense, il sŌĆÖaper├¦oit lui-m├¬me comme une activit├®. Il consid├©re donc, dŌĆÖune part, le monde des objets, de lŌĆÖautre, son sujet pensant. CŌĆÖest parce quŌĆÖil dirige sa pens├®e sur les donn├®es de son observation, quŌĆÖil a la conscience des objets ; et cŌĆÖest parce quŌĆÖil la dirige sur lui-m├¬me quŌĆÖil a la conscience de lui-m├¬me, ou conscience du moi. La conscience humaine est n├®cessairement une conscience du moi, parce quŌĆÖelle est une conscience pensante. Car, lorsque la pens├®e dirige son regard sur sa propre activit├®, elle trouve, devant elle, comme objet, son ├¬tre le plus intime et le plus irr├®ductible, autrement dit son sujet.
Ne manquons pas de remarquer que si nous pouvons nous d├®finir comme un sujet, et nous opposer aux objets, cŌĆÖest seulement gr├óce ├Ā lŌĆÖaide de la pens├®e. Par cons├®quent, la pens├®e ne doit pas ├¬tre consid├®r├®e comme une activit├® uniquement subjective. La pens├®e est au del├Ā du sujet et de lŌĆÖobjet. Elle forme ces deux concepts comme elle forme tous les autres. Donc, lorsqu'en notre qualit├® de sujet pensant, nous rapportons un concept ├Ā un objet, nous nŌĆÖavons pas le droit de croire que ce rapport est seulement subjectif. Ce nŌĆÖest pas le sujet qui ├®tablit ce rapport, cŌĆÖest la pens├®e. Si le sujet pense, ce nŌĆÖest pas pour la raison quŌĆÖil est un sujet ; au contraire, cŌĆÖest parce quŌĆÖil est capable de penser quŌĆÖil peut sŌĆÖappara├«tre sous lŌĆÖaspect dŌĆÖun sujet. Par cons├®quent, lŌĆÖactivit├® que lŌĆÖhomme exerce en qualit├® dŌĆÖ├¬tre pensant nŌĆÖest pas une activit├® seulement subjective ; elle nŌĆÖest ├Ā vrai dire ni subjective ni objective elle plane au-dessus de ces deux concepts. Je nŌĆÖai aucunement le droit de dire que mon sujet individuel pense, mais bien plut├┤t quŌĆÖil existe gr├óce ├Ā la pens├®e. Celle-ci est, pour ainsi dire, un ├®l├®ment qui mŌĆÖentra├«ne au del├Ā de mon moi et qui me relie aux objets. Et elle mŌĆÖa s├®par├® dŌĆÖeux du m├¬me coup, en mŌĆÖopposant ├Ā eux sous lŌĆÖaspect de sujet.
CŌĆÖest l├Ā-dessus que se fonde la double nature de lŌĆÖhomme : par la pens├®e il sŌĆÖembrasse lui-m├¬me ainsi que tout lŌĆÖunivers. Mais, en m├¬me temps, lŌĆÖacte de penser le d├®termine lui-m├¬me en face de cet univers, dans son r├┤le dŌĆÖindividu.
La question qui se pose maintenant est celle-ci : lŌĆÖautre ├®l├®ment, que nous avons simplement nomm├® jusquŌĆÖici lŌĆÖobjet de lŌĆÖobservation, et qui doit se rencontrer avec la pens├®e dans le champ de la conscience humaine, comment p├®n├©tre-t-il dans cette conscience ?
Pour r├®pondre ├Ā cette question, il nous faut ├®loigner de notre champ dŌĆÖobservation tout ce que la pens├®e y a d├®j├Ā apport├®. Car notre conscience de chaque instant est travers├®e par des concepts de toutes sortes.
Il faut nous repr├®senter un ├¬tre pourvu dŌĆÖune intelligence humaine pleinement ├®volu├®e, mais sortant du n├®ant et se trouvant soudain plac├® en face du monde ext├®rieur. Ce dont il prendrait connaissance avant que sa pens├®e nŌĆÖentre en activit├®, cela constitue le contenu purement perceptif de lŌĆÖunivers. Cet ├¬tre percevrait un agr├®gat de sensations qui demeureraient tout dŌĆÖabord sans relation les unes avec les autres : couleurs, sons, pressions, chaleur, go├╗t, odeur ; puis des sentiments de plaisir et de d├®plaisir. Cet agr├®gat est le r├®sultat de la pure observation ; de lŌĆÖautre c├┤t├®, la pens├®e nŌĆÖattend que de trouver un point de d├®part pour se d├®velopper. Ce point de d├®part ne tarde pas ├Ā se pr├®senter. La pens├®e est apte ├Ā ├®tablir des liens dŌĆÖun ├®l├®ment per├¦u ├Ā un autre ├®l├®ment per├¦u. Elle rattache ├Ā ces ├®l├®ments certains concepts, et, par-l├Ā, les met en rapport. Nous en avons vu un exemple dans le cas du bruit per├¦u, que nous mettons en rapport avec une autre perception, par le fait que nous le nommons cause de cette seconde perception.
Lorsque nous aurons rappel├® que lŌĆÖactivit├® pensante ne saurait aucunement ├¬tre consid├®r├®e comme une activit├® subjective, nous aurons ├®cart├® toute tentation dŌĆÖattribuer ├Ā ces rapports, ├®tablis par elle, une valeur purement subjective.
Il sŌĆÖagit ├Ā pr├®sent de trouver la relation qui peut unir le contenu perceptible imm├®diatement donn├®, tel que nous lŌĆÖavons d├®fini plus haut, et notre sujet conscient.
Comme certains termes demeurent entach├®s dŌĆÖincertitude, je crois utile de mŌĆÖentendre ici avec le lecteur sur le sens dans lequel je vais prendre, dans ce qui suit, le mot : ┬½perception┬╗. JŌĆÖentends par l├Ā les objets imm├®diats dont je parlais plus haut, dans la mesure o├╣ le sujet conscient en prend connaissance par une observation. Ainsi, je ne d├®signe point sous cette appellation le processus de lŌĆÖobservation, mais son objet.
Je ne choisis pas, ├Ā sa place, le mot : ┬½sensation┬╗, parce quŌĆÖil a en physiologie un certain sens moins ├®tendu que ce que jŌĆÖentends par ┬½perception┬╗. Un sentiment que jŌĆÖ├®prouve, par exemple, me fournit parfaitement une perception, mais non point une sensation au sens physiologique. Je ne prends connaissance de ma vie sentimentale (affective) que lorsquŌĆÖelle me devient une perception. Et le mode suivant lequel nous prenons connaissance de notre pens├®e est de telle sorte que nous pourrions ├®galement nommer la pens├®e une perception, lors de sa premi├©re apparition dans notre conscience.
LŌĆÖhomme non pr├®venu consid├©re ses perceptions, telles quŌĆÖelles lui apparaissent, comme des choses menant ├Ā part lui une existence tout ├Ā fait ind├®pendante. LorsquŌĆÖil voit un arbre, il croit tout dŌĆÖabord que cet arbre se tient r├®ellement, avec la forme et les couleurs quŌĆÖil lui voit, au lieu sur lequel il dirige son regard. Lorsque ce m├¬me homme voit le soleil appara├«tre au matin sous la forme dŌĆÖun disque ├®lev├® sur lŌĆÖhorizon, et quŌĆÖensuite il suit des yeux le cours de ce disque, il croit que tout se passe (en soi) comme il lŌĆÖobserve. Cette croyance ne sŌĆÖalt├©re que lorsque apparaissent de nouvelles perceptions qui contredisent les premi├©res. LŌĆÖenfant, qui n'a point lŌĆÖexp├®rience des distances, tend la main vers la lune, et il ne remet sa premi├©re impression au point que lorsquŌĆÖune seconde impression vient la d├®mentir. Chaque amplification de mon champ dŌĆÖexp├®rience mŌĆÖoblige ├Ā corriger lŌĆÖimage que jŌĆÖai de lŌĆÖunivers, et cette loi se manifeste aussi bien dans la vie quotidienne de lŌĆÖhomme que dans son ├®volution spirituelle. LŌĆÖimage que les anciens se faisaient du rapport de la terre au soleil, et aux autres corps c├®lestes, dut ├¬tre corrig├®e par Copernic parce quŌĆÖelle ne sŌĆÖaccordait plus avec certaines nouvelles perceptions, quŌĆÖautrefois on nŌĆÖavait point connues. Le Dr Franz ayant op├®r├® un aveugle-n├®, celui-ci d├®clara quŌĆÖil se faisait avant son op├®ration, ├Ā travers le sens du toucher, une tout autre id├®e de la grandeur des objets. Il lui fallut corriger ses perceptions tactiles par des perceptions visuelles.
DŌĆÖo├╣ vient que nous soyons oblig├®s, de la sorte, ├Ā faire de perp├®tuelles remises au point ?
La r├®ponse ├Ā cette question se pr├®sente tout naturellement. Lorsque je me trouve au bout dŌĆÖune all├®e, les arbres qui se trouvent ├Ā lŌĆÖautre bout mŌĆÖapparaissent plus petits et plus serr├®s que ceux qui sont pr├©s de moi. Si je change le lieu dŌĆÖo├╣ jŌĆÖobserve, lŌĆÖimage per├¦ue change ├®galement. LŌĆÖaspect quŌĆÖelle prend pour me parvenir est donc d├®pendant dŌĆÖune d├®termination qui nŌĆÖappartient pas ├Ā lŌĆÖobjet de la perception, mais ├Ā moi. Il nŌĆÖimporte pas ├Ā une all├®e que je me tienne ici ou l├Ā, mais il importe consid├®rablement ├Ā lŌĆÖimage que je re├¦ois dŌĆÖelle. De m├¬me, il est indiff├®rent au soleil et aux plan├©tes que les hommes les contemplent ├Ā partir de la terre. Mais lŌĆÖimage de perception que les hommes en re├¦oivent d├®pend de ce point de d├®part de leur observation. Ce genre de d├®pendance est extr├¬mement facile ├Ā comprendre. La question se complique lorsquŌĆÖil sŌĆÖagit de la d├®pendance o├╣ sont nos perceptions vis-├Ā-vis de notre organisation physique et spirituelle. Le physicien nous apprend que, lorsque nous percevons un son, il se produit des vibrations dans lŌĆÖair qui nous environne, et que le corps dont le son nous semble provenir pr├®sente aussi des mouvements vibratoires de ses parties constitutives. Nous percevons ce mouvement comme un son, parce que nous avons une oreille normalement conform├®e. Mais sans une oreille ainsi conform├®e, le monde nous appara├«trait ├Ā jamais silencieux. La physiologie nous enseigne que certaines personnes ne per├¦oivent rien de toutes les splendides colorations qui nous environnent. Pour ces personnes, il nŌĆÖexiste que des nuances de clair et de fonc├®. DŌĆÖautres sont seulement priv├®es de la perception dŌĆÖune couleur, par exemple, du rouge. La couleur rouge manque ├Ā leur image du monde, qui, par l├Ā, diff├©re consid├®rablement de celle de lŌĆÖhomme normal. QuŌĆÖon me permette de nommer la premi├©re d├®pendance dont jŌĆÖai parl├®, celle qui a trait au lieu de lŌĆÖobservation - une d├®pendance math├®matique ; et la seconde celle qui a trait ├Ā notre organisation - une d├®pendance qualitative. La premi├©re d├®termine les rapports de grandeur et de distance propres ├Ā mes perceptions ; la seconde d├®termine leurs qualit├®s ; que je voie rouge une surface rouge, cela d├®pend de lŌĆÖorganisation de mon oeil.
Mes images de perception sont donc, tout dŌĆÖabord, subjectives. La notion de cette subjectivit├® peut nous amener ├Ā douter compl├©tement quŌĆÖil y ait, ├Ā leur base, une r├®alit├® objective. Lorsque, par exemple, nous savons que la perception de la couleur rouge, ou celle dŌĆÖun certain son, nŌĆÖest pas possible sans une certaine organisation de notre ├¬tre subjectif, nous pouvons en venir ├Ā croire que ces perceptions, en dehors de cet ├¬tre, ne subsistent aucunement ; quŌĆÖelles ne poss├©dent, en dehors de lŌĆÖacte de perception dont elles sont lŌĆÖobjet, nulle existence. Cette opinion a trouv├® son repr├®sentant classique en George Berckeley. Il estima que lŌĆÖhomme, d├©s quŌĆÖil prend conscience du r├┤le que joue son sujet dans ses actes de perception, nŌĆÖa plus le droit de croire ├Ā un monde r├®el existant en dehors de lŌĆÖesprit conscient. Il ├®crivit :
┬½Il y a des v├®rit├®s si imm├®diates et si ├®videntes quŌĆÖil suffit dŌĆÖouvrir les yeux pour les apercevoir. Telle est lŌĆÖimportante proposition que voici : tout le choeur des astres et tout ce qui appartient ├Ā la terre, en un mot, tous les corps qui constituent lŌĆÖ├®difice puissant de lŌĆÖunivers, nŌĆÖont aucune subsistance en dehors de lŌĆÖesprit ; leur existence consiste uniquement ├Ā ├¬tre per├¦us ou connus et, par suite, tant quŌĆÖils ne sont pas r├®ellement per├¦us par moi, ou tant quŌĆÖils nŌĆÖexistent pas soit dans ma conscience, soit dans un autre esprit cr├®├®, on peut affirmer : ou quŌĆÖils nŌĆÖont aucune existence, ou quŌĆÖils existent dans la conscience dŌĆÖun esprit ├®ternel┬╗.
Pour cette ├®cole philosophique, il ne reste plus rien des perceptions d├©s lŌĆÖinstant o├╣ lŌĆÖon fait abstraction de lŌĆÖacte qui les per├¦oit. Il nŌĆÖy a pas de couleur l├Ā o├╣ lŌĆÖon nŌĆÖen voit pas, pas de son lorsquŌĆÖon nŌĆÖen entend pas. LŌĆÖ├®tendue, la forme, le mouvement, nŌĆÖexistent pas plus que la couleur et que le son, sauf dans lŌĆÖacte de perception. Car nulle part nous ne voyons de la pure ├®tendue, de la pure forme ; ces qualit├®s sont toujours indissolublement unies ├Ā de la couleur ou ├Ā dŌĆÖautres d├®terminations indiscutablement subjectives. Si ces derni├©res disparaissent d├©s que cesse notre perception, il en va de m├¬me pour les premi├©res qui leur sont li├®es.
On a r├®pliqu├® que, m├¬me si la forme, la couleur, le son, nŌĆÖont aucune autre existence que celle que leur conf├©re lŌĆÖacte de perception, il doit cependant exister, en dehors de notre conscience, des choses auxquelles nos images de perception ressemblent. Mais cette philosophie r├®pond : une couleur ne peut ressembler quŌĆÖ├Ā une couleur, une forme, quŌĆÖ├Ā une forme. Nos perceptions ne peuvent ressembler quŌĆÖ├Ā des perceptions et non point ├Ā dŌĆÖautres choses dŌĆÖaucune esp├©ce. Ce que nous nommons un ┬½objet┬╗ nŌĆÖest quŌĆÖun groupe de perceptions li├®es entre elles dŌĆÖune certaine mani├©re. Si jŌĆÖenl├©ve ├Ā une table sa forme, son ├®tendue, sa couleur, etc., bref, toutes les perceptions que jŌĆÖen ai, il ne reste rien dŌĆÖelle. Cette opinion, si on en d├®duit toutes ses cons├®quences, m├©ne ├Ā lŌĆÖaffirmation que voici : les objets de mes perceptions nŌĆÖexistent que gr├óce ├Ā moi ; ils nŌĆÖexistent que dans la mesure o├╣ je les per├¦ois, et aussi longtemps que je les per├¦ois ; ils disparaissent avec ma perception, ils nŌĆÖont aucun sens en dehors dŌĆÖelle. Or, je ne connais aucun objet en dehors de mes perceptions, et nŌĆÖen puis conna├«tre aucun.
Tant que lŌĆÖon se borne ├Ā consid├®rer, en g├®n├®ral, le fait que nos perceptions d├®pendent de lŌĆÖorganisation subjective, il nŌĆÖy a rien ├Ā opposer ├Ā la th├®orie de Berckeley. Mais la chose se pr├®senterait tout autrement si nous ├®tions en mesure de d├®terminer quel est, dans lŌĆÖapparition dŌĆÖune perception, le r├┤le de notre activit├® perceptrice. Nous saurions alors ce qui, pendant que nous percevons, se passe dans la perception et nous pourrions aussi d├®terminer ce qui devait ├¬tre en elle auparavant.
Nous sommes donc amen├®s ├Ā d├®tourner notre ├®tude de lŌĆÖobjet de la perception pour lŌĆÖappliquer au sujet. Je ne per├¦ois pas seulement les choses, je me per├¦ois aussi moi-m├¬me. Cette perception de mon moi consiste dŌĆÖabord en ceci, que je me sens ├¬tre un ├®l├®ment durable au sein des images toujours changeantes qui viennent ├Ā moi. La perception du moi peut surgir constamment en ma conscience, pendant m├¬me que jŌĆÖai dŌĆÖautres perceptions. Lorsque je suis plong├® dans la perception dŌĆÖun objet donn├®, je nŌĆÖai momentan├®ment dŌĆÖautre conscience que celle de cet objet. Mais la conscience de mon moi peut sŌĆÖy ajouter. D├©s lors, jŌĆÖai non seulement conscience de lŌĆÖobjet, mais encore de ma personnalit├® qui se trouve en face de lui et lŌĆÖobserve. Je ne vois pas seulement un arbre, je sais aussi que cŌĆÖest moi qui le regarde. Je reconnais aussi quŌĆÖil se passe quelque chose en moi pendant que jŌĆÖobserve. Lorsque lŌĆÖarbre dispara├«t du champ de mon observation, quelque chose subsiste dans ma conscience : lŌĆÖimage de lŌĆÖarbre. Cette image sŌĆÖest unie ├Ā mon moi pendant lŌĆÖacte dŌĆÖobservation. Mon moi sŌĆÖest enrichi dŌĆÖun nouvel ├®l├®ment que je nomme la repr├®sentation de lŌĆÖarbre. Je nŌĆÖaurais pas occasion de parler de repr├®sentations si je ne les trouvais pas dans la perception de mon propre moi. Les perceptions viendraient et dispara├«traient ; je les laisserais passer. CŌĆÖest seulement parce que je per├¦ois mon moi et parce que je remarque que son contenu change ├Ā chaque perception, que je me vois oblig├® dŌĆÖ├®tablir un rapport entre lŌĆÖobservation de chaque objet et le changement int├®rieur qui en r├®sulte, et de parler de mes ┬½repr├®sentations┬╗.
Je per├¦ois la repr├®sentation en moi, comme je per├¦ois la couleur, le son, etc., dans les objets ext├®rieurs. Je puis d├©s lors diff├®rencier ces objets qui sŌĆÖopposent ├Ā moi, et que je nomme monde ext├®rieur, du contenu de mon auto-perception que je nomme monde int├®rieur.
La m├®connaissance des rapports qui unissent la repr├®sentation et lŌĆÖobjet a caus├® les plus graves confusions de la philosophie moderne. La perception dŌĆÖun changement survenant en nous, la modification du moi, a ├®t├® mise en avant, et lŌĆÖon a perdu de vue lŌĆÖobjet qui provoque cette modification. On a dit : nous ne percevons pas les objets, mais seulement nos repr├®sentations. Je ne puis rien savoir de la table en elle-m├¬me, je puis seulement conna├«tre les changements qui se produisent en moi pendant que je lŌĆÖobserve. Cette th├®orie nŌĆÖest pas ├Ā confondre avec celle de Berckeley, que nous ├®noncions plus haut. Berckeley indique la nature subjective du contenu de nos perceptions, mais il ne dit pas que nous ne pouvons conna├«tre que nos repr├®sentations. SŌĆÖil limite notre savoir ├Ā nos repr├®sentations, cŌĆÖest que, selon lui, il nŌĆÖexiste pas d objets en dehors de ces repr├®sentations.
Selon Berckeley, ce que je per├¦ois comme ├®tant table, cesse dŌĆÖexister d├©s lŌĆÖinstant o├╣ jŌĆÖen d├®tourne mes yeux. CŌĆÖest pourquoi Berckeley estime que les perceptions naissent directement de la toute-puissance de Dieu. Je vois une table parce que Dieu provoque en moi cette perception. Berckeley ne conna├«t dŌĆÖautres ├¬tres r├®els que Dieu et les esprits des hommes. Ce que nous appelons le monde nŌĆÖexiste quŌĆÖau sein de ces esprits. Ce que lŌĆÖhomme appelle ┬½monde ext├®rieur┬╗ ou ┬½nature corporelle┬╗, Berckeley en nie lŌĆÖexistence.
Par contre, si la conception kantienne, qui pr├®domine actuellement, restreint notre connaissance du monde ├Ā nos repr├®sentations, ce nŌĆÖest pas quŌĆÖelle nie lŌĆÖexistence de toute autre chose ; cŌĆÖest quŌĆÖelle nous croit organis├®s de mani├©re ├Ā ne jamais conna├«tre que les modifications de notre moi, et ├Ā toujours ignorer les choses qui provoquent ces modifications. Mais, du fait que je connais uniquement mes repr├®sentations, elle ne d├®duit pas que rien dŌĆÖautre nŌĆÖexiste ; elle affirme seulement que, sŌĆÖil existe autre chose, le sujet ne peut en aucune fa├¦on sŌĆÖen saisir directement. Il peut seulement : ┬½par lŌĆÖinterm├®diaire de ses pens├®es subjectives, lŌĆÖimaginer, le supposer, le penser, le conna├«tre, ou peut-├¬tre ne le pas conna├«tre┬╗. [voir: "LŌĆÖanalyse de la r├®alit├®" par O. Liebmann].
Cette th├®orie croit ├®noncer une v├®rit├® ├®vidente, absolument certaine, et qui se passe de toute preuve.
Voici comment Volkelt commence son livre sur la "Th├®orie de la connaissance de Kant" : ┬½La premi├©re proposition fondamentale dont le philosophe doit se rendre compte, cŌĆÖest que notre savoir ne sŌĆÖ├®tend tout dŌĆÖabord ├Ā rien de plus quŌĆÖ├Ā nos repr├®sentations. Nos repr├®sentations sont les seules choses que nous puissions conna├«tre directement. Et, justement parce que nous les connaissons directement, le scepticisme le plus radical ne pourra jamais nous enlever la connaissance de ces repr├®sentations. Par contre, le savoir qui d├®passe nos repr├®sentations (je prends ce terme dans son sens le plus vaste, y comprenant aussi des ph├®nom├©nes physiques), ce savoir nŌĆÖest pas ├Ā lŌĆÖabri du doute. CŌĆÖest pourquoi lŌĆÖon doit, au d├®but de la philosophie, rejeter comme douteux tout savoir qui d├®passe les repr├®sentations┬╗. Mais ce que lŌĆÖon pose l├Ā comme ├®tant une ├®vidence, r├®sulte en r├®alit├® dŌĆÖune op├®ration de la pens├®e, qui se fait comme suit : LŌĆÖhomme du commun croit que les objets, tels quŌĆÖil les per├¦oit, existent r├®ellement en dehors de sa conscience. Mais la physique, la physiologie et la psychologie paraissent enseigner que nos perceptions d├®pendent de notre organisation et que, par suite, nous ne pouvons rien savoir des choses que ce que cette organisation nous en transmet. Nos perceptions sont donc des modifications de notre organisme et non point des ┬½choses en soi┬╗.
├ēdouard von Hartmann a montr├® comment on poursuit ce raisonnement jusquŌĆÖ├Ā affirmer que nous nŌĆÖavons aucun savoir direct, sauf de nos repr├®sentations [voir: "Probl├©me fondamental de la th├®orie de la connaissance" par ├ēdouard von Hartmann]. Parce que nous trouvons, au dehors de notre organisme, des vibrations des corps et de lŌĆÖair, qui se pr├®sentent ├Ā nous comme ├®tant des sons, on en d├®duit que ce que nous appelons ┬½son┬╗ nŌĆÖest absolument rien quŌĆÖune r├®action subjective de notre organisme ├Ā ces mouvements du milieu ext├®rieur. On prouve, de la m├¬me mani├©re, que la couleur, la chaleur, ne sont que des modifications de notre organisme. Et lŌĆÖon opine que ces deux sortes de perceptions sont provoqu├®es en nous par des ph├®nom├©nes ext├®rieurs profond├®ment diff├®rents de ce quŌĆÖest notre exp├®rience subjective de la couleur ou de la chaleur. Lorsque ces ph├®nom├©nes ext├®rieurs excitent mes nerfs p├®riph├®riques, jŌĆÖ├®prouve des sensations thermiques, et lorsquŌĆÖils sŌĆÖadressent ├Ā mon nerf optique, jŌĆÖ├®prouve des sensations lumineuses et color├®es. La lumi├©re, la couleur, la chaleur sont seulement les modes de r├®action de mes nerfs sensitifs aux excitations du dehors. M├¬me le toucher ne saurait me livrer les objets m├¬mes du monde ext├®rieur, mais seulement les modifications de mon propre ├®tat. Dans lŌĆÖesprit de la physique moderne, on peut imaginer que les corps sont compos├®s de parties extr├¬mement petites, les mol├®cules, et que ces mol├®cules ne se touchent pas absolument, mais sont s├®par├®es les unes des autres par de petites distances. Il y a donc, entre elles, le vide. Et, ├Ā travers ce vide, elles exercent des attractions les unes sur les autres. Lorsque ma main sŌĆÖapproche dŌĆÖun corps, les mol├®cules de ma main ne sauraient en aucun cas toucher directement celles du corps, mais il demeure entre la main et le corps un certain espace, et ce que je ressens comme ├®tant la r├®sistance du corps nŌĆÖest pas autre chose que lŌĆÖeffet dŌĆÖune force r├®pulsive que ses mol├®cules exercent sur ma main. Je suis en dehors du corps, et je ne per├¦ois que ses effets sur mon organisme.
En compl├®ment ├Ā ces th├®ories, J. Muller (1801-1858) nous a donn├® celle des ┬½├®nergies sensorielles sp├®cifiques┬╗. Elle consiste ├Ā dire que chacun de nos sens a la propri├®t├® particuli├©re de ne r├®agir ├Ā toutes les excitations ext├®rieures que dŌĆÖune certaine fa├¦on d├®termin├®e. Lorsque quelque chose agit sur le nerf optique, nous percevons toujours de la lumi├©re, que lŌĆÖexcitation ait ├®t├® caus├®e par ce que nous appelons lumi├©re, ou par une pression, ou encore par un courant ├®lectrique. DŌĆÖautre part, les m├¬mes excitations provoquent en chacun de nos organes sensoriels des sensations diff├®rentes. Il semble en r├®sulter que ces organes sensoriels nous livrent ce qui se passe en eux, mais ne nous apprennent rien du monde ext├®rieur. Chacun dŌĆÖeux d├®termine les perceptions dŌĆÖapr├©s sa propre nature.
La physiologie enseigne quŌĆÖil ne peut y avoir non plus aucune connaissance directe des ph├®nom├©nes que les objets provoquent dans nos organes des sens. En ├®tudiant ce qui a lieu dans lŌĆÖorganisme lui-m├¬me, elle trouve que les effets des mouvements de lŌĆÖext├®rieur subissent d├®j├Ā dans les organes des sens toutes sortes de transformations. CŌĆÖest ce qui appara├«t clairement en ce qui concerne, par exemple, lŌĆÖoeil et lŌĆÖoreille. Tous deux sont des organes tr├©s compliqu├®s qui transforment radicalement lŌĆÖexcitation ext├®rieure avant de la transmettre au nerf qui leur correspond. Puis, de lŌĆÖextr├®mit├® terminale du nerf, lŌĆÖexcitation d├®j├Ā m├®tamorphos├®e est transmise au cerveau. CŌĆÖest l├Ā seulement que les organes c├®r├®braux doivent ├¬tre excit├®s ├Ā leur tour. On en conclut que le ph├®nom├©ne ext├®rieur a subi toute une s├®rie de transformations avant de parvenir ├Ā notre conscience. Le ph├®nom├©ne qui a lieu dans le cerveau est s├®par├® du ph├®nom├©ne ext├®rieur par une telle s├®rie de faits interm├®diaires quŌĆÖil nŌĆÖy a plus aucune ressemblance possible entre le premier et le dernier terme de la s├®rie. Le cerveau ne transmet finalement ├Ā la conscience ni les ph├®nom├©nes ext├®rieurs, ni ceux qui ont leur si├©ge dans les organes sensoriels, mais seulement ceux qui ont leur si├©ge dans le cerveau lui-m├¬me. Et m├¬me ceux-l├Ā, lŌĆÖ├óme ne saurait les saisir directement. Ce que nous avons finalement dans notre conscience, ce nŌĆÖest m├¬me pas le ph├®nom├©ne c├®r├®bral, cŌĆÖest une sensation. Ma sensation de rouge nŌĆÖa aucune ressemblance avec le ph├®nom├©ne qui se produit dans mon cerveau quand je vois du rouge. Cette exp├®rience subjective nŌĆÖest quŌĆÖun effet, dont la cause est le ph├®nom├©ne c├®r├®bral. CŌĆÖest pourquoi Hartmann dit : ┬½Ce que le sujet per├¦oit, ce ne sont jamais que des modifications de ses propres ├®tats psychiques, et rien dŌĆÖautre┬╗. DŌĆÖailleurs, lorsque jŌĆÖ├®prouve des sensations, elles sont encore bien loin dŌĆÖ├¬tre group├®es de mani├©re ├Ā constituer lŌĆÖobjet de ma perception. Car le cerveau ne me fournit que des sensations isol├®es. Par exemple, la perception de duret├® ou de mollesse mŌĆÖest transmise ├Ā la fois par des sensations tactiles, des sensations lumineuses et des sensations de couleur. Et cependant ces diverses sensations se trouvent r├®unies sur un seul objet. CŌĆÖest lŌĆÖ├óme qui doit op├®rer cette r├®union. CŌĆÖest-├Ā-dire quŌĆÖavec les sensations isol├®es que lui transmet le cerveau, lŌĆÖ├óme construit les corps ext├®rieurs. Par exemple, mon cerveau me livre isol├®ment, par des voies extr├¬mement diverses, les sensations visuelles, tactiles, et auditives, que mon ├óme va assembler en une repr├®sentation de trompette. Ce terme final du processus (repr├®sentation de la trompette) est pr├®cis├®ment ce qui, dans ma conscience, appara├«t en premier. Il nŌĆÖy reste plus rien de ce qui, en dehors de moi, a ├®t├® la cause initiale de tout ce processus, plus rien de la chose qui a agi sur mes organes sensoriels. LŌĆÖobjet ext├®rieur sŌĆÖest enti├©rement ├®vanoui dans son trajet des sens au cerveau, et du cerveau ├Ā lŌĆÖ├óme.
Il serait difficile de trouver un second monument de la pens├®e humaine qui ait ├®t├® construit avec autant de p├®n├®tration que celui-ci, et qui, cependant, sŌĆÖ├®croule plus facilement ├Ā lŌĆÖexamen. Voyons un peu, de plus pr├©s, comment on lŌĆÖa ├®difi├® : on est parti tout dŌĆÖabord de ce qui appara├«t dans la conscience imm├®diate : la chose per├¦ue. Puis on a montr├® que tout ce qui se trouve en cette chose serait absent pour nous si nous nŌĆÖavions pas de sens : sans oeil, pas de couleur. Par cons├®quent, a-t-on dit, la couleur nŌĆÖexiste pas encore en ce qui agit sur notre oeil. Elle est enfant├®e par lŌĆÖaction r├®ciproque de lŌĆÖoeil sur lŌĆÖobjet, et de lŌĆÖobjet sur lŌĆÖoeil. LŌĆÖobjet est donc d├®pourvu de toute couleur. Mais la couleur nŌĆÖexiste pas non plus dans lŌĆÖoeil ; car il nŌĆÖy a dans lŌĆÖoeil quŌĆÖun processus physique ou chimique, qui est conduit par le nerf optique jusquŌĆÖau cerveau, o├╣ il en d├®termine un autre. Cet autre processus nŌĆÖest toujours pas de la couleur. Elle appara├«t seulement dans lŌĆÖ├óme, lorsquŌĆÖelle y est provoqu├®e par le processus c├®r├®bral. Et l├Ā, elle ne devient pas encore consciente, mais elle est transport├®e par lŌĆÖ├óme sur un corps situ├® ├Ā lŌĆÖext├®rieur. CŌĆÖest sur celui-ci que lŌĆÖon croit la percevoir. On a d├®crit un circuit complet, on a conscience dŌĆÖun corps color├®.
Voil├Ā la premi├©re partie de la d├®monstration. Maintenant, lŌĆÖop├®ration logique commence. Si je nŌĆÖavais pas dŌĆÖoeil, le corps serait pour moi une chose incolore. Je nŌĆÖai donc pas le droit de dire que la couleur appartient au corps. O├╣ donc se trouve-t-elle ? Je la cherche dans lŌĆÖoeil : en vain. Dans le nerf : en vain. Dans le cerveau : en vain. Dans lŌĆÖ├óme, je la trouve bien, mais isol├®e du corps color├®. Pour trouver le corps color├®, il me faut revenir ├Ā mon point de d├®part. JŌĆÖai referm├® le circuit. Je crois reconna├«tre comme un produit de mon ├óme ce que lŌĆÖhomme du commun croit exister au dehors, dans lŌĆÖespace. Tout va bien tant quŌĆÖon en reste l├Ā. Mais l├Ā, il faut encore recommencer lŌĆÖop├®ration : je ne me suis pr├®occup├® jusqu'├Ā pr├®sent que dŌĆÖune chose : la perception ext├®rieure dont jŌĆÖavais auparavant, en tant quŌĆÖhomme du commun, une opinion tout ├Ā fait fausse. Je me disais elle existe objectivement, telle que je la per├¦ois. Or, je mŌĆÖaper├¦ois maintenant quŌĆÖelle dispara├«t en m├¬me temps que ma facult├® de me la repr├®senter, je mŌĆÖaper├¦ois quŌĆÖelle est seulement une modification de mes ├®tats psychiques. Ai-je encore le droit de la prendre comme point de d├®part de mes consid├®rations ? Puisse encore dire quŌĆÖelle agit sur mon ├óme ? Cette table, dont jŌĆÖavais cru quŌĆÖelle agissait sur moi et provoquait en moi sa repr├®sentation, il me faut, dor├®navant, la consid├®rer comme ├®tant elle-m├¬me une repr├®sentation. Et puis, si je suis cons├®quent avec moi-m├¬me, je dois dire aussi que mes organes des sens, et tous les ph├®nom├©nes dont ils sont le si├©ge, sont choses purement subjectives. Je nŌĆÖai aucun droit de parler dŌĆÖun oeil r├®el, mais seulement de ma repr├®sentation dŌĆÖun oeil. Je dois en dire autant du processus nerveux et du processus c├®r├®bral, et autant du processus psychique lui-m├¬me, lequel consiste ├Ā ├®difier des objets avec la multitude confuse des sensations. Par cons├®quent si jŌĆÖai admis la premi├©re partie de la th├®orie et que jŌĆÖ├®tudie ensuite ├Ā nouveau les phases de mon acte de connaissance, ce dernier nŌĆÖappara├«t plus que comme un tissu de repr├®sentations, lesquelles, en cette qualit├®, sont incapables dŌĆÖagir les unes sur les autres. Je nŌĆÖai pas le droit de dire que ma repr├®sentation de lŌĆÖobjet agit sur ma repr├®sentation de lŌĆÖoeil, et que ce contact engendre ma repr├®sentation de la couleur. Et je ne serai pas non plus tent├® de le dire ; car il mŌĆÖa suffi de remarquer que mes organes des sens et leurs activit├®s, mes processus nerveux et mes processus psychiques ne me sont tous donn├®s que gr├óce ├Ā la perception, pour apercevoir lŌĆÖimpossibilit├® de la th├®orie en question. Certes, sans lŌĆÖorgane sensoriel correspondant, il nŌĆÖy a pour moi aucune perception. Mais sans perception il nŌĆÖy a pas non plus dŌĆÖorgane sensoriel. Je puis passer de ma perception de la table ├Ā celle de lŌĆÖoeil qui la voit, ├Ā celle des nerfs du toucher qui la sentent ; mais ce qui se passe en cet oeil, en ces nerfs, je ne puis le savoir ├Ā nouveau que par des perceptions. Et je mŌĆÖaper├¦ois bient├┤t que, dans le processus dont lŌĆÖoeil est le si├©ge, il nŌĆÖy a pas la moindre ressemblance avec ce qui est ma perception color├®e. Je nŌĆÖan├®antis aucunement cette perception color├®e en d├®crivant le processus qui a lieu dans lŌĆÖoeil pendant que je per├¦ois. De m├¬me, il mŌĆÖest impossible de retrouver la couleur dans les processus nerveux et c├®r├®braux. Je ne fais, en tout cela, quŌĆÖunir de nouvelles perceptions, relatives ├Ā mon organisme, ├Ā celles que lŌĆÖhomme du commun trouve en dehors de lui. Je ne fais que passer dŌĆÖune perception ├Ā lŌĆÖautre.
De plus, la th├®orie que nous avons expos├®e contient une lacune. Je suis en mesure de suivre les ph├®nom├©nes organiques de la sensation jusquŌĆÖaux centres nerveux, quoique, ├Ā vrai dire, les notions que jŌĆÖen ai deviennent de plus en plus hypoth├®tiques ├Ā mesure que je me rapproche de ces centres ; mais cette observation, par lŌĆÖext├®rieur, cesse compl├©tement apr├©s lŌĆÖ├®tude du processus c├®r├®bral (├®tude que je pourrais faire si jŌĆÖavais les moyens physiques, chimiques, etc., dŌĆÖobserver le fonctionnement de lŌĆÖenc├®phale). ├Ć partir de ce moment, cŌĆÖest le r├┤le de lŌĆÖobservation int├®rieure, de lŌĆÖintrospection qui commence elle va de la simple sensation jusquŌĆÖ├Ā la synth├©se des sensations ├®l├®mentaires en ┬½objet┬╗. Entre lŌĆÖexamen du processus c├®r├®bral et lŌĆÖexp├®rience subjective de la sensation, la route que parcourt notre observation est discontinue.
La th├®orie qui a fait lŌĆÖobjet de ce chapitre (elle se nomme ┬½id├®alisme critique┬╗, par opposition ├Ā la conception primitive de la conscience ordinaire, quŌĆÖelle appelle ┬½r├®alisme primitif┬╗), commet la faute dŌĆÖattribuer ├Ā une certaine perception un caract├©re de pure repr├®sentation, tandis quŌĆÖ├Ā lŌĆÖ├®gard dŌĆÖautres perceptions, elle en demeure elle-m├¬me au stade de ce soi-disant ┬½r├®alisme primitif┬╗, quŌĆÖelle pr├®tendait combattre. Alors quŌĆÖelle tend ├Ā prouver la valeur purement repr├®sentative des perceptions, elle admet, sans critique, au rang de r├®alit├®s objectives, les perceptions qui ont trait ├Ā lŌĆÖorganisme m├¬me du sujet percepteur, et, par-dessus tout cela, elle confond enti├©rement deux domaines dŌĆÖobservation radicalement distincts, entre lesquels on ne conna├«t aucun interm├®diaire.
LŌĆÖid├®alisme critique ne peut r├®futer le r├®alisme primitif quŌĆÖen admettant lui-m├¬me, ├Ā la fa├¦on de ce r├®alisme primitif, lŌĆÖobjectivit├® r├®elle de lŌĆÖorganisme humain. D├©s lŌĆÖinstant o├╣ il sŌĆÖaper├¦oit que les perceptions relatives ├Ā cet organisme sont du m├¬me ordre que les autres, il lui devient impossible de sŌĆÖappuyer sur elles comme sur une base valide. Il lui faut m├¬me, dor├®navant, consid├®rer toute lŌĆÖorganisation subjective comme un complexus de repr├®sentations. Et cela lui enl├©ve la possibilit├® de dire que le monde ext├®rieur est un produit de cette organisation subjective. Il lui faudrait admettre, par exemple, que la repr├®sentation ┬½couleur┬╗ nŌĆÖest quŌĆÖune modification de la repr├®sentation ┬½oeil┬╗. La th├©se de lŌĆÖid├®alisme critique ne saurait ├¬tre d├®montr├®e sans faire un emprunt au r├®alisme primitif. Pour r├®futer celui-ci sur un terrain, elle lŌĆÖadmet sans conteste sur lŌĆÖautre.
De tout ceci r├®sulte une certitude : cŌĆÖest que lŌĆÖid├®alisme critique ne peut se d├®montrer par des recherches faites dans le domaine perceptible, et que, par cons├®quent, la perception ne saurait ├¬tre d├®pouill├®e, par ce moyen, de son caract├©re objectif.
Il est encore bien moins vrai que la proposition : ┬½Le monde que je per├¦ois est ma repr├®sentation┬╗, soit ├®vidente par elle-m├¬me et se passe de preuve. Schopenhauer commence son ouvrage principal ┬½Le monde comme volont├® et comme repr├®sentation┬╗ ainsi quŌĆÖil suit :
┬½Le monde est ma repr├®sentation. Cette v├®rit├® est valable en ce qui concerne tout ├¬tre vivant dou├® de connaissance, mais lŌĆÖhomme seul en fait un objet de conscience et de r├®flexion abstraite. Et lorsquŌĆÖil le fait, cŌĆÖest que lŌĆÖesprit philosophique sŌĆÖinstaure en lui. Il lui devient alors certain quŌĆÖil ne conna├«t ni soleil, ni terre ; mais seulement un oeil qui voit le soleil, une main qui touche et sent la terre que lŌĆÖunivers dont il est entour├® nŌĆÖexiste quŌĆÖ├Ā titre de repr├®sentation, cŌĆÖest-├Ā-dire quŌĆÖil est uniquement relatif au sujet. SŌĆÖil existe une v├®rit├® qui puisse sŌĆÖ├®noncer ├Ā priori, cŌĆÖest celle-l├Ā. Elle est lŌĆÖexpression de la forme commune ├Ā toutes les exp├®riences possibles et imaginables, forme beaucoup plus g├®n├®rale que ne le sont toutes les autres : temps, espace, causalit├®. Car toutes ces autres formes la pr├®supposent┬╗.
Toute la proposition de Schopenhauer se heurte ├Ā lŌĆÖ├®cueil que jŌĆÖai soulev├® plus haut, ├Ā savoir que lŌĆÖoeil et la main ne sont pas moins des perceptions que le soleil et la terre. Et lŌĆÖon pourrait r├®pondre ├Ā Schopenhauer, en empruntant son propre langage : ┬½Mon oeil, qui voit le soleil, ma main, qui touche la terre, sont mes repr├®sentations aussi bien que le soleil et la terre eux-m├¬mes┬╗. Il appara├«t clairement que, ce disant, je r├®fute la proposition. Car seuls ma v├®ritable main et mon v├®ritable oeil pourraient avoir le soleil et la terre en eux, comme modifications de leur ├¬tre, mais non point mes repr├®sentations dŌĆÖoeil et de main. Or cŌĆÖest de ces derni├©res seules que lŌĆÖid├®alisme critique a le droit de parler.
LŌĆÖid├®alisme critique est absolument impropre ├Ā former notre opinion sur le rapport de la perception ├Ā la repr├®sentation. Il ne saurait entreprendre la solution du probl├©me que nous avons pos├® [voir: chapitre "4. Le monde comme perception" - rechercher "il ne reste plus rien des perceptions"], ├Ā savoir : ├®tablir ce qui se produit dans une perception pendant que nous percevons, et ce qui doit exister en elle auparavant. Il faut chercher cette solution par dŌĆÖautres m├®thodes.
5. La connaissance du monde
Il ressort des pages qui pr├®c├©dent quŌĆÖil est impossible de d├®montrer, par lŌĆÖexamen du contenu de nos perceptions, que ces derni├©res sont de pures repr├®sentations. Pour faire cette d├®monstration, on a tent├® dŌĆÖ├®tablir que, si la perception sŌĆÖeffectue conform├®ment aux donn├®es du r├®alisme primitif sur notre organisation psychique et corporelle, cette perception ne fournit point des ┬½choses en soi┬╗, mais des ┬½repr├®sentations┬╗ des choses. Si donc le r├®alisme primitif, d├®velopp├® logiquement, m├©ne ├Ā des conclusions qui sont exactement le contraire de ses pr├®misses, cŌĆÖest que ces pr├®misses sont impropres ├Ā nous servir de base philosophique, et quŌĆÖil faut les abandonner. En tout cas, il est inadmissible que lŌĆÖon accepte les conclusions en rejetant les pr├®misses, comme fait lŌĆÖid├®alisme critique, qui ├®nonce : ┬½Le monde est ma repr├®sentation┬╗, et qui le d├®montre comme nous lŌĆÖavons dit ci-dessus. [voir: ┬½Le probl├©me fondamental de la th├®orie de la connaissance┬╗ par ├ēdouard von Hartmann, donnant de cette d├®monstration un expos├® complet]
Si la justesse de lŌĆÖid├®alisme critique est une chose, la force persuasive de ses d├®monstrations en est une autre. Pour ce qui est de sa justesse, nous verrons plus loin ce que nous devons en penser. Quant ├Ā la force persuasive de ses d├®monstrations, elle est nulle. LorsquŌĆÖon construit une maison, et quŌĆÖau moment o├╣ lŌĆÖon b├ótit le premier ├®tage, le rez-de-chauss├®e sŌĆÖ├®croule, il est fatal que le premier ├®tage sŌĆÖ├®croule en m├¬me temps. Ainsi se comportent vis-├Ā-vis lŌĆÖun de lŌĆÖautre le r├®alisme primitif et lŌĆÖid├®alisme critique.
Si lŌĆÖon admet que tout lŌĆÖunivers per├¦u nŌĆÖest quŌĆÖune somme de repr├®sentations, autrement dit, dŌĆÖeffets que produisent sur notre ├óme des choses qui nous sont inconnues, on applique naturellement le probl├©me de la connaissance non point ├Ā ces repr├®sentations pr├®sentes dans notre ├óme, mais aux ┬½choses en soi┬╗ situ├®es au del├Ā de notre conscience, et ind├®pendantes de nous. On se pose alors la question suivante : ├ētant donn├® que les choses sont inaccessibles ├Ā notre observation directe, dans quelle mesure pourrons-nous les conna├«tre indirectement ? On ne se pr├®occupe plus des lois intimes qui conditionnent entre elles nos perceptions conscientes, mais seulement de leurs causes inaccessibles ├Ā la conscience, et dont on croit lŌĆÖexistence ind├®pendante de lŌĆÖhomme (tandis que les perceptions sŌĆÖ├®vanouissent d├©s que nous en d├®tournons nos fonctions sensorielles). Pour cette philosophie, la conscience est comme un miroir, dans lequel les reflets des choses disparaissent d├©s que la surface du miroir ne leur est plus expos├®e. Celui qui ne voit pas les choses elles-m├¬mes, mais seulement leur reflet, se trouve dans lŌĆÖobligation de se renseigner sur ces choses par des d├®ductions quŌĆÖil tire de leur reflet. Tel est le point de vue de la science moderne ; elle nŌĆÖemploie la perception quŌĆÖ├Ā titre de moyen supr├¬me pour acqu├®rir des notions sur les ph├®nom├©nes r├®els de la mati├©re, qui sont situ├®s, croit-elle, derri├©re cette perception. Lorsque le partisan de lŌĆÖid├®alisme critique ne nie pas toute existence, toute sa soif de connaissance tend ├Ā atteindre, par lŌĆÖinterm├®diaire de la perception, la r├®alit├® qui se cache derri├©re elle. Son ├®tude n├®glige le monde subjectif des repr├®sentations, pour sŌĆÖappliquer ├Ā la cause g├®n├®ratrice de ces repr├®sentations.
Mais il arrive aussi que le philosophe de cette ├®cole aille jusquŌĆÖ├Ā se dire : Je suis emprisonn├® dans le monde de mes repr├®sentations, je nŌĆÖai aucun moyen dŌĆÖen sortir. Si je pense une chose situ├®e derri├©re mes repr├®sentations, cette pens├®e elle-m├¬me nŌĆÖest quŌĆÖune de mes repr├®sentations. Cet id├®alisme, alors, se met ├Ā nier les ┬½choses en soi┬╗, ou ├Ā d├®clarer quŌĆÖelles nŌĆÖont, du point de vue humain, aucune signification, cŌĆÖest-├Ā-dire quŌĆÖelles sont comme si elles nŌĆÖexistaient pas, parce que nous ne pouvons rien savoir dŌĆÖelles.
LŌĆÖid├®alisme critique, alors, consid├©re lŌĆÖunivers entier comme un r├¬ve vis-├Ā-vis duquel toute tentative de connaissance est simplement absurde. Il s├®pare alors les hommes en deux cat├®gories : les primitifs, qui prennent leurs propres hallucinations pour des choses r├®elles ; les sages, qui ont compris le n├®ant de cet univers de r├¬ve, et perdent peu ├Ā peu tout d├®sir de sŌĆÖen pr├®occuper. Ces philosophes en arrivent ├Ā consid├®rer que le propre moi lui-m├¬me est illusoire. De m├¬me que, parmi les images de nos r├¬ves nocturnes, notre propre image parfois nous appara├«t, de m├¬me, la repr├®sentation du moi sŌĆÖajoute, dans la conscience ├®veill├®e, ├Ā la repr├®sentation du monde ext├®rieur. Ce que nous avons alors dans notre conscience nŌĆÖest pas notre v├®ritable moi, mais seulement notre repr├®sentation du moi. Or, si lŌĆÖon nie quŌĆÖil existe des choses, ou, tout au moins, que lŌĆÖon ne puisse rien savoir dŌĆÖelles, on doit ├®galement nier lŌĆÖexistence du moi et, a fortiori, la possibilit├® de le conna├«tre. LŌĆÖid├®alisme critique va jusquŌĆÖ├Ā d├®clarer : ┬½Toute r├®alit├® se transforme en un r├¬ve merveilleux, o├╣ il nŌĆÖy a plus ni existence sur laquelle sŌĆÖ├®difie le r├¬ve, ni esprit o├╣ habite le r├¬ve ; un r├¬ve qui nŌĆÖest solidaire de lui-m├¬me que par le r├¬ve┬╗ [voir: "La destination de lŌĆÖhomme" par Fichte].
LorsquŌĆÖon croit avoir ainsi reconnu que lŌĆÖexistence imm├®diate est un r├¬ve, il importe peu quŌĆÖon rapporte ses repr├®sentations ├Ā des choses r├®elles ou que lŌĆÖon suppose que rien nŌĆÖexiste au-del├Ā ; cŌĆÖest la vie elle-m├¬me qui perd tout int├®r├¬t scientifique. Pour la th├®orie qui croit ├®puiser, lorsquŌĆÖelle a parl├® du r├¬ve, la somme de ce qui nous est accessible, toute science est une folie. Pour lŌĆÖautre th├®orie, qui se croit autoris├®e ├Ā d├®duire de nos repr├®sentations lŌĆÖexistence des ┬½choses en soi┬╗, la science ne peut consister que dans la recherche de ces ┬½choses en soi┬╗. La premi├©re de ces conceptions peut ├¬tre nomm├®e lŌĆÖillusionnisme absolu ; la seconde a ├®t├® nomm├®e par ├ēdouard von Hartmann, qui est son repr├®sentant principal, le R├®alisme Transcendantal [nota: Cette conception se nomme transcendantale, parce quŌĆÖelle affirme que lŌĆÖon ne peut rien conna├«tre directement des choses en soi, mais que lŌĆÖon peut indirectement et par induction passer, de lŌĆÖ├®l├®ment subjectif connu, ├Ā lŌĆÖ├®l├®ment inconnu situ├® au del├Ā du subjectif (transcendant). La chose en soi, dans cette philosophie, est au del├Ā du domaine imm├®diatement connaissable, cŌĆÖest-├Ā-dire quŌĆÖelle est transcendante. Mais on peut, transcendentalement, rapporter notre monde au monde transcendant. La conception dŌĆÖHartmann se nomme r├®alisme, parce que, au del├Ā du subjectif (id├®el), elle atteint le transcendant (r├®el)].
Ces deux th├®ories ont ceci de commun avec le r├®alisme primitif, quŌĆÖelles cherchent ├Ā prendre pied dans lŌĆÖunivers gr├óce ├Ā un examen de la perception. Mais il leur est impossible de trouver, l├Ā, le sol ferme.
Il se pose, pour le r├®aliste transcendantal, une question de toute importance : comment le moi produit-il, de lui-m├¬me, le monde des repr├®sentations ? Ce monde des repr├®sentations, qui nous est offert, et qui dispara├«t d├©s que nous fermons nos sens au monde ext├®rieur, ne peut ├®veiller lŌĆÖint├®r├¬t que sŌĆÖil est le moyen de conna├«tre imm├®diatement le monde de lŌĆÖen soi. Si les donn├®es de lŌĆÖexp├®rience ├®taient des repr├®sentations, notre vie quotidienne ressemblerait ├Ā un r├¬ve, et la connaissance du v├®ritable ├®tat de fait ressemblerait ├Ā un ├®veil. M├¬me nos r├¬ves nocturnes nous int├®ressent aussi longtemps que nous r├¬vons, et que, par cons├®quent, nous ne per├¦ons pas ├Ā jour la nature illusoire du r├¬ve. Mais, au moment o├╣ nous nous ├®veillons, nous ne nous demandons plus quel est le rapport int├®rieur de nos r├¬ves entre eux : nous cherchons les ph├®nom├©nes physiques, physiologiques et psychologiques qui sont ├Ā leur base. De m├¬me, le philosophe ne saurait sŌĆÖint├®resser ├Ā des rapports de d├®tail, faisant partie dŌĆÖun monde quŌĆÖil tient pour sa repr├®sentation. Au cas o├╣ il accorde lŌĆÖexistence dŌĆÖun moi r├®el, il ne cherchera pas comment les repr├®sentations se rapportent les unes aux autres, mais ce qui se produit, dans lŌĆÖ├óme ind├®pendante dŌĆÖelles, pendant leur apparition et pendant leur succession. Lorsque je r├¬ve que je bois un vin qui me cause une irritation dans la gorge, et quŌĆÖensuite je me r├®veille en toussant [voir: Weigandt, "LŌĆÖorigine des, R├¬ves"], lŌĆÖaction qui se d├®roulait en r├¬ve cesse de mŌĆÖint├®resser d├©s lŌĆÖinstant o├╣ je me r├®veille. Mon attention ne se dirige que sur les ph├®nom├©nes physiologiques et psychologiques par lesquels le besoin de tousser sŌĆÖest exprim├® symboliquement dans le r├¬ve. De m├¬me, le philosophe, d├©s lŌĆÖinstant o├╣ il se persuade de la nature repr├®sentative du monde, doit imm├®diatement passer, de ce monde, ├Ā la r├®alit├® cach├®e quŌĆÖil manifeste. ├ēvidemment, la chose devient plus difficile lorsque lŌĆÖillusionnisme va jusquŌĆÖ├Ā nier enti├©rement lŌĆÖexistence du moi, ou le tient pour inconnaissable. Car sŌĆÖil existe, en face de lŌĆÖ├®tat de r├¬ve, un ├®tat de veille qui permet de percer ├Ā jour la nature du r├¬ve, ses lois intimes, et de les ramener ├Ā des ph├®nom├©nes r├®els, on ne voit pas imm├®diatement, par contre, quŌĆÖaucun ├®tat serve de correctif analogue ├Ā notre conscience ordinaire. Or, se ranger ├Ā cette opinion, cŌĆÖest m├®conna├«tre quŌĆÖil y a, en fait, une activit├® qui se comporte vis-├Ā-vis de la simple perception comme la veille se comporte vis-├Ā-vis du r├¬ve. Cette activit├®, cŌĆÖest la pens├®e.
On ne saurait reprocher ├Ā lŌĆÖhomme primitif ce manque de clairvoyance. Cet homme, en effet, sŌĆÖadonne ├Ā la vie et tient les choses pour r├®elles dans la forme o├╣ elles sŌĆÖoffrent ├Ā son exp├®rience. Mais le premier pas que lŌĆÖon fait pour sortir de cet ├®tat primitif m├©ne ├Ā se demander comment la pens├®e se comporte-t-elle vis-├Ā-vis de la perception ? Peu importe que la perception subsiste ou non, avant et apr├©s mon acte de perception, dans la forme o├╣ elle mŌĆÖa ├®t├® donn├®e. Quoi que je d├®clare ├Ā son sujet, je ne puis le faire que par lŌĆÖauxiliaire de la pens├®e. Lorsque je dis : ┬½Le monde est ma repr├®sentation┬╗, jŌĆÖ├®nonce le r├®sultat dŌĆÖun travail de ma pens├®e. Et si ma pens├®e est inapte ├Ā sŌĆÖappliquer ├Ā lŌĆÖunivers, ce que jŌĆÖ├®nonce est faux. Entre la perception et toute proposition la concernant, il y a eu intervention de la pens├®e.
Nous avons d├®j├Ā marqu├® [voir: chapitre "3. La pens├®e instrument de la conception du monde" - rechercher "ce que je dis ici de la pens├®e"] la raison pour laquelle, durant lŌĆÖobservation des choses, nous laissons g├®n├®ralement passer inaper├¦u le r├┤le de la pens├®e. Cela r├®sulte du fait que notre attention se fixe sur lŌĆÖobjet que nous pensons, et ne peut sŌĆÖappliquer en m├¬me temps ├Ā la pens├®e elle-m├¬me. CŌĆÖest pourquoi la conscience de lŌĆÖhomme simple traite la pens├®e comme une activit├® qui nŌĆÖa rien ├Ā voir avec les objets, une activit├® qui demeure ├Ā part de ceux-ci et qui se borne ├Ā les consid├®rer. LorsquŌĆÖun penseur trace le tableau des apparences de lŌĆÖunivers, ce tableau nŌĆÖest g├®n├®ralement pas consid├®r├® comme une partie des choses r├®elles ; on croit g├®n├®ralement quŌĆÖil nŌĆÖexiste que dans la t├¬te de lŌĆÖhomme. LŌĆÖunivers, dit-on, est absolument achev├® quant ├Ā toutes ses substances et toutes ses ├®nergies, et lŌĆÖhomme trace un tableau de cet univers achev├®. Il est permis de demander ├Ā ceux qui pensent de la sorte : De quel droit affirmez-vous que lŌĆÖunivers est achev├® sans la pens├®e ? Est-ce que lŌĆÖunivers nŌĆÖengendre pas la pens├®e dans la t├¬te de lŌĆÖhomme avec autant de n├®cessit├® quŌĆÖil engendre la fleur sur la plante ? Plantez une graine dans la terre. Elle pousse une racine et une tige. Elle d├®veloppe des feuilles et des fleurs. Mettez-vous en face de la plante. Elle se joint dans votre ├óme ├Ā un certain concept. Pourquoi ce concept appartient-il moins ├Ā la plante que sa feuille et sa fleur ? Vous dites : ┬½La feuille et la fleur sont l├Ā sans quŌĆÖaucun sujet les per├¦oive, par contre le concept nŌĆÖappara├«t que lorsque lŌĆÖhomme consid├©re la plante┬╗. Fort bien. Mais la feuille et la fleur aussi nŌĆÖapparaissent que si la terre est l├Ā pour recevoir la graine de la plante, que si lŌĆÖair et la lumi├©re sont l├Ā, pour permettre son ├®panouissement. De la m├¬me mani├©re, le concept de la plante appara├«t quand une conscience pensante sŌĆÖapproche de cette plante.
Il est absolument arbitraire de tenir pour une totalit├®, pour un tout achev├®, ce que nous apprenons des choses par la simple perception, et dŌĆÖy ajouter lŌĆÖactivit├® pensante comme un surplus qui nŌĆÖa rien ├Ā faire avec les choses elles-m├¬mes. Si je vois aujourdŌĆÖhui un rameau portant un bouton de rose, lŌĆÖimage qui sŌĆÖoffre ├Ā ma perception est, tout dŌĆÖabord, une image achev├®e ; mais que je mette le rameau de rosier dans lŌĆÖeau, et, demain, jŌĆÖaurai de mon objet une image toute nouvelle. Si je ne d├®tourne pas mon regard de ce bouton de rose, je le verrai passer de lŌĆÖ├®tat actuel ├Ā son ├®tat futur par dŌĆÖinnombrables phases formant une continuit├®. LŌĆÖimage qui sŌĆÖoffre ├Ā un instant quelconque nŌĆÖest quŌĆÖune d├®coupure, faite au hasard, dans un objet qui est en perp├®tuel devenir. Si je ne mets pas le rameau dans lŌĆÖeau, tous ces ├®tats dont il avait la possibilit├® ne se d├®veloppent pas. Je peux ├®galement ├¬tre emp├¬ch├® dŌĆÖobserver demain ma fleur, et je nŌĆÖen aurai, en ce cas, quŌĆÖune image incompl├©te. Ce serait une opinion d├®pourvue de toute objectivit├® que celle qui, devant lŌĆÖimage passag├©re, obtenue ├Ā un instant quelconque, d├®clarerait : ┬½Ceci est la r├®alit├®┬╗.
Il en va de m├¬me de ceux qui pr├®tendent quŌĆÖune chose est constitu├®e par la somme des caract├®ristiques de la perception quŌĆÖelle fournit. Il serait parfaitement possible quŌĆÖun esprit re├¦├╗t le concept en m├¬me temps que la perception, et sans aucune s├®paration entre ces deux termes. Un esprit de cette sorte nŌĆÖaurait jamais lŌĆÖid├®e de consid├®rer le concept comme un terme nŌĆÖappartenant pas ├Ā la chose. Il serait oblig├® de lui attribuer une existence ins├®parable de la chose.
Un exemple expliquera mieux ce que jŌĆÖentends dire. Lorsque je jette une pierre en lŌĆÖair, dans une direction horizontale, je vois cette pierre occuper successivement des lieux diff├®rents. Je r├®unis ces lieux par une ligne. JŌĆÖapprends, en math├®matique, ├Ā conna├«tre diverses formes lin├®aires, en particulier celle de la parabole. JŌĆÖapprends que la parabole appara├«t lorsquŌĆÖun point se meut selon certaines lois. Lorsque jŌĆÖexamine ensuite les conditions dans lesquelles la pierre lanc├®e se meut, je trouve que la ligne de son mouvement est identique ├Ā celle que je connais sous le nom de parabole. Que la pierre d├®crive une parabole, cela sŌĆÖensuit des conditions donn├®es, et en r├®sulte n├®cessairement. La forme de la parabole appartient ├Ā lŌĆÖensemble du ph├®nom├©ne au m├¬me titre que tous les autres ├®l├®ments. Pour lŌĆÖesprit que nous supposions plus haut, et qui nŌĆÖaurait pas besoin de prendre le d├®tour de la pens├®e, il nŌĆÖy aurait pas une simple suite de perceptions visuelles montrant la pierre en diff├®rents endroits, mais il y aurait aussi, indissolublement li├®e au ph├®nom├©ne, la forme parabolique que nous lui ajoutons par lŌĆÖexercice de notre pens├®e.
Si les objets nous sont donn├®s de prime abord sans leur concept, cela tient ├Ā notre organisation spirituelle, et non point ├Ā ces objets eux-m├¬mes. Nous sommes organis├®s de telle sorte que les ├®l├®ments constitutifs de chaque chose nous arrivent de deux sources : celle de la perception et celle de la pens├®e.
La mani├©re dont je suis organis├® pour appr├®hender les choses nŌĆÖa rien ├Ā voir avec la nature m├¬me de ces choses. La scission entre la perception et la pens├®e nŌĆÖexiste quŌĆÖ├Ā lŌĆÖinstant o├╣ moi, observateur, je mŌĆÖadresse ├Ā ces choses. On ne saurait ├®tablir quels ├®l├®ments appartiennent ├Ā la chose, et quels ├®l├®ments ne lui appartiennent point, dŌĆÖapr├©s le mode de connaissance par lequel jŌĆÖacc├©de ├Ā ces ├®l├®ments.
LŌĆÖhomme est un ├¬tre limit├®, un ├¬tre compris parmi dŌĆÖautres ├¬tres. Son existence est li├®e au temps et ├Ā lŌĆÖespace. Il ne peut donc jamais lui ├¬tre donn├® quŌĆÖune partie limit├®e de lŌĆÖunivers. Mais cette partie limit├®e se relie, dans le temps comme dans lŌĆÖespace, au reste de lŌĆÖunivers. Si notre existence ├®tait accord├®e aux choses de telle mani├©re que chaque ph├®nom├©ne de lŌĆÖunivers f├╗t notre ph├®nom├©ne, alors la diff├®rence entre les choses et nous nŌĆÖexisterait pas. Et il nŌĆÖy aurait pas alors, pour nous, de choses multiples. Tout le devenir se fondrait en une continuit├®. Le cosmos serait une unit├®, une totalit├® ferm├®e. Le fleuve du devenir coulerait sans nulle interruption. CŌĆÖest ├Ā cause de notre limitation que nous voyons sous forme de multiplicit├®, ce qui, en r├®alit├®, est une unit├®. Par exemple, la qualit├® de rouge nŌĆÖexiste nulle part ├Ā lŌĆÖ├®tat isol├®. Elle est li├®e de toutes parts ├Ā dŌĆÖautres qualit├®s auxquelles elle appartient et sans lesquelles elle ne pourrait subsister. Mais il nous est n├®cessaire dŌĆÖextraire de lŌĆÖunivers des ├®l├®ments isol├®s et de les consid├®rer ├Ā part. DŌĆÖun ensemble de couleurs multiples, notre oeil ne peut saisir les couleurs que s├®par├®ment et successivement. DŌĆÖun syst├©me indivisible de concepts, notre entendement ne peut saisir que des concepts isol├®s. Ce morcellement est un acte subjectif, qui sŌĆÖexplique par ce fait que nous ne sommes pas identiques au devenir universel, mais que notre ├¬tre nŌĆÖen est quŌĆÖun membre limit├® parmi dŌĆÖautres membres.
Tout d├®pend, ├Ā pr├®sent, de la position que nous allons d├®terminer comme ├®tant celle de notre ├¬tre parmi les autres ├¬tres. Cette d├®termination ne doit pas ├¬tre confondue avec la simple conscience du moi. Celle-ci repose sur la perception, comme la conscience de toutes les autres choses. LŌĆÖauto-perception me montre une somme de qualit├®s que je r├®unis en une conception de ma personnalit├® comme je r├®unis ┬½jaune┬╗, ┬½m├®tallique┬╗, etc., en une conception ┬½or┬╗. LŌĆÖauto-perception ne me m├©ne point au del├Ā de ce qui mŌĆÖappartient. Il faut la distinguer de la d├®termination pensante de mon moi. De m├¬me que, par la pens├®e, jŌĆÖins├©re une perception isol├®e dans la totalit├® de lŌĆÖunivers, de m├¬me, par la pens├®e, jŌĆÖincorpore au devenir universelles les perceptions que je fais en moi-m├¬me. Mon auto-perception mŌĆÖenferme dans certaines limites ; ma pens├®e ignore ces limites. En ce sens, je suis un ├¬tre double. Je suis enferm├® dans ces limites que je per├¦ois comme ├®tant celles de ma personnalit├® ; mais je suis porteur dŌĆÖune activit├® qui, du haut dŌĆÖune sph├©re sup├®rieure, d├®termine mon existence.
Notre pens├®e nŌĆÖest pas individuelle comme notre sensibilit├®. Elle est universelle. Si elle acquiert un caract├©re individuel en chacun de nous, cŌĆÖest seulement parce que nous la rapportons ├Ā notre sensibilit├®. Les hommes se distinguent les uns des autres par les nuances particuli├©res dont ils rev├¬tent lŌĆÖessence universelle de la pens├®e. Un triangle nŌĆÖa quŌĆÖun concept. Il nŌĆÖimporte pas au contenu de ce concept que ce soit la conscience humaine A ou B qui le con├¦oive. Mais chacune de ces consciences humaines le con├¦oit dŌĆÖune mani├©re individuelle.
Contre la v├®rit├® que nous venons dŌĆÖ├®noncer, il y a, dans lŌĆÖesprit des hommes, un pr├®jug├® fort difficile ├Ā vaincre. Ils arrivent p├®niblement ├Ā admettre que le concept de triangle, tel quŌĆÖil existe dans ma t├¬te, soit le m├¬me que dans la t├¬te de mon voisin. LŌĆÖhomme spontan├®ment, se croit cr├®ateur de ses concepts. Il croit, en cons├®quence, que chaque personne poss├©de ses concepts en propre. La pens├®e philosophique doit sŌĆÖimposer, comme toute premi├©re t├óche, de vaincre ce pr├®jug├®. Le concept unique du triangle ne devient pas multiple par le fait quŌĆÖil est pens├® par des esprits multiples. Car la pens├®e de ces esprits multiples est, elle-m├¬me, une unit├®.
La pens├®e est lŌĆÖ├®l├®ment par lequel nos individualit├®s multiples se r├®unissent au cosmos, pour former un tout. Tant que nous avons des sensations, des sentiments, et des perceptions, nous sommes isol├®s ; mais lorsque nous pensons, nous sommes lŌĆÖ├¬tre unique et indivisible qui p├®n├©tre tout. Telle est la raison profonde de la dualit├® de notre nature. Nous sentons na├«tre en nous une force dŌĆÖun caract├©re absolu, une force qui est universelle, mais nous nŌĆÖapprenons pas ├Ā la conna├«tre ├Ā sa source m├¬me qui serait pour ainsi dire le centre du monde ; nous la trouvons ├Ā un point de la p├®riph├®rie. Si nous la saisissions ├Ā sa source, nous conna├«trions, d├©s lŌĆÖinstant o├╣ nous deviendrions conscients, le mot de toute lŌĆÖ├®nigme universelle. Mais comme nous nous trouvons en un point de la p├®riph├®rie, et comme notre propre existence est soumise ├Ā certaines limites, il nous faut apprendre ├Ā conna├«tre le domaine ext├®rieur ├Ā notre ├¬tre ; cŌĆÖest ce que nous faisons par lŌĆÖauxiliaire de la pens├®e, parce quŌĆÖelle est en quelque sorte le prolongement que lŌĆÖ├¬tre global de lŌĆÖunivers envoie en nous.
La soif de conna├«tre r├®sulte pr├®cis├®ment en nous de ce que la pens├®e, pr├®sente en nous, d├®passe notre existence particuli├©re et se rapporte ├Ā la vie universelle du cosmos. Les ├¬tres d├®pourvus de pens├®e ignorent la soif de conna├«tre. LorsquŌĆÖils se trouvent en face dŌĆÖautres objets, il ne se pose en eux nulle question. Les autres objets leur demeurent ext├®rieurs. Au contraire, chez les ├¬tres pensants, les objets ext├®rieurs font surgir le concept. Il est, parmi les ├®l├®ments de lŌĆÖobjet, celui que nous recevons non plus du dehors, mais du dedans de notre ├¬tre. LŌĆÖ├®quilibre et lŌĆÖunion des deux ├®l├®ments, lŌĆÖun ext├®rieur, lŌĆÖautre int├®rieur, tel est le but m├¬me de la connaissance.
Par cons├®quent, la perception nŌĆÖest pas une chose achev├®e ni compl├©te en soi, mais seulement une face de la r├®alit├® totale. LŌĆÖautre face, cŌĆÖest le concept. LŌĆÖacte de connaissance est la synth├©se de la perception et du concept. Perception et concept, ├Ā eux deux, forment la totalit├® de lŌĆÖobjet.
Les consid├®rations qui pr├®c├©dent ont prouv├® quŌĆÖil est inutile de chercher, dans les ├¬tres particuliers qui composent lŌĆÖunivers, un autre ├®l├®ment commun que lŌĆÖ├®l├®ment id├®el fourni par la pens├®e. Toutes les tentatives que lŌĆÖon a faites pour trouver une unit├® cosmique qui diff├©re de celle que nous acqu├®rons par lŌĆÖexamen pensant de nos perceptions, ont forc├®ment ├®chou├®. Cette unit├® ne peut ├¬tre ni un Dieu humain, personnel, ni la Force, ni la Mati├©re, ni la Volont├® priv├®e dŌĆÖintelligence (Schopenhauer). Toutes ces entit├®s nŌĆÖappartiennent quŌĆÖ├Ā un domaine limit├® de notre observation. Nous ne trouvons la personnalit├® limit├®e, humaine, quŌĆÖen nous ; nous ne trouvons la force et la mati├©re que dans les choses ext├®rieures. En ce qui concerne la volont├®, elle ne peut ├¬tre consid├®r├®e que comme la manifestation active de notre personne limit├®e. Schopenhauer veut ├®viter de faire supporter lŌĆÖunit├® universelle par la pens├®e ┬½abstraite┬╗, et il cherche ├Ā sa place quelque chose qui lui paraisse dŌĆÖune r├®alit├® plus imm├®diate. Ce philosophe croit que nous ne nous rapprocherons jamais de lŌĆÖunivers en le consid├®rant comme un monde ext├®rieur :
┬½En fait, on ne trouverait jamais la signification dŌĆÖun univers qui nŌĆÖest que ma repr├®sentation, ou le passage de cette pure repr├®sentation subjective ├Ā ce quŌĆÖelle peut ├¬tre en dehors de moi, - on ne trouverait jamais cette signification si lŌĆÖobservateur nŌĆÖ├®tait rien de plus que sujet connaissant (t├¬te dŌĆÖange ail├®e, sans corps). Mais cet observateur est enracin├® dans lŌĆÖunivers, il y est situ├® en qualit├® dŌĆÖindividu, cŌĆÖest-├Ā-dire que sa connaissance, qui est le porteur du ┬½monde comme repr├®sentation┬╗ et qui le conditionne, est r├®ellement transmise par un corps, dont les affections, nous lŌĆÖavons montr├®, fournissent un point de d├®part pour la compr├®hension de ce monde. Ce corps nŌĆÖest pour le sujet connaissant quŌĆÖune repr├®sentation comme les autres, un objet parmi les objets : les mouvements, les actions de ce corps ne lui sont pas connus dŌĆÖune autre mani├©re que les changements des autres objets de connaissance, et lui resteraient ├®galement ├®trangers et incompr├®hensibles si leur sens ne se d├®voilait ├Ā lui dŌĆÖune tout autre mani├©re... Le sujet de la connaissance, par son identit├® avec le corps, est individu, et ce corps lui est donn├® selon deux modes diff├®rents : une fois comme repr├®sentation de son intelligence, ├Ā titre dŌĆÖobjet parmi les autres et soumis aux m├¬mes lois que ceux-ci et, une autre fois, dŌĆÖune tout autre mani├©re, ├Ā savoir, dans cette chose intimement connue de lui que d├®signe le mot volont├®. Chaque v├®ritable acte de sa volont├®, est forc├®ment un mouvement de son corps. Il ne peut pas vouloir r├®ellement un acte sans, en m├¬me temps, percevoir que cet acte se manifeste par des mouvements de son corps. LŌĆÖacte volontaire et les actions du corps ne sont pas deux ├®tats diff├®rents objectivement reconnus et li├®s par une causalit├® ; ils ne se trouvent pas dans un rapport de cause et dŌĆÖeffet. Ils sont une seule et m├¬me chose, mais donn├®e par deux voies radicalement diff├®rentes : une fois tout ├Ā fait directement, et une fois dans la repr├®sentation de lŌĆÖintelligence.┬╗
Schopenhauer se croit autoris├®, par ces explications, ├Ā voir dans le corps de lŌĆÖhomme lŌĆÖ┬½objectit├®┬╗ de sa volont├®. Il croit sentir in concreto, dans les actions du corps, une r├®alit├® imm├®diate, la ┬½chose en soi┬╗. Nous lui objecterons que les actions de notre corps ne nous sont connues que par des auto-perceptions. D├©s que nous voulons conna├«tre leur nature, nous ne le pouvons que par lŌĆÖauxiliaire de la pens├®e, cŌĆÖest-├Ā-dire en les incorporant au syst├©me id├®el de nos concepts.
LŌĆÖid├®e que la pens├®e est une chose abstraite, priv├®e de r├®alit├® concr├©te, est profond├®ment ancr├®e dans la conscience courante des hommes ; lŌĆÖon croit le plus souvent que cette pens├®e est apte tout au plus ├Ā nous donner un ┬½pendant┬╗ id├®el de lŌĆÖunit├® du monde, mais non point cette unit├® elle-m├¬me. Tant que lŌĆÖon en juge de la sorte, cŌĆÖest que lŌĆÖon ne sŌĆÖest point rendu compte de ce quŌĆÖest la perception sans le concept. Examinons le monde de la perception : il appara├«t comme une simple juxtaposition dans lŌĆÖespace, et comme une simple succession dans le temps, comme un agr├®gat chaotique dŌĆÖobjets isol├®s. Ces choses qui apparaissent, puis disparaissent, dans ce champ de la perception, nŌĆÖont entre elles aucun rapport direct qui se puisse percevoir. L├Ā, le monde nŌĆÖest quŌĆÖune multitude dŌĆÖobjets ├®gaux en valeur. Aucun de ces objets ne joue un r├┤le plus consid├®rable que lŌĆÖautre. Pour savoir quŌĆÖun objet a plus dŌĆÖimportance quŌĆÖun autre, il nous faut interroger notre pens├®e. Si la pens├®e ne fonctionne pas, un organe rudimentaire quelconque, ne jouant aucun r├┤le dans lŌĆÖ├®conomie dŌĆÖun animal, semble avoir la m├¬me valeur que les parties les plus consid├®rables de son organisme. Pour ├®clairer le sens que poss├©de tel ou tel d├®tail, relativement aux autres d├®tails, il faut que la pens├®e jette le pont dŌĆÖun ├¬tre ├Ā lŌĆÖautre. Cette activit├® pensante est donc dŌĆÖune richesse concr├©te lorsquŌĆÖil sŌĆÖagit de savoir pourquoi lŌĆÖescargot poss├©de un organisme inf├®rieur ├Ā celui du lion, il faut vraiment un contenu concret. La simple vue de ces animaux, la perception, ne me donne aucun ├®l├®ment concret capable dŌĆÖenseigner quelle est la perfection de leurs organismes.
Ce contenu concret, la pens├®e lŌĆÖapporte ├Ā la rencontre de la perception ; elle le puise au monde des concepts et des id├®es. Contrairement au contenu perceptif qui nous est donn├® du dehors, le contenu id├®el appara├«t en nous. Nous appellerons intuition la forme sous laquelle il appara├«t de prime abord. LŌĆÖintuition est ├Ā la pens├®e ce que lŌĆÖobservation est ├Ā la perception. Intuition et observation sont les sources de notre connaissance. Nous restons ├®trangers aux choses que nous observons, tant que nous nŌĆÖavons pas en nous lŌĆÖintuition qui leur correspond, et qui compl├©te la r├®alit├® dont la perception ne donne quŌĆÖune partie. LŌĆÖhomme qui nŌĆÖa pas le don de trouver, pour chaque chose, lŌĆÖintuition correspondante, ne peut acc├®der ├Ā la pleine r├®alit├®. De m├¬me que lŌĆÖindividu atteint de daltonisme ne voit que des nuances de clair et dŌĆÖobscur, sans aucune qualit├® color├®e, de m├¬me lŌĆÖindividu priv├® de facult├® intuitive nŌĆÖa que des fragments de perception, qui demeurent sans relation les uns avec les autres.
Expliquer une chose, la rendre compr├®hensible, cela veut dire quŌĆÖon la replace dans lŌĆÖensemble de rapports dont elle avait ├®t├® arrach├®e par la conformation sp├®cifique de notre ├¬tre, d├®finie ci-dessus. Il nŌĆÖexiste aucune chose qui soit s├®par├®e du tout. La s├®paration des choses nŌĆÖa quŌĆÖune valeur subjective, elle nŌĆÖexiste quŌĆÖau sein de notre organisation. Pour nous, le tout se divise en : haut et bas, avant et apr├©s, cause et effet, objet et repr├®sentation, mati├©re et force, objet et sujet, etc.. Ce qui, de la sorte, appara├«t s├®par├®ment ├Ā notre observation, se relie ensuite membre ├Ā membre gr├óce au monde indivisible de lŌĆÖintuition ; la pens├®e nous permet de refondre en un tout ce que la perception avait s├®par├®.
Le caract├©re ├®nigmatique des objets tient ├Ā leur isolement. Or, cet isolement est provoqu├® par nous, et il peut prendre fin gr├óce ├Ā nous.
Hors de la pens├®e et de la perception, rien ne nous est directement donn├®. D├©s lors se pose la question suivante : quŌĆÖadvient-il des consid├®rations que nous avons faites plus haut sur la signification de la perception ? Nous avons reconnu que la d├®monstration, faite par lŌĆÖid├®alisme critique, de la subjectivit├® des perceptions, sŌĆÖ├®croulait dŌĆÖelle-m├¬me ; mais la fausset├® de cette d├®monstration ne prouve pas que la chose soit une erreur. LŌĆÖid├®alisme critique ne fait pas sa d├®monstration ├Ā partir de la nature absolue de la pens├®e, mais il la base sur ce fait que le r├®alisme primitif, poursuivi jusquŌĆÖen ses cons├®quences, se r├®fute de lui-m├¬me. QuŌĆÖarrive-t-il lorsquŌĆÖon part de la nature absolue de la pens├®e ?
Admettons quŌĆÖune certaine perception apparaisse dans ma conscience, par exemple le ┬½rouge┬╗. Cette perception, ├Ā la mieux examiner, se montre li├®e ├Ā dŌĆÖautres perceptions : par exemple, ├Ā une certaine figure, ├Ā certaines sensations thermiques ou tactiles. Ce rapport, je dis quŌĆÖil est un objet du monde des sens. Je puis alors me demander : quŌĆÖy a-t-il encore dans cette portion dŌĆÖespace o├╣ ces premi├©res perceptions me sont apparues ? JŌĆÖy trouverai des ph├®nom├©nes m├®caniques, chimiques et autres. Je vais alors plus loin, jŌĆÖexamine les ph├®nom├©nes qui constituent le passage de lŌĆÖobjet ├Ā mes organes des sens. Je trouve, par exemple, des mouvements produits dans un milieu ├®lastique, et dont la nature est fonci├©rement diff├®rente de ce quŌĆÖest ma perception originelle. Si je poursuis mon chemin, de lŌĆÖorgane des sens, jusquŌĆÖ├Ā lŌĆÖenc├®phale, jŌĆÖobtiens un r├®sultat semblable. En chaque nouveau domaine, je fais de nouvelles d├®couvertes ; mais ce qui relie entre elles toutes ces perceptions ├®parses dans le temps et lŌĆÖespace, cŌĆÖest ma pens├®e. Les vibrations qui transmettent le son dans lŌĆÖair me sont donn├®es ├Ā titre de perceptions comme le son lui-m├¬me. Seule, la pens├®e organise ces perceptions et les montre dans leurs relations r├®ciproques.
Nous nŌĆÖavons aucun droit ├Ā dire quŌĆÖil existe, en dehors de ce qui est imm├®diatement perceptible, une autre r├®alit├® que les rapports id├®els des perceptions entre elles (rapports que la pens├®e peut conna├«tre). La relation des objets de perception ├Ā un sujet percepteur est purement id├®elle, cŌĆÖest-├Ā-dire, elle ne peut sŌĆÖexprimer quŌĆÖen concepts. Si les choses ├®taient telles quŌĆÖil me soit possible de percevoir comment lŌĆÖobjet de perception affecte le sujet percepteur, ou, au contraire, si je pouvais observer lŌĆÖ├®dification de lŌĆÖimage de perception par le sujet, il serait possible de parler comme le font la physiologie moderne et lŌĆÖid├®alisme critique qui repose sur elle. Cette philosophie prend une relation id├®elle (de lŌĆÖobjet au sujet) pour un processus, dont on ne pourrait parler comme elle le fait que sŌĆÖil ├®tait possible de le percevoir. La proposition ┬½sans oeil sensible ├Ā la couleur, point de couleur┬╗ ne peut donc en aucun cas signifier que lŌĆÖoeil engendre la couleur, mais seulement quŌĆÖil existe entre la perception ┬½couleur┬╗ et la perception ┬½oeil┬╗ un rapport id├®el accessible ├Ā notre pens├®e. La science empirique aura ├Ā ├®tablir comment se comportent les unes vis-├Ā-vis des autres les propri├®t├®s de lŌĆÖoeil et celles de la couleur ; gr├óce ├Ā quels organes lŌĆÖoeil transmet la perception des couleurs, etc.. Je puis observer comment les perceptions se succ├©dent, et comment elles sŌĆÖagencent dans lŌĆÖespace et je puis exprimer conceptuellement les r├®sultats de mes observations mais je ne saurais jamais percevoir comment une perception na├«t du non-perceptible. Tous les efforts que lŌĆÖon peut faire pour trouver entre les perceptions autre chose que des relations de pens├®e, sont dŌĆÖavance condamn├®s ├Ā lŌĆÖ├®chec.
QuŌĆÖest-ce donc que la perception ? Ainsi pos├®e dŌĆÖune mani├©re g├®n├®rale, la question est absurde. La perception se manifeste toujours par un contenu pr├®cis et concret. Ce contenu est une donn├®e imm├®diate, il est enti├©rement constitu├® par cette donn├®e. La seule question est de savoir ce quŌĆÖil est hors de la perception, cŌĆÖest-├Ā-dire pour la pens├®e. Le probl├©me de la nature en soi des perceptions ne peut donc se r├®soudre quŌĆÖen le transportant ├Ā lŌĆÖintuition conceptuelle correspondante. De ce point de vue l├Ā, on ne peut plus poser, ├Ā la mani├©re de lŌĆÖid├®alisme critique, la question de la subjectivit├® de la perception. On ne peut plus qualifier de ┬½subjectif┬╗ que ce qui a ├®t├® per├¦u comme appartenant au sujet. Cr├®er un lien entre lŌĆÖobjectif et le subjectif, cela nŌĆÖest point lŌĆÖaffaire dŌĆÖun processus r├®el au sens primitif de ce mot, cŌĆÖest-├Ā-dire dŌĆÖun ph├®nom├©ne perceptible, mais seulement lŌĆÖaffaire de la pens├®e. Nous tiendrons donc pour objectif ce que la perception trouve situ├® en dehors du sujet. Mon sujet percepteur demeure perceptible pour moi lorsque la table qui ├®tait devant moi dispara├«t ├Ā mon regard. LŌĆÖobservation de la table a provoqu├® en moi une transformation qui demeure par la suite. Je garde la facult├® de recr├®er lŌĆÖimage de la table. Cette facult├® dŌĆÖengendrer une image est d├©s lors ins├®parable de moi. La psychologie nomme cette image une repr├®sentation de la m├®moire, mais elle est la seule chose que lŌĆÖon puisse ├Ā bon droit nommer une repr├®sentation. Elle r├®sulte du changement provoqu├® en moi par la pr├®sence de la table. Non point le changement de quelque moi ┬½en soi┬╗, cach├® derri├©re les perceptions, mais le changement de mon sujet perceptible lui-m├¬me. La repr├®sentation est donc une perception subjective, par opposition ├Ā la perception objective qui se fait en pr├®sence de lŌĆÖobjet. Parce que lŌĆÖid├®alisme critique a confondu ces deux perceptions, lŌĆÖune subjective, lŌĆÖautre objective, il a ├®t├® amen├® au malentendu que nous avons signal├® plus haut : ┬½le monde est ma repr├®sentation┬╗.
Il ne sŌĆÖagit plus maintenant que de pr├®ciser le concept de repr├®sentation. Ce que nous avons d├®fini jusquŌĆÖ├Ā pr├®sent, ce nŌĆÖest point le concept de la repr├®sentation, mais seulement la voie par laquelle on trouve cette derni├©re dans le champ perceptible. Lorsque nous aurons pr├®cis├® le concept de repr├®sentation, il nous sera possible de nous expliquer clairement le rapport de la repr├®sentation ├Ā lŌĆÖobjet. CŌĆÖest l├Ā ce qui nous permettra de franchir la limite au del├Ā de laquelle le rapport du sujet humain ├Ā lŌĆÖobjet, et par cons├®quent ├Ā lŌĆÖunivers, ├®chappe au domaine purement conceptuel, et descend dans la vie concr├©te, individuelle. Et, lorsque nous saurons ce que nous pouvons saisir de lŌĆÖunivers, il nous sera facile dŌĆÖen d├®duire notre conduite. On ne peut agir de toutes ses forces que lorsque lŌĆÖon conna├«t lŌĆÖobjet auquel on consacre son activit├®.
APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
La conception philosophique que nous venons dŌĆÖexaminer peut ├¬tre consid├®r├®e comme une mani├©re de voir ├Ā laquelle lŌĆÖhomme est amen├® tout naturellement, d├©s quŌĆÖil commence ├Ā r├®fl├®chir sur ses rapports avec lŌĆÖunivers. L├Ā, il sŌĆÖengage dans une impasse o├╣ les pens├®es sŌĆÖ├®vanouissent ├Ā mesure quŌĆÖil les croit tenir. Il ne suffit pas de r├®futer simplement cette conception philosophique, il est n├®cessaire de la vivre int├®rieurement, afin dŌĆÖapercevoir lŌĆÖab├«me dŌĆÖerreur auquel elle m├©ne, et dŌĆÖen trouver lŌĆÖissue. Si lŌĆÖon se doit de lui faire place dans des consid├®rations comme celles-ci sur le rapport de lŌĆÖhomme ├Ā lŌĆÖunivers, ce nŌĆÖest pas parce que lŌĆÖon d├®sire r├®futer dŌĆÖautres penseurs dont on trouve lŌĆÖopinion erron├®e. CŌĆÖest parce quŌĆÖil faut conna├«tre lŌĆÖab├«me dŌĆÖerreur qui guette lŌĆÖhomme lors de ses premi├©res r├®flexions sur ces choses. Il faut que lŌĆÖon arrive ├Ā comprendre comment on r├®fute soi-m├¬me le r├®sultat de ses premi├©res r├®flexions. CŌĆÖest dans cet esprit que les expos├®s ci-dessus ont ├®t├® ├®crits.
Celui qui veut se faire une opinion sur le rapport de lŌĆÖhomme ├Ā lŌĆÖunivers, se rend compte quŌĆÖil ├®tablit au moins une partie de ce rapport lorsquŌĆÖil se repr├®sente les choses et les ph├®nom├©nes. Par l├Ā, son attention se d├®tourne de ce qui est en dehors pour sŌĆÖappliquer ├Ā ce qui est en dedans de lŌĆÖhomme : les repr├®sentations. LŌĆÖhomme commence alors ├Ā se dire : Je ne puis avoir de rapport avec aucune chose, avec aucun ph├®nom├©ne, sans quŌĆÖune repr├®sentation sŌĆÖ├®l├©ve en moi. De l├Ā, il nŌĆÖy a quŌĆÖun pas ├Ā faire pour se dire : Je nŌĆÖai dŌĆÖautre exp├®rience que celle de mes repr├®sentations ; je ne sais rien du monde ext├®rieur que ce qui en est la repr├®sentation en moi. Concevoir cette opinion, cŌĆÖest abandonner le point de vue primitif quŌĆÖon avait avant de r├®fl├®chir sur le rapport de lŌĆÖhomme ├Ā lŌĆÖunivers. Arriv├® l├Ā, on croit avoir affaire aux choses r├®elles. Mais si lŌĆÖon r├®fl├®chit plus consciemment sur soi-m├¬me, on se voit oblig├® dŌĆÖabandonner ce point de vue. On sŌĆÖaper├¦oit quŌĆÖil est impossible dŌĆÖatteindre une r├®alit├® dans le sens o├╣ lŌĆÖentend le r├®alisme primitif, mais seulement ses repr├®sentations. Celles-ci sŌĆÖinterposent entre lŌĆÖ├¬tre propre de lŌĆÖhomme et le soi-disant monde r├®el entendu au sens du r├®alisme primitif. Ce monde r├®el-l├Ā, lŌĆÖhomme ne peut plus y acc├®der ├Ā travers le voile des repr├®sentations. Il lui faut se r├®signer ├Ā ├¬tre aveugle quant ├Ā cette r├®alit├®-l├Ā. Ainsi se forme la croyance en une ┬½chose en soi┬╗ inaccessible ├Ā la connaissance. Tant que lŌĆÖon se borne ├Ā consid├®rer lŌĆÖunion du monde et de lŌĆÖhomme telle quŌĆÖelle semble sŌĆÖaccomplir par lŌĆÖauxiliaire de la repr├®sentation, on ne peut ├®chapper ├Ā cette impasse de la pens├®e. Pour se contenter du r├®alisme primitif, il faudrait faire taire artificiellement tout d├®sir de connaissance. Le seul fait quŌĆÖil existe en nous un d├®sir de conna├«tre notre rapport avec le monde prouve lŌĆÖinsuffisance du r├®alisme primitif, car si son point de vue imm├®diat et spontan├® nous fournissait une certitude, lŌĆÖhomme sŌĆÖen tiendrait satisfait. Or, lŌĆÖon nŌĆÖarrive point davantage ├Ā la certitude lorsquŌĆÖon abandonne simplement le point de vue primitif, tout en conservant, sans sŌĆÖen douter, la mani├©re de penser quŌĆÖil implique. Telle est la faute de ceux qui disent : ┬½Je ne poss├©de que mes repr├®sentations, et tandis que je crois avoir devant moi des r├®alit├®s, je ne prends conscience que de mes repr├®sentations de ces r├®alit├®s ; il me faut donc admettre que les r├®alit├®s v├®ritables existent en dehors du champ de ma conscience ; je ne sais rien dŌĆÖelles directement, mais elles arrivent ├Ā moi dŌĆÖune mani├©re quelconque et mŌĆÖinfluencent de telle sorte que les repr├®sentations sŌĆÖ├®l├©vent en moi.┬╗ Penser ainsi, cŌĆÖest surajouter au monde ext├®rieur imm├®diat un second monde mais, en ce qui concerne ce second monde, il faudrait, au fond, recommencer la m├¬me op├®ration de pens├®e. Car la ┬½chose en soi┬╗, inconnue, dans son rapport avec lŌĆÖ├¬tre intime de lŌĆÖhomme, nŌĆÖy est pas con├¦ue autrement que le soi-disant monde r├®el du r├®alisme primitif. Pour ├®chapper ├Ā ce tissu dŌĆÖerreurs, auquel la r├®flexion critique m├©ne tout dŌĆÖabord, il faut remarquer quŌĆÖil existe, int├®rieurement ├Ā ce quŌĆÖon per├¦oit du monde et ├Ā ce quŌĆÖon per├¦oit en soi-m├¬me, un principe inattaquable devant lequel la repr├®sentation ne saurait sŌĆÖinterposer pour nous en d├®rober la vue. Ce principe, cŌĆÖest la pens├®e.
Vis-├Ā-vis de la pens├®e, lŌĆÖhomme peut en rester au point de vue primitif. SŌĆÖil ne le fait pas, cŌĆÖest parce quŌĆÖil a remarqu├® que, pour toutes les autres choses, il lui fallait abandonner ce point de vue ; il a omis de voir que sa critique ne sŌĆÖappliquait pas ├Ā la pens├®e. D├©s quŌĆÖil sŌĆÖen aper├¦oit, une certitude nouvelle sŌĆÖoffre ├Ā lui ; cŌĆÖest que, dans la pens├®e, et par la pens├®e, il pourra conna├«tre le monde r├®el, devant lequel il sŌĆÖaveuglait en le d├®robant sous le voile des repr├®sentations.
Il a ├®t├® reproch├® ├Ā lŌĆÖauteur de ce livre, par un penseur quŌĆÖil tient en haute consid├®ration, dŌĆÖen demeurer ├Ā un ┬½r├®alisme primitif de la pens├®e┬╗, semblable au r├®alisme qui tient le monde r├®el, et le monde des repr├®sentations, pour une seule et m├¬me r├®alit├®. Or, lŌĆÖauteur croit justement avoir d├®montr├® que ce ┬½r├®alisme primitif┬╗, sŌĆÖil nŌĆÖest valable pour aucune autre chose, ressort cependant avec ├®vidence dŌĆÖune analyse scrupuleuse et sinc├©re de la pens├®e et que ce r├®alisme primitif ne peut pr├®cis├®ment ├¬tre vaincu que lorsque nous prenons connaissance de la v├®ritable nature de notre pens├®e.
6. LŌĆÖindividualit├® humaine
La difficult├® principale, pour les philosophes qui cherchent ├Ā sŌĆÖexpliquer la repr├®sentation, cŌĆÖest que nous ne sommes pas identiques aux choses ext├®rieures, et que nos repr├®sentations doivent cependant avoir un aspect qui corresponde ├Ā ces choses. Vue dŌĆÖun peu plus pr├©s, cette difficult├® sŌĆÖ├®vanouit. Certes, nous ne sommes pas les choses ext├®rieures, mais nous et elles faisons partie dŌĆÖun seul et m├¬me univers. La parcelle de cet univers que je sens ├¬tre mon ┬½sujet┬╗, nŌĆÖen est pas moins travers├®e par le fleuve, du devenir g├®n├®ral. Je me per├¦ois tout dŌĆÖabord comme ├®tant limit├® par lŌĆÖenveloppe physique de mon corps, mais ce qui est contenu dans ce corps appartient au cosmos qui est un tout. Pour quŌĆÖune relation sŌĆÖ├®tablisse entre mon organisme et les objets environnants, il nŌĆÖest pas du tout n├®cessaire que quelque chose de ces objets sŌĆÖintroduise en moi, ou sŌĆÖimprime dans mon esprit comme un cachet dans la cire. Se demander : ┬½Comment aurai-je la notion de cet arbre qui se dresse ├Ā dix pas de moi ?┬╗ cŌĆÖest mal poser la question. CŌĆÖest se figurer que les limites du corps sont des cloisons absolues ├Ā travers lesquelles p├®n├©trent les nouvelles venues du dehors. En r├®alit├®, les forces qui agissent ├Ā lŌĆÖint├®rieur de mon corps sont les m├¬mes que celles du dehors. Je suis r├®ellement les choses, sinon en tant que sujet, du moins en tant que partie du devenir universel, et la perception de lŌĆÖarbre est confondue dans un tout dont je fais aussi partie. Le devenir universel engendre la perception de cet arbre, comme il engendre la perception de mon propre moi. Si jŌĆÖ├®tais, non plus observateur, mais cr├®ateur du monde, lŌĆÖobjet et le sujet (perception et moi) seraient engendr├®s uno actu. Car ils se conditionnent lŌĆÖun lŌĆÖautre. En tant quŌĆÖobservateur du monde, je puis, gr├óce ├Ā la pens├®e, ramener lŌĆÖune ├Ā lŌĆÖautre ces deux faces de lŌĆÖ├¬tre, d├®couvrir lŌĆÖ├®l├®ment commun entre elles, et les relier par les concepts qui sŌĆÖy rapportent.
Ce qui sera le plus difficile ├Ā ├®liminer des esprits actuels, ce sont les soi-disant preuves physiologiques de la subjectivit├® de nos perceptions. Lorsque jŌĆÖexerce une pression sur ma peau, je per├¦ois une sensation de pression. Cette m├¬me pression pourrait provoquer dans lŌĆÖoeil la sensation de lumi├©re, dans lŌĆÖoreille lŌĆÖaudition dŌĆÖun son. Une commotion ├®lectrique provoque une lumi├©re dans lŌĆÖoeil, une sonorit├® dans lŌĆÖoreille, les nerfs du toucher la traduisent en sensation de choc et ceux de lŌĆÖodorat en odeur de phosphore. QuŌĆÖen peut-on conclure ? seulement ceci : je per├¦ois un choc ├®lectrique (une pression), auquel sŌĆÖajoute une qualit├® lumineuse, un son, une odeur. SŌĆÖil nŌĆÖy avait pas dŌĆÖoeil, aucune qualit├® lumineuse ne sŌĆÖassocierait ├Ā la perception des ph├®nom├©nes vibratoires produits dans lŌĆÖatmosph├©re ; de m├¬me en lŌĆÖabsence de toute oreille, elle ne sŌĆÖaccompagnerait dŌĆÖaucune perception sonore. Mais de quel droit affirmer que sans organes de perception, le ph├®nom├©ne total nŌĆÖexisterait pas ? Lorsque, du fait quŌĆÖun ph├®nom├©ne ├®lectrique produit dans lŌĆÖoeil de la lumi├©re, on conclut que toute lumi├©re per├¦ue nŌĆÖest, en dehors de notre organisme, quŌĆÖun ph├®nom├©ne m├®canique, on oublie que cŌĆÖest passer dŌĆÖune esp├©ce de perception ├Ā une autre esp├©ce de perception, mais point ├Ā quelque chose dŌĆÖext├®rieur ├Ā la perception. De m├¬me quŌĆÖon peut dire lŌĆÖoeil per├¦oit les ph├®nom├©nes m├®caniques de son entourage sous forme de lumi├©re, on peut dire aussi : nous percevons sous forme de mouvement la modification r├®guli├©re dŌĆÖune image. LorsquŌĆÖon peint sur le pourtour dŌĆÖune plaque tournante douze images de cheval, dans les positions successives de la course, la rotation de la plaque am├©ne lŌĆÖillusion du mouvement. Il suffit pour cela de regarder par une ouverture et de faire tourner la plaque ├Ā la vitesse voulue on ne voit pas douze chevaux, mais un cheval qui court.
Les faits physiologiques que lŌĆÖon vient de citer ne jettent donc aucune lumi├©re sur les rapports de la perception et de la repr├®sentation. Il faut nous tourner dŌĆÖun autre c├┤t├®.
├Ć lŌĆÖinstant o├╣ une perception appara├«t dans le champ de ma conscience, ma pens├®e entre en activit├®. Un certain membre de mon syst├©me id├®el, une certaine intuition, un concept, sŌĆÖassocient ├Ā ma perception. Lorsque ensuite la perception sŌĆÖ├®teint, que me reste-t-il ? Mon intuition, telle quŌĆÖelle sŌĆÖest form├®e au moment de cette perception, et toujours attach├®e ├Ā elle. Je puis, plus tard, me rappeler cette intuition, et son rapport avec une perception d├®finie. LŌĆÖintensit├® de mon souvenir d├®pend de la mani├©re dont fonctionne mon organisme corporel et spirituel. La repr├®sentation nŌĆÖest pas autre chose quŌĆÖune intuition rapport├®e ├Ā une certaine perception, un concept qui fut une fois li├® ├Ā une perception, et auquel demeure attach├® le souvenir de cette perception. Mon concept lion nŌĆÖest pas form├® de la perception que jŌĆÖai eue dŌĆÖun ou de plusieurs lions. Mais ma repr├®sentation des lions a ├®t├® form├®e ├Ā une perception. Je pourrai faire acqu├®rir ├Ā quelquŌĆÖun le concept du lion sans quŌĆÖil en ait jamais vu, mais je ne pourrai lui en donner une repr├®sentation vivante.
La repr├®sentation est donc un concept individualis├®. Et, d├©s lors, sŌĆÖexplique le fait que les choses ext├®rieures puissent figurer en nous sous forme de repr├®sentations. La pleine r├®alit├® dŌĆÖune chose nous est donn├®e, au moment o├╣ nous lŌĆÖobservons, par lŌĆÖunion du concept et de la perception. Le concept re├¦oit, de la perception, un aspect individuel cŌĆÖest sous cet aspect, particularis├® par le rapport ├Ā une perception d├®finie, que le concept se perp├®tue en nous et forme la repr├®sentation de la chose per├¦ue. QuŌĆÖon rencontre une seconde chose ├Ā laquelle sŌĆÖunisse le m├¬me concept, et lŌĆÖon reconna├«t quŌĆÖelle appartient ├Ā la m├¬me esp├©ce que la premi├©re ; quŌĆÖon rencontre la chose elle-m├¬me une seconde fois, alors on trouve dans son syst├©me conceptuel, non pas seulement un concept appropri├®, mais le m├¬me concept individualis├®, dans son rapport avec la premi├©re perception, et cŌĆÖest alors que lŌĆÖon reconna├«t la chose.
La repr├®sentation occupe une place interm├®diaire entre la perception et le concept. Elle est le concept d├®fini, attach├® ├Ā une perception pr├®cise.
La somme des repr├®sentations que je puis former, cŌĆÖest ce que je puis nommer mon exp├®rience. Un homme a une exp├®rience dŌĆÖautant plus riche quŌĆÖil a une plus grande somme de concepts individualis├®s. Un homme auquel manque tout pouvoir dŌĆÖintuition nŌĆÖest pas capable dŌĆÖacqu├®rir de lŌĆÖexp├®rience. Il oublie les objets d├©s quŌĆÖils sortent de son champ dŌĆÖobservation, parce quŌĆÖil lui manque les concepts ├Ā leur relier. Un homme dont la pens├®e est normale, mais dont les organes des sens fournissent des perceptions imparfaites, est ├®galement incapable dŌĆÖamasser de lŌĆÖexp├®rience. Il peut, certes, acqu├®rir des concepts dŌĆÖune mani├©re ou de lŌĆÖautre, mais il manque ├Ā ses intuitions la relation vivante avec des choses per├¦ues. Le voyageur inintelligent, et le savant plong├® dans des conceptions abstraites, sont ├®galement inaptes ├Ā sŌĆÖenrichir dŌĆÖune v├®ritable exp├®rience.
La r├®alit├® sŌĆÖoffre ├Ā nous dans lŌĆÖunion de la perception et du concept. La repr├®sentation est la figure subjective de cette r├®alit├®.
Si notre personnalit├® ne se manifestait que par la connaissance, la somme de toute r├®alit├® objective serait contenue dans la perception, le concept et la repr├®sentation.
Mais nous ne nous contentons pas de rapporter, avec lŌĆÖaide de notre pens├®e, nos perceptions ├Ā des concepts. Nous les rapportons aussi ├Ā notre propre subjectivit├®, ├Ā notre moi individuel. LŌĆÖexpression de ce rapport individuel, cŌĆÖest le sentiment de plaisir ou de douleur.
Penser et sentir, ce sont les deux activit├®s relatives aux deux natures de lŌĆÖhomme auxquelles nous avons d├®j├Ā fait allusion : par la pens├®e, lŌĆÖhomme participe au devenir cosmique par le sentiment, il se retire dans lŌĆÖintimit├® de son propre ├¬tre.
Notre pens├®e nous unit au monde ; notre sentiment nous ram├©ne en nous-m├¬me et fait de nous un individu. Si nous nŌĆÖ├®tions capables que de penser et de percevoir, notre existence sŌĆÖ├®coulerait dans une monotonie indiff├®rente. Si nous ne savions que conna├«tre notre moi, nous serions parfaitement indiff├®rents ├Ā nous-m├¬mes. Mais, ├Ā cette connaissance du moi, sŌĆÖajoute le sentiment du moi ; ├Ā la perception des choses, sŌĆÖunit de la joie ou de la douleur ; et, par l├Ā seulement, nous sommes des ├¬tres individuels, dont lŌĆÖexistence ne consiste pas uniquement en un rapport conceptuel avec les autres ├¬tres, mais poss├©de en soi sa propre valeur.
On pourrait ├¬tre tent├® dŌĆÖattribuer ├Ā la vie sentimentale un contenu plus r├®el quŌĆÖ├Ā la pens├®e. Mais cette r├®alit├® plus grande nŌĆÖexiste quŌĆÖaux yeux de mon propre individu. Pour lŌĆÖensemble du monde, ma vie sentimentale nŌĆÖacquiert une valeur que lorsque le sentiment, devenant lŌĆÖobjet dŌĆÖune perception int├®rieure, entre en rapport avec un concept, et sŌĆÖincorpore de la sorte au reste de lŌĆÖunivers.
Notre vie est une oscillation perp├®tuelle entre la participation au devenir cosmique et ├Ā notre ├¬tre individuel. Plus nous nous ├®levons dans le domaine g├®n├®ral de la pens├®e, o├╣ lŌĆÖindividuel finit par ne plus ├¬tre quŌĆÖun certain exemple du concept, plus se perd en nous le caract├©re personnel.
Au contraire, plus nous nous enfon├¦ons dans les profondeurs de nous-m├¬mes, plus nous laissons r├®sonner ├Ā chaque exp├®rience lŌĆÖ├®cho de nos sentiments, plus nous nous isolons de lŌĆÖ├¬tre universel. La v├®ritable individualit├® est celle qui transpose ses sentiments dans le domaine de lŌĆÖid├®el. Il y a des hommes pour qui les id├®es les plus g├®n├®rales, lorsquŌĆÖelles sont entr├®es dans leur t├¬te, y rev├¬tent une nuance particuli├©re qui les ferait reconna├«tre, sans erreur possible, pour les leurs. DŌĆÖautres, au contraire, ont des concepts si d├®nu├®s de toute originalit├® quŌĆÖon se demande sŌĆÖils ont bien ├®t├® pens├®s par un ├¬tre de chair et de sang.
La repr├®sentation marque d├®j├Ā dans notre vie intellectuelle une certaine empreinte dŌĆÖindividualit├®. Chacun de nous se place, pour consid├®rer le monde, ├Ā son point de vue particulier. Lorsque les concepts viennent sŌĆÖadjoindre ├Ā nos perceptions, chacun de nous les pense ├Ā sa fa├¦on. Ceci r├®sulte de ce que notre situation, notre milieu, et lŌĆÖ├®tendue de notre domaine de perceptions, sont choses absolument personnelles.
├Ć cette diff├®renciation il sŌĆÖen oppose une autre, celle qui d├®pend de notre organisation spirituelle et corporelle. Cette organisation est une chose unique et bien d├®finie. Chacun de nous associe ├Ā ses perceptions des sentiments d├®finis, dont lŌĆÖintensit├® varie infiniment. CŌĆÖest l├Ā le facteur individuel, qui se surajoute ├Ā toutes les diff├®renciations d├®j├Ā caus├®es par notre situation et notre milieu.
Une vie sentimentale d├®pourvue de toute pens├®e perdrait bient├┤t tout contact avec le monde. Chez lŌĆÖhomme capable de se r├®aliser pleinement, la connaissance des choses va de pair avec le d├®veloppement et lŌĆÖaffinement de la vie sentimentale.
CŌĆÖest par le sentiment que les concepts commencent ├Ā sŌĆÖanimer dŌĆÖune vie concr├©te.
7. Y a-t-il des limites ├Ā la connaissance ?
Nous avons ├®tabli dans les pr├®c├®dents chapitres que lŌĆÖhomme emprunte les ├®l├®ments de sa connaissance ├Ā deux sources, qui sont la perception et la pens├®e. Comme nous lŌĆÖavons dit, nous sommes organis├®s de telle sorte que la r├®alit├® pleine et totale, ├Ā lŌĆÖinclusion de notre propre sujet, nous appara├«t dŌĆÖabord comme une dualit├®. La connaissance triomphe de cette dualit├® en reforgeant un tout unique avec les deux ├®l├®ments de la r├®alit├® : la perception dŌĆÖune part, le concept ├®labor├® par la pens├®e dŌĆÖautre part. Appelons ┬½monde des apparences┬╗ lŌĆÖaspect sous lequel nous apercevons lŌĆÖunivers avant que notre connaissance lui ait rendu sa forme r├®elle. Alors nous pourrons dire que le monde nous pr├®sente une dualit├® mais que notre connaissance en recompose lŌĆÖunit├®. Une philosophie qui part de ce principe peut ├¬tre nomm├®e monisme. La th├®orie adverse est celle des deux mondes, le dualisme. Cette derni├©re suppose, non pas deux moiti├®s, s├®par├®es par nous, dŌĆÖune seule r├®alit├®, mais deux r├®alit├®s absolument diff├®rentes. Il cherche ensuite, dans lŌĆÖun de ces deux domaines, les bases dŌĆÖune explication de lŌĆÖautre.
Le dualisme repose sur une fausse d├®finition de la connaissance. Il s├®pare lŌĆÖ├¬tre total en deux domaines ext├®rieurs lŌĆÖun ├Ā lŌĆÖautre, et entre lesquels aucun contact nŌĆÖest possible.
CŌĆÖest de ce dualisme quŌĆÖest n├®e la distinction entre lŌĆÖobjet per├¦u et la ┬½chose en soi┬╗ telle que Kant lŌĆÖa introduite dans la philosophie, qui ne sŌĆÖen est pas d├®barrass├®e encore jusquŌĆÖ├Ā nos jours. DŌĆÖapr├©s les expos├®s qui pr├®c├©dent, lŌĆÖorganisation de lŌĆÖhomme implique quŌĆÖune chose ne peut jamais lui ├¬tre donn├®e quŌĆÖ├Ā titre de perception. La pens├®e triomphe ensuite de lŌĆÖisolement des perceptions, en mettant chacune ├Ā la place qui lui revient dans lŌĆÖordre universel. Aussi longtemps que nous consid├®rons les diverses parties du tout comme des perceptions, nous ob├®issons simplement, en les distinguant, ├Ā une loi de notre ├¬tre subjectif. Mais poser la somme de nos perceptions comme une, partie du tout, et supposer ensuite une seconde partie qui serait la chose en soi, cŌĆÖest philosopher dans les nuages. Il nŌĆÖy a l├Ā quŌĆÖun jeu de concepts. On construit une opposition artificielle, et on ne parvient pas ├Ā donner un contenu au second des deux domaines, car le contenu dŌĆÖune chose ne saurait jamais ├¬tre puis├®, par lŌĆÖhomme, que dans la perception.
Toute modalit├® dŌĆÖ├¬tre qui ├®chappe au domaine de la perception et du concept, est ├Ā rejeter ├Ā titre dŌĆÖhypoth├©se injustifi├®e. CŌĆÖest dans cette cat├®gorie que rentre la ┬½chose en soi┬╗. Il est tr├©s naturel que le penseur dualiste ne trouve aucune relation entre un principe aussi hypoth├®tique et les donn├®es de lŌĆÖexp├®rience. Pour pr├®ciser son principe hypoth├®tique, il lui faut emprunter un contenu au monde des perceptions, et se dissimuler ce compromis ├Ā lui-m├¬me. Ou alors, la ┬½chose en soi┬╗ demeure vide, cŌĆÖest un non-concept, elle nŌĆÖa que la forme du concept. Le penseur dualiste affirme g├®n├®ralement quŌĆÖelle est inaccessible ├Ā notre connaissance : on sait quŌĆÖil existe quelque chose, mais on ignore quoi. Dans tous les cas, la victoire du dualisme est impossible. Si lŌĆÖon pr├®cise le concept de ┬½chose en soi┬╗ en lui attribuant quelques propri├®t├®s abstraites, emprunt├®es au monde de lŌĆÖexp├®rience, il demeure impossible de ramener la riche r├®alit├® de la vie concr├©te ├Ā quelques ├®l├®ments quŌĆÖon lui a emprunt├®s. Du Bois-Raymond pense que les positions et les mouvements mat├®riels dŌĆÖatomes imperceptibles engendrent la sensation et le sentiment, et il conclut : ┬½Nous ne pourrons jamais expliquer dŌĆÖune mani├©re satisfaisante comment la mati├©re et le mouvement donnent naissance ├Ā l├Ā sensation et au sentiment┬╗, car : ┬½il est ├Ā jamais incompr├®hensible que des atomes de carbone, dŌĆÖhydrog├©ne, dŌĆÖazote, etc., ne soient pas indiff├®rents ├Ā leur position et ├Ā leurs mouvements, pass├®s, pr├®sents et futurs. Il nŌĆÖest pas possible dŌĆÖentrevoir comment la conscience pourrait surgir de leurs r├®actions.┬╗ Cette conclusion caract├®rise les tendances de la pens├®e moderne. Du monde de lŌĆÖexp├®rience, on extrait la position et le mouvement. On les transporte dans le monde purement hypoth├®tique des atomes. Puis on sŌĆÖ├®tonne que de ces principes, fabriqu├®s de toutes pi├©ces avec quelques ├®l├®ments tir├®s de lŌĆÖexp├®rience, on ne puisse faire d├®couler toute la r├®alit├®.
Que ce dualisme, qui se sert dŌĆÖun concept dŌĆÖ┬½en soi┬╗, totalement vide, soit impuissant ├Ā expliquer le monde, cŌĆÖest ce qui sŌĆÖensuit de la d├®finition de ce principe, telle que nous lŌĆÖavons donn├®e plus haut.
Le dualisme se voit toujours oblig├® dŌĆÖassigner ├Ā notre pouvoir de conna├«tre dŌĆÖinfranchissables limites. Au contraire, le monisme sait que tous les ├®l├®ments n├®cessaires ├Ā la compr├®hension dŌĆÖun ph├®nom├©ne existent et sont perceptibles quelque part dans le monde. Ce qui souvent nous emp├¬che dŌĆÖy acc├®der, ce sont des obstacles de nature spatiale ou temporelle, ou encore des lacunes de notre organisation, mais entendons bien de notre organisation individuelle, non point de lŌĆÖorganisation humaine en g├®n├®ral.
De la d├®finition de la connaissance, telle que nous lŌĆÖavons donn├®e plus haut, r├®sulte quŌĆÖon ne saurait lui assigner des limites. La connaissance nŌĆÖest pas un ├®v├©nement cosmique quelconque, cŌĆÖest une affaire que lŌĆÖhomme r├©gle avec lui-m├¬me. Les choses ne demandent pas ├Ā ├¬tre expliqu├®es. Elles existent et agissent les unes sur les autres dŌĆÖapr├©s certaines lois, que la pens├®e peut trouver. Elles existent indissolublement li├®es ├Ā ces lois. Notre personnalit├® les rencontre et ne saisit dŌĆÖelles, tout dŌĆÖabord, que ce que nous avons d├®fini sous le nom de perception. Mais dans notre personnalit├® r├®side aussi la force de saisir lŌĆÖautre partie de la r├®alit├®. Lorsque le moi a su r├®unir en lui les deux ├®l├®ments qui, dans le monde, sont indissolublement li├®s, alors le besoin de conna├«tre trouve sa satisfaction : le moi a retrouv├® la r├®alit├®.
Les conditions premi├©res de lŌĆÖapparition de la connaissance concernent donc le moi. CŌĆÖest lui qui se pose ├Ā lui-m├¬me des questions. Et il les emprunte ├Ā lŌĆÖ├®l├®ment parfaitement lucide et transparent de la pens├®e. Lorsque nous nous posons des questions auxquelles la r├®ponse est impossible, cŌĆÖest que quelque chose manque ├Ā la clart├® et ├Ā la logique de nos questions, car ce nŌĆÖest pas le monde qui les pose, cŌĆÖest nous-m├¬mes.
Il pourrait me manquer la possibilit├® de r├®pondre ├Ā une question que je trouverais quelque part toute formul├®e, si je ne connaissais pas la sph├©re ├Ā laquelle elle a ├®t├® puis├®e.
Mais, en ce qui concerne notre connaissance, les questions se posent en vertu de lŌĆÖopposition, qui surgit en nous, entre une sph├©re de concepts universels, et une sph├©re de perceptions conditionn├®es au contraire par le lieu, le temps, et notre organisme. Notre t├óche est de r├®unir lŌĆÖune ├Ā lŌĆÖautre ces deux sph├©res que nous connaissons bien. L├Ā, on ne saurait parler dŌĆÖune limite de la connaissance. Tel ou tel probl├©me peut rester obscur momentan├®ment, parce que notre poste dŌĆÖobservation ne nous permet pas dŌĆÖen percevoir tous les ├®l├®ments. Mais ce quŌĆÖon nŌĆÖa pas d├®couvert aujourdŌĆÖhui peut se d├®couvrir demain. Les limites de cette sorte sont ├®ph├®m├©res, elles pourront reculer avec le progr├©s de la perception et de la pens├®e.
Le dualisme commet la faute de reporter sur des r├®alit├®s purement hypoth├®tiques, ├®trang├©res ├Ā ce monde, la relation de sujet ├Ā objet, qui nŌĆÖa de sens que dans le monde des perceptions.
Comme les choses, qui sont s├®par├®es dans le champ de la perception, cessent de lŌĆÖ├¬tre d├©s que le sujet percepteur exerce sa pens├®e sur elles, parce que cette pens├®e an├®antit toute s├®paration en en d├®voilant le caract├©re subjectif, on peut dire que le dualisme accorde ├Ā des entit├®s transcendantes des qualit├®s qui, m├¬me pour la perception, nŌĆÖont quŌĆÖune valeur relative. Il subdivise les deux facteurs de la connaissance, perception et concept, en quatre facteurs : 1┬░ LŌĆÖobjet en soi ; 2┬░ la perception que le sujet a de lŌĆÖobjet ; 3┬░ le sujet ; 4┬░ le concept qui ram├©ne la perception ├Ā son objet en soi. La relation de lŌĆÖobjet au sujet est r├®elle ; le sujet est r├®ellement (dynamiquement) influenc├® par lŌĆÖobjet. Ce processus r├®el ne parvient pas ├Ā notre conscience, mais il provoque dans le sujet une r├®action contre lŌĆÖinfluence re├¦ue de lŌĆÖobjet le r├®sultat de cette r├®action est la perception, qui, elle, parvient ├Ā la conscience. LŌĆÖobjet a une r├®alit├® objective (ind├®pendante du sujet) et la perception, une r├®alit├® subjective. Cette r├®alit├® subjective, le sujet la reporte sur lŌĆÖobjet, et ce transfert est de nature id├®elle. Le dualisme divise donc lŌĆÖacte de connaissance en deux parties : lŌĆÖune, production de lŌĆÖobjet de perception par la chose en soi, se passe hors de la conscience. LŌĆÖautre, r├®union de la perception au concept et de celui-ci ├Ā lŌĆÖobjet, se passe dans la conscience. Dans ces conditions, il est clair que le dualiste tient ses concepts pour des repr├®sentants, subjectifs seulement, de ce qui se passe hors de sa conscience. Il doit donc estimer que le processus objectif (r├®el), qui a lieu dans le sujet pour que la perception apparaisse, lui est inconnaissable, et, ├Ā fortiori, les qualit├®s objectives de la chose en soi. LŌĆÖhomme, ├Ā son avis, nŌĆÖen peut conna├«tre que les repr├®sentants conceptuels. LŌĆÖ├®l├®ment unificateur qui relie les choses, objectivement, entre elles, et avec notre esprit individuel pris en soi, nŌĆÖexiste quŌĆÖen dehors de la conscience, dans un monde de lŌĆÖen soi dont nous ne pouvons ├®galement avoir, dans notre conscience, que les repr├®sentants conceptuels.
Le dualisme estime que ce serait r├®duire lŌĆÖunivers ├Ā un sch├®ma dŌĆÖabstractions que de ne point supposer, ├Ā c├┤t├® des rapports conceptuels, dŌĆÖautres rapports r├®els. En dŌĆÖautres termes : les principes ┬½id├®aux┬╗ trouv├®s par la pens├®e semblent trop a├®riens aux penseurs dualistes, il leur faut encore des principes ┬½substantiels┬╗ soutenant les premiers.
Examinons ces principes. LŌĆÖhomme simple (r├®aliste primitif) consid├©re les objets de lŌĆÖexp├®rience ext├®rieure comme des r├®alit├®s. Le fait quŌĆÖil les peut voir de ses yeux, toucher de ses mains, lui para├«t ├¬tre un t├®moignage de leur r├®alit├®. ┬½Rien nŌĆÖexiste quŌĆÖon ne puisse percevoir┬╗, tel est son axiome, et il peut ├¬tre retourn├® ┬½tout ce quŌĆÖon peut percevoir existe.┬╗ La meilleure preuve en est la mani├©re dont cet homme se repr├®sente lŌĆÖimmortalit├® et les esprits. Il imagine lŌĆÖ├óme comme une mati├©re subtile qui peut m├¬me, dans certaines circonstances, devenir visible au regard des humains (croyance aux fant├┤mes).
Pour ce r├®aliste primitif, tout le reste, ├Ā savoir le monde des id├®es, para├«t priv├® de r├®alit├®, ┬½purement id├®el┬╗. Ce que notre r├®flexion pensante ajoute aux choses, cŌĆÖest, trouve-t-il, une activit├® qui sŌĆÖexerce sur les choses, mais nŌĆÖy unit rien de r├®el.
Ce nŌĆÖest pas seulement pour ├®tablir lŌĆÖexistence des choses que lŌĆÖhomme simple en appelle au t├®moignage de ses sens, mais aussi pour ├®tablir leur devenir. ├Ć son avis, une chose nŌĆÖagit sur une autre chose que si lŌĆÖon peut percevoir une force qui na├«t de lŌĆÖune et agit sur lŌĆÖautre. La physique ancienne croyait quŌĆÖune mati├©re tr├©s subtile rayonnait des objets et entrait dans notre ├óme par la voie de nos organes des sens. La vue de cette mati├©re subtile ├®tait, disait-on, inaccessible ├Ā la grossi├©ret├® de nos sens. Mais, en principe, si lŌĆÖon admettait la r├®alit├® de cette mati├©re rayonnante, cŌĆÖ├®tait ├Ā cause de son mode dŌĆÖexistence, que lŌĆÖon imaginait ├¬tre analogue ├Ā celui de la r├®alit├® sensible.
Pour la conscience primitive, lŌĆÖexp├®rience id├®elle, malgr├® son caract├©re absolu, para├«t moins r├®elle que lŌĆÖexp├®rience sensible. Un objet con├¦u seulement ┬½en pens├®e┬╗ ne vaut que comme chim├©re, jusquŌĆÖ├Ā ce que la conviction de sa r├®alit├® soit fournie par la perception sensible.
On peut dire, en r├®sum├®, que lŌĆÖhomme simple exige, en plus du t├®moignage id├®el de la pens├®e, le t├®moignage r├®el des sens. CŌĆÖest dans ce besoin que se trouve lŌĆÖorigine des croyances r├®v├®l├®es, tout au moins sous leur forme premi├©re. Le Dieu qui nous est donn├® par la pens├®e nŌĆÖest, pour la conscience primitive, quŌĆÖun Dieu ┬½imagin├®┬╗. Cette conscience primitive exige que Dieu se r├®v├©le par des moyens accessibles ├Ā la perception des sens. Il faut que Dieu apparaisse sous forme corporelle et lŌĆÖon accorde moins de confiance aux attestations de la pens├®e, quŌĆÖ├Ā un fait d├╗ment constat├® par les sens, tel que pourrait lŌĆÖ├¬tre, par exemple, la transformation de lŌĆÖeau en vin.
Il nŌĆÖest pas jusquŌĆÖ├Ā lŌĆÖacte de connaissance que cette conscience primitive ne se repr├®sente comme un processus analogue aux processus sensibles : les choses produisent une impression dans lŌĆÖ├óme, ou bien elles envoient des images qui p├®n├©trent par la voie de nos sens, etc.
Ce que lŌĆÖhomme simple peut percevoir par les sens, il le tient pour r├®el. Et ce quŌĆÖil ne peut percevoir de cette fa├¦on (Dieu, lŌĆÖ├óme, la connaissance, etc.), il se le repr├®sente par analogie avec les choses per├¦ues.
Lorsque ce r├®alisme primitif fonde une science, il lui donne pour but la description exacte des choses per├¦ues. Les concepts ne lui sont que des moyens pour atteindre son but. Ils sont l├Ā pour cr├®er des pendants id├®els aux perceptions. Ils nŌĆÖont, vis-├Ā-vis des choses elles-m├¬mes, aucune importance. Ce r├®alisme, par exemple, tiendra pour r├®els les exemplaires de lŌĆÖesp├©ce tulipe quŌĆÖon rencontre ou quŌĆÖon pourrait rencontrer. Mais lŌĆÖid├®e unique de tulipe lui semble ├¬tre une abstraction, une image irr├®elle, que lŌĆÖ├óme sŌĆÖest form├®e gr├óce ├Ā la somme des caract├®ristiques fournis par les exemplaires de tulipe.
Son principe (r├®alit├® de toute chose per├¦ue) se trouve r├®fut├® par lŌĆÖexp├®rience m├¬me, laquelle vient nous enseigner que les choses per├¦ues sont de nature ├®ph├®m├©re. La tulipe que je vois est r├®elle aujourdŌĆÖhui, mais, dans une ann├®e, elle se sera compl├©tement an├®antie. Ce qui sŌĆÖest affirm├®, cŌĆÖest lŌĆÖesp├©ce tulipe. Or, cette esp├©ce nŌĆÖest, pour le r├®alisme primitif, quŌĆÖune id├®e irr├®elle. Cette philosophie se voit donc oblig├®e dŌĆÖadmettre que les r├®alit├®s naissent et disparaissent, tandis que les id├®es, soi-disant irr├®elles, sŌĆÖaffirment en regard. Force lui est donc dŌĆÖadmettre, ├Ā c├┤t├® de la perception, certaines valeurs id├®elles. Il lui faut accepter des r├®alit├®s quŌĆÖil ne saurait percevoir. Il sŌĆÖen excuse vis-├Ā-vis de lui-m├¬me en attribuant ├Ā ces r├®alit├®s un mode dŌĆÖexistence analogue ├Ā celui des objets sensibles. Ces r├®alit├®s hypoth├®tiquement admises sont, d├©s lors, les forces invisibles gr├óce auxquelles les choses perceptibles (sensibles) agissent les unes sur les autres.
Citons, par exemple, lŌĆÖh├®r├®dit├®, dont les effets se font sentir au-del├Ā de lŌĆÖindividu, et par laquelle, lŌĆÖindividu engendrant des individus semblables, lŌĆÖesp├©ce se perp├®tue. Citons le principe vital qui anime le corps physique, lŌĆÖ├óme, que la conscience primitive se repr├®sente toujours par analogie avec les choses sensibles. Citons enfin la divinit├® telle que la con├¦oit cette conscience primitive ; elle imagine toujours que cette divinit├® se comporte selon la mani├©re dŌĆÖagir des hommes, dans la mesure o├╣ cette mani├©re dŌĆÖagir est chose perceptible, autrement dit, sa divinit├® est anthropomorphiste.
La physique moderne ram├©ne les sensations ├Ā des ph├®nom├©nes affectant les particules des corps mat├®riels, et une mati├©re infiniment subtile nomm├®e lŌĆÖ├®ther. Par exemple, ce que nous percevons comme ├®tant une sensation thermique, est un mouvement de mol├®cules. L├Ā encore, on imagine le non-perceptible par analogie avec le perceptible. Le pendant sensible du concept ┬½corps┬╗ consiste, par exemple, en un espace ferm├® de toutes parts, ├Ā lŌĆÖint├®rieur duquel des boules ├®lastiques se meuvent en tous sens, se heurtent, heurtent les parois, rebondissent.
Sans ces hypoth├©ses, le r├®alisme primitif se verrait oblig├® de r├®duire lŌĆÖunivers ├Ā un agr├®gat discordant de perceptions, qui seraient sans rapport les unes avec les autres, qui ne se reformeraient point en une unit├®. Mais il appara├«t clairement que le r├®alisme primitif, en acceptant ces hypoth├©ses, commet une incons├®quence. SŌĆÖil voulait rester fid├©le ├Ā sa proposition : ┬½seul le perceptible est r├®el┬╗, il nŌĆÖaurait aucun droit dŌĆÖadmettre des r├®alit├®s l├Ā o├╣ il nŌĆÖen per├¦oit point. Les forces non perceptibles agissant au sein des objets perceptibles sont, ├Ā son point de vue, des hypoth├©ses injustifi├®es. Et, parce quŌĆÖil ne conna├«t pas dŌĆÖautre r├®alit├® que celle des perceptions, il en dote ses forces hypoth├®tiques. Il ├®tend donc une certaine forme dŌĆÖexistence (lŌĆÖexistence perceptible) ├Ā un domaine o├╣ manque toute possibilit├® dŌĆÖexercer la perception qui, seule, pourrait nous renseigner sur ce qui s y passe.
Cette conception, contradictoire en soi, conduit au r├®alisme m├®taphysique. Celui-ci tente de construire, ├Ā c├┤t├® de la r├®alit├® perceptible, une autre r├®alit├® qui nŌĆÖest pas perceptible, mais que lŌĆÖon croit analogue ├Ā la premi├©re. Le r├®alisme m├®taphysique est donc n├®cessairement un dualisme.
Le r├®alisme m├®taphysique situe la r├®alit├® partout o├╣ il remarque des rapports entre des choses perceptibles (se rapprocher par un mouvement, prendre conscience dŌĆÖun ├¬tre objectif, etc.). Ces rapports, cependant, il peut bien les exprimer par la pens├®e, mais il ne saurait les percevoir en aucun cas. CŌĆÖest arbitrairement que lŌĆÖon fait, de cette relation id├®elle, une chose analogue aux choses perceptibles. Cette philosophie consid├©re donc un univers form├® de deux parties : dŌĆÖabord, les objets de perception, qui sont en perp├®tuel devenir, qui paraissent et disparaissent, puis les forces non-perceptibles, qui engendrent ces objets et qui en sont lŌĆÖ├®l├®ment durable.
Le r├®alisme m├®taphysique est un m├®lange contradictoire de r├®alisme primitif et dŌĆÖid├®alisme. Ses forces hypoth├®tiques sont des entit├®s non-perceptibles, que lŌĆÖon doue de qualit├®s propres aux perceptions. Outre le domaine perceptible, pour lequel il poss├©de un instrument de connaissance, il se voit oblig├® de supposer un second domaine o├╣ cet instrument ne sŌĆÖapplique plus, et qui nŌĆÖest accessible quŌĆÖ├Ā la pens├®e. N├®anmoins, il ne se r├®sout point ├Ā reconna├«tre au concept (id├®e), qui est la forme dŌĆÖexistence offerte par la pens├®e, une valeur effective qui sŌĆÖajoute ├Ā la perception comme second facteur. Or, si lŌĆÖon veut ├®viter lŌĆÖid├®e contradictoire dŌĆÖune ┬½perception non-perceptible┬╗, il faut bien avouer que des rapports ├®tablis entre les perceptions, par la pens├®e, nŌĆÖont pour nous aucune autre forme dŌĆÖexistence que la forme conceptuelle. D├©s que lŌĆÖon a rejet├® ce qui, dans le r├®alisme m├®taphysique, est inacceptable, lŌĆÖunivers nŌĆÖappara├«t plus que comme la somme des perceptions et de leurs rapports id├®els.
Le r├®alisme m├®taphysique m├©ne donc ├Ā une philosophie qui exige seulement, pour les perceptions, que lŌĆÖon puisse les percevoir, et, pour les rapports entre les perceptions, que lŌĆÖon puisse les penser. Cette derni├©re philosophie ne saurait admettre, en outre des domaines de la perception et du concept, une troisi├©me sph├©re dans laquelle les deux principes dits ┬½principe r├®el┬╗ et ┬½principe id├®el┬╗ r├®gneraient en m├¬me temps.
Le r├®alisme m├®taphysique affirme quŌĆÖen dehors de la relation id├®elle ├®tablie entre lŌĆÖobjet de perception et le sujet percepteur, il existe encore une relation r├®elle entre la chose en soi de la perception, et la chose en soi du sujet perceptible que lŌĆÖon nomme esprit individuel. Cette affirmation repose sur ce que lŌĆÖon fait lŌĆÖhypoth├©se injustifi├®e dŌĆÖun processus analogue ├Ā ceux du monde perceptible, et cependant non-perceptible.
Le r├®alisme m├®taphysique dit ensuite : je puis ├®tablir, entre moi et le monde de mes perceptions, un rapport conscient et id├®el ; mais je ne puis ├®tablir entre moi et le monde r├®el quŌĆÖun rapport dynamique (de force). L├Ā, il commet la faute que nous avons d├®j├Ā bl├óm├®e. Il ne peut ├¬tre question dŌĆÖun rapport dynamique que dans le monde de la perception (dans le domaine des sensations tactiles) et non point en dehors de ce domaine.
LŌĆÖaboutissement final du r├®alisme m├®taphysique, lorsquŌĆÖon lŌĆÖ├®pure de ses ├®l├®ments contradictoires, est la philosophie que nous avons caract├®ris├®e plus haut, et que nous nommerons le monisme, parce quŌĆÖelle r├®unit le r├®alisme et lŌĆÖid├®alisme en une unit├® sup├®rieure. Pour le r├®alisme primitif, le monde r├®el est une somme de perceptions. Pour le r├®alisme m├®taphysique, il faut ajouter ├Ā la r├®alit├® des perceptions celle des forces invisibles ; le monisme remplace ces forces par les rapports id├®els que la pens├®e nous fait acqu├®rir. Ces rapports id├®els, ce sont les lois de la nature. Une loi naturelle nŌĆÖest pas autre chose que lŌĆÖexpression conceptuelle dŌĆÖun rapport entre certaines perceptions.
Le monisme nŌĆÖa aucun motif de chercher, en dehors de la perception et du concept, dŌĆÖautres principes explicatifs de la r├®alit├®. Il sait quŌĆÖil nŌĆÖy a, dans le domaine r├®el, aucune occasion de le faire. Il voit dans le monde de la perception, tel quŌĆÖil se pr├®sente imm├®diatement ├Ā lŌĆÖobservation, une moiti├® de r├®alit├®. Il trouve dans lŌĆÖunion de ce monde perceptible avec le monde des concepts la r├®alit├® totale. Le r├®aliste m├®taphysique pourra lui objecter : ┬½Il se peut que votre connaissance soit compl├©te en soi en ce qui concerne votre organisation, et quŌĆÖaucun ├®l├®ment ne lui manque. Mais vous ignorez comment le monde se refl├©te dans des intelligences autrement organis├®es que la v├┤tre.┬╗ Voici la r├®ponse du monisme : SŌĆÖil existe dŌĆÖautres intelligences que celles des hommes, si leurs perceptions ont un autre aspect que les n├┤tres, cela ne peut rien signifier pour moi que dans la mesure o├╣ je lŌĆÖapprends par la perception, ou par le concept. Par ma perception (├Ā savoir, par ma perception sp├®cifiquement humaine), je mŌĆÖoppose en sujet aux objets. Par l├Ā, la continuit├® g├®n├®rale de lŌĆÖunivers est rompue. Gr├óce ├Ā la pens├®e, le sujet r├®tablit cette continuit├®. Et cŌĆÖest ce qui le r├®ins├©re lui-m├¬me dans ce tout. Comme ce tout nŌĆÖest bris├® que par notre sujet, au point de rupture entre notre perception et notre concept, il sŌĆÖensuit que la r├®union de ces deux termes constitue une connaissance v├®ritable. Pour des ├¬tres ayant dŌĆÖautres possibilit├®s de perception (par exemple deux fois plus dŌĆÖorganes sensoriels que nous) la continuit├® universelle serait rompue en un autre lieu, et son r├®tablissement sŌĆÖeffectuerait dŌĆÖune autre mani├©re propre ├Ā ces ├¬tres. La question des limites de la connaissance ne peut se poser que pour les r├®alismes (primitif ou m├®taphysique) qui, tous deux, ne voient dans le contenu de lŌĆÖ├óme quŌĆÖune repr├®sentation id├®elle du monde. Pour eux, en effet, ce qui se trouve hors du sujet semble dou├® de substantialit├® absolue, tandis que le contenu du sujet ne para├«t que lŌĆÖimage de cet absolu.
La perfection de la connaissance d├®pend, pour ces r├®alismes, dŌĆÖune ressemblance plus ou moins parfaite entre lŌĆÖimage subjective et lŌĆÖobjet absolu. Un ├¬tre dou├® de moins dŌĆÖorganes sensoriels que lŌĆÖhomme percevra une moins grande partie de lŌĆÖunivers, un ├¬tre dou├® de plus dŌĆÖorganes sensoriels en percevra une plus grande partie. Le premier de ces ├¬tres jouira donc dŌĆÖune connaissance moins parfaite que le second.
Le monisme voit la chose tout autrement. LŌĆÖorganisation de lŌĆÖ├¬tre percepteur conditionne la forme sous laquelle appara├«t la rupture de la continuit├® universelle, sa division en sujet et objet. LŌĆÖobjet nŌĆÖest pas absolu, mais relatif, en ce qui concerne ce sujet particulier. Le r├®tablissement de la continuit├® se fait donc ├®galement selon le mode sp├®cifique qui est propre au sujet. D├©s que le moi, qui se trouve s├®par├® du monde dans lŌĆÖacte de perception, se r├®unit au monde dans lŌĆÖacte pensant, toutes les questions que ce moi se posait en vertu de sa s├®paration sont r├®solues.
Un ├¬tre autrement organis├® que nous aurait aussi une connaissance autrement agenc├®e. La n├┤tre suffit ├Ā nous fournir une r├®ponse ├Ā toutes les questions que notre ├¬tre peut poser.
Le r├®alisme m├®taphysique est forc├® de se demander : par quoi le contenu de nos perceptions nous est-il donn├®, par quoi le sujet est-il affect├® ?
Pour le monisme, la perception re├¦oit sa d├®termination du sujet. Mais le sujet, en poss├®dant la pens├®e, poss├©de aussi le moyen de faire cesser cette d├®termination dont il est la cause.
Le r├®alisme m├®taphysique se heurte ├Ā une nouvelle difficult├® lorsquŌĆÖil veut expliquer comment les images que nous nous formons de lŌĆÖunivers se ressemblent dŌĆÖun individu ├Ā lŌĆÖautre. Il se demande : comment se fait-il que cette image de lŌĆÖunivers, que je construis avec mes perceptions subjectivement d├®termin├®es, et avec mes concepts, est analogue ├Ā celle quŌĆÖun autre individu humain construit avec ces deux m├¬mes facteurs subjectifs ! Comment puis-je, dŌĆÖailleurs, conclure de mon image subjective ├Ā celle des autres hommes ! Le r├®alisme m├®taphysique croit pouvoir conclure ├Ā une ressemblance entre ces images subjectives, du fait que les hommes, pratiquement, arrivent ├Ā sŌĆÖaccorder. De cette ressemblance, il d├®duit ensuite la ressemblance des esprits individuels qui portent les sujets percepteurs particuliers, autrement dit, des moi en soi qui servent de base ├Ā ces sujets.
Cette conclusion est tir├®e dŌĆÖune somme dŌĆÖobservations portant sur des effets, et dŌĆÖo├╣ lŌĆÖon conclut au caract├©re des causes. On croit tenir un nombre assez consid├®rable dŌĆÖobservations pour pouvoir affirmer comment les causes suppos├®es agiront dans les autres cas. CŌĆÖest ce quŌĆÖon nomme un raisonnement ┬½par induction┬╗. Ses r├®sultats sont sujets ├Ā ├¬tre modifi├®s, dans la suite, sŌĆÖil se produit de nouvelles observations inattendues, car le caract├©re du r├®sultat nŌĆÖest d├®termin├® que par lŌĆÖaspect individuel des observations que lŌĆÖon a faites. Cette connaissance conditionnelle des causes suffit, dit le r├®alisme m├®taphysique, aux besoins de la vie pratique. Le raisonnement par induction est la m├®thode fondamentale du r├®alisme m├®taphysique moderne. Il fut un temps o├╣ lŌĆÖon croyait pouvoir faire sortir du concept quelque chose qui nŌĆÖ├®tait plus le concept. On croyait pouvoir conna├«tre, gr├óce aux concepts, les entit├®s m├®taphysiques dont le r├®alisme de ce temps-l├Ā avait besoin. Cette mani├©re de philosopher est abandonn├®e aujourdŌĆÖhui. Mais lŌĆÖon croit, en revanche, quŌĆÖun grand nombre de faits de perception permettent de fixer par induction les caract├©res de la chose en soi qui leur sert de base. Jadis on voulait extraire la r├®alit├® m├®taphysique du concept ; ├Ā pr├®sent, on cherche ├Ā la tirer de la perception. Or, lorsquŌĆÖon avait devant soi la parfaite transparence du concept, on pouvait pr├®tendre en faire d├®river lŌĆÖ├¬tre m├®taphysique avec une absolue certitude. Mais les perceptions nŌĆÖont pas cette transparence. Chacune dŌĆÖelles apporte autre chose que celles de m├¬me sorte qui lŌĆÖont pr├®c├®d├®e. Au fond, ce quŌĆÖon a conclu des perceptions pr├®c├®dentes est toujours modifi├® en quelque chose par celles qui suivent. Ce quŌĆÖon obtient par cette m├®thode, quant ├Ā la m├®taphysique, nŌĆÖest jamais que dŌĆÖune justesse relative, sujette ├Ā des corrections futures. Telle est la m├®taphysique dŌĆÖ├ēdouard von Hartmann, enti├©rement d├®termin├®e par la m├®thode inductive, ainsi que lŌĆÖindique le sous-titre de sa premi├©re oeuvre importante ┬½r├®sultats sp├®culatifs obtenus par la m├®thode inductive des sciences naturelles┬╗.
Le r├®alisme m├®taphysique actuel d├®termine ses choses en soi par la m├®thode inductive. Ses observations sur le processus de la connaissance lui ont fourni la certitude quŌĆÖil existe ├Ā c├┤t├® du monde ┬½subjectif┬╗, dont la perception et le concept livrent la connaissance, un ordre universel dou├® dŌĆÖobjectivit├® r├®elle. CŌĆÖest par induction quŌĆÖil pr├®tend inf├®rer de la perception aux propri├®t├®s de la r├®alit├® objective.
APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
LŌĆÖobservation impartiale de la perception et du concept, comme nous avons essay├® de la conduire dans les pr├®c├®dents chapitres, se trouve quelquefois troubl├®e par certaines constatations de la science : celle-ci nous apprend, par exemple, que lŌĆÖoeil per├¦oit dans le spectre lumineux des couleurs allant du rouge au violet. Au del├Ā du violet, il existe dans le spectre des forces qui ne provoquent aucune perception de lŌĆÖoeil, mais une action chimique ; de m├¬me il existe, au del├Ā de la couleur rouge, des radiations qui nŌĆÖont quŌĆÖune action thermique. LorsquŌĆÖon r├®fl├®chit ├Ā des ph├®nom├©nes de cette sorte, on en vient ├Ā se dire : LŌĆÖ├®tendue de notre monde perceptible est d├®termin├®e par lŌĆÖ├®tendue de nos sens, et nous aurions devant nous un tout autre univers sŌĆÖil nous advenait des sens suppl├®mentaires ou si les n├┤tres changeaient de nature. LorsquŌĆÖon se pla├«t aux imaginations d├®r├®gl├®es que les brillantes d├®couvertes de la science moderne sugg├©rent, on peut en arriver ├Ā la conviction suivante il nŌĆÖentre dans notre champ dŌĆÖobservation que ce que nos sens, conditionn├®s par notre organisation, laissent p├®n├®trer. Nous nŌĆÖavons aucun droit de mesurer la r├®alit├® dŌĆÖapr├©s ces perceptions, que limite la conformation de nos sens. Car chaque sens nouveau nous r├®v├®lerait une nouvelle image de la r├®alit├®. Tout ceci est indiscutable tant quŌĆÖon ne va pas plus loin. Mais si on se laisse troubler par cette conviction jusque dans lŌĆÖexamen de la perception, du concept, et de leur rapport, on sŌĆÖali├©ne toute possibilit├® de conna├«tre la r├®alit├® de lŌĆÖhomme et de lŌĆÖunivers. LŌĆÖexp├®rience int├®rieure de la pens├®e, lŌĆÖ├®laboration active du concept, est quelque chose de tout autre que lŌĆÖexp├®rience dŌĆÖune chose sensible. Quels que soient les sens que lŌĆÖhomme pourrait avoir, aucun dŌĆÖeux ne lui donnerait une r├®alit├®, si sa pens├®e ne venait en ├®clairer les donn├®es ; et quel que soit un organe sensoriel, il donne ├Ā lŌĆÖhomme la possibilit├® de p├®n├®trer en pleine r├®alit├® pourvu que la pens├®e compl├©te ses donn├®es.
Les imaginations que lŌĆÖon peut se faire dŌĆÖun univers correspondant ├Ā de tout autres sens que les n├┤tres, nŌĆÖont rien ├Ā faire avec le probl├©me des rapports de lŌĆÖhomme ├Ā la r├®alit├®. Il faut justement se rendre compte que toute image de perception re├¦oit sa forme de lŌĆÖorganisation de lŌĆÖ├¬tre percepteur, mais que lŌĆÖimage per├¦ue, transform├®e par la pens├®e, conduit lŌĆÖhomme ├Ā la r├®alit├®. Ce nŌĆÖest pas la peinture fantastique de lŌĆÖunivers qui nous appara├«trait si nous avions dŌĆÖautres sens, qui peut nous amener ├Ā conna├«tre notre situation vis-├Ā-vis du monde, mais cŌĆÖest la conviction que chaque perception ne nous livre quŌĆÖune partie de la r├®alit├® cach├®e en elle, et quŌĆÖelle nous d├®tourne ainsi de sa propre r├®alit├®. ├Ć cette conviction sŌĆÖajoute celle que la pens├®e nous introduit dans la partie de la r├®alit├® que la perception dissimulait.
Ce qui peut venir aussi troubler ces convictions, cŌĆÖest que, dans le domaine de la physique, il est constamment n├®cessaire de ne plus parler dŌĆÖ├®l├®ments directement perceptibles ou directement concevables, mais de grandeurs inconcevables comme les lignes de forces ├®lectriques et magn├®tiques, etc.. Il peut sembler que ces ├®l├®ments de la r├®alit├®, dont parle la physique, nŌĆÖaient rien ├Ā faire avec le perceptible, ni avec le concept ├®labor├® par lŌĆÖactivit├® pensante. Mais ce nŌĆÖest quŌĆÖune apparence illusoire. Il est incontestable que tous les r├®sultats de la physique, tant quŌĆÖils ne sont pas des hypoth├©ses ill├®gitimes que lŌĆÖon devrait sŌĆÖinterdire, sont acquis par la perception et le concept exclusivement. Ce qui, en apparence, nŌĆÖest pas concevable, le physicien le transporte, par un instinct tr├©s juste, dans le champ de perception correspondant, et le pense sous la forme des concepts avec lesquels on travaille dans ce domaine. Les forces ├®lectriques, magn├®tiques, etc., ne sont jamais, de par leur nature m├¬me, autrement acquises que par lŌĆÖacte de connaissance qui va de la perception au concept.
Une multiplication ou une alt├®ration des organes sensoriels de lŌĆÖhomme fournirait une autre image de perception, un enrichissement ou une transformation de lŌĆÖexp├®rience humaine. Mais la connaissance v├®ritable ne pourrait toujours ├¬tre, en regard de cette exp├®rience, que dans les actions et r├®actions de la perception et du concept. Le progr├©s de la connaissance en profondeur d├®pend des forces de lŌĆÖintuition [voir: chapitre "5. La connaissance du monde" - rechercher "Nous appellerons intuition la forme"] qui se manifestent dans la pens├®e. Cette intuition, au cours de lŌĆÖexp├®rience quŌĆÖelle r├®alise dans lŌĆÖacte pensant, peut descendre plus ou moins profond├®ment dans le substratum de la r├®alit├®. LŌĆÖ├®largissement des images per├¦ues peut favoriser et stimuler ce progr├©s en profondeur. Mais il ne faut jamais confondre ce progr├©s en profondeur, qui est la vraie connaissance de la r├®alit├®, avec lŌĆÖampleur plus ou moins grande de notre champ de perception, qui, dŌĆÖapr├©s lŌĆÖorganisation de notre connaissance, ne peut jamais nous donner quŌĆÖune demi-r├®alit├®.
LorsquŌĆÖon ne se perd pas en abstractions, on comprend toute lŌĆÖimportance de ce fait : la physique doit deviner certains ├®l├®ments du champ de perception, pour lesquels nous nŌĆÖavons point un organe sensoriel comme pour la couleur ou le son. LŌĆÖ├¬tre humain concret nŌĆÖest donc pas d├®termin├® seulement par les perceptions qui se pr├®sentent imm├®diatement ├Ā son organisme, mais aussi, parce quŌĆÖil peut inf├®rer de ces perceptions imm├®diates. De m├¬me que lŌĆÖ├®tat inconscient du sommeil est n├®cessaire ├Ā c├┤t├® de lŌĆÖ├®tat conscient de la veille, de m├¬me notre vie comprend, autour du cercle de nos perceptions sensibles, un cercle beaucoup plus grand dŌĆÖ├®l├®ments qui ne sont pas sensiblement perceptibles, mais appartiennent au m├¬me domaine que les perceptions sensibles. Tout ceci est exprim├® d├®j├Ā, mais indirectement, dans la forme premi├©re de cet ouvrage. LŌĆÖauteur ajoute ici ce d├®veloppement, parce quŌĆÖil a pu remarquer que bien des lecteurs nŌĆÖavaient pas lu assez attentivement.
Il faut ├®galement faire remarquer que lŌĆÖid├®e de perception, telle quŌĆÖelle est expos├®e dans cet ouvrage, ne doit pas ├¬tre confondue avec la perception sensible ext├®rieure qui en est seulement un cas particulier. On a d├╗ voir dans ce qui pr├®c├©de, et lŌĆÖon comprendra mieux encore par la suite, que nous entendons par perception tout ├®l├®ment sensible ou spirituel arrivant ├Ā lŌĆÖhomme par la voie de la perception, avant dŌĆÖ├¬tre ├®labor├® par lŌĆÖactivit├® conceptuelle. Pour avoir des perceptions de nature psychique ou spirituelle, les sens ordinaires ne sont pas n├®cessaires. On dira peut-├¬tre quŌĆÖil est inadmissible dŌĆÖ├®largir ainsi la signification courante dŌĆÖun mot. Mais il est absolument n├®cessaire de lŌĆÖ├®largir si lŌĆÖon ne veut pas se laisser encha├«ner, et ├¬tre arr├¬t├® dans lŌĆÖ├®largissement de ses connaissances, par les habitudes du langage. Celui qui parle de perception dans le sens de perception sensible exclusivement nŌĆÖarrivera jamais ├Ā se faire, m├¬me de cette perception sensible, une conception vraiment utilisable pour la connaissance. Il faut quelquefois ├®largir un concept pour quŌĆÖil conserve dans un domaine limit├® le sens qui lui est propre. Il faut aussi quelquefois ajouter, ├Ā ce qui a ├®t├® pens├® tout dŌĆÖabord en un concept, des ├®l├®ments nouveaux, afin que ce quŌĆÖon a pens├® demeure juste ou soit remis au point. Ainsi, lŌĆÖon trouve dans ce livre [voir: chapitre "6. LŌĆÖindividualit├® humaine"] ┬½La repr├®sentation est donc un concept individualis├®┬╗. On mŌĆÖa object├® que cŌĆÖ├®tait sortir de lŌĆÖacception courante de ces mots. Mais cette amplification est n├®cessaire si lŌĆÖon veut d├®couvrir ce quŌĆÖest r├®ellement la perception. QuŌĆÖadviendrait-il du progr├©s de la connaissance si lŌĆÖon devait objecter, ├Ā chaque fois quŌĆÖun concept a besoin dŌĆÖune remise au point : ┬½CŌĆÖest sortir de lŌĆÖacception courante des mots┬╗ !
LA R├ēALIT├ē DE LA LIBERT├ē
8. Les facteurs de la vie
R├®capitulons ce que nous avons tenu pour acquis au cours des chapitres pr├®c├®dents. LŌĆÖunivers se pr├®sente ├Ā nous sous lŌĆÖaspect dŌĆÖune multiplicit├®. Dans cette multiplicit├®, nous sommes un ├¬tre parmi les autres. Cet aspect du monde est ce que nous consid├®rons comme donn├®, et, dans la mesure o├╣ nous ne le cr├®ons pas, mais le trouvons tout fait devant nous, nous le nommons perception.
Au sein de ce monde de la perception, nous nous percevons nous-m├¬me. Cette auto-perception demeurerait au m├¬me rang que les autres perceptions, sŌĆÖil ne surgissait pas en elle un ├®l├®ment capable de ramener ├Ā nous-m├¬mes, comme ├Ā un centre, les perceptions en g├®n├®ral, et, par suite, la somme de toutes nos autres perceptions. Cet ├®l├®ment, qui surgit ainsi, nŌĆÖest plus une simple perception ; il nŌĆÖest pas simplement donn├®, pr├®sent├® devant nous, il est le produit dŌĆÖune activit├®. Il para├«t li├® tout dŌĆÖabord ├Ā ce que nous percevons comme notre ┬½moi┬╗. Mais son caract├©re profond est de d├®passer ce ┬½moi┬╗. Il ajoute ├Ā chacune de nos perceptions des d├®terminations id├®elles, qui ont des rapports entre elles, et qui sont fond├®es dans le m├¬me tout. Cet ├®l├®ment d├®termine aussi le r├®sultat de lŌĆÖauto-perception, de la m├¬me mani├©re id├®elle quŌĆÖil fait pour les autres perceptions, et il lŌĆÖoppose, en qualit├® de ┬½sujet┬╗, aux ┬½objets┬╗. Cet ├®l├®ment est la pens├®e, et les propri├®t├®s id├®elles quŌĆÖil ajoute ├Ā la perception sont les concepts ou id├®es. La pens├®e se manifeste donc tout dŌĆÖabord au sujet de lŌĆÖauto-perception, mais elle nŌĆÖest pas purement subjective, car cŌĆÖest seulement gr├óce ├Ā son aide que le ┬½moi┬╗ se donne la d├®termination de ┬½sujet┬╗. Cette d├®finition id├®elle de son soi est une d├®termination capitale de notre vie personnelle. Par elle, nous menons une vie id├®elle, nous nous sentons ├¬tre une entit├® pensante. Cette d├®termination vitale demeurerait un acte purement logique sŌĆÖil nŌĆÖarrivait pas ├Ā notre ┬½moi┬╗ dŌĆÖautres d├®terminations encore. Notre vie sŌĆÖ├®puiserait alors dans lŌĆÖacte dŌĆÖ├®tablir des rapports conceptuels entre les perceptions, et de ces perceptions ├Ā nous. Si on nomme cet acte connaissance, ou savoir, cette supposition ferait de nous des ├¬tres de pure connaissance, de pur savoir. Mais cette supposition nŌĆÖest pas justifi├®e. Nous avons vu que les perceptions se rattachent ├Ā nous, non seulement par une relation id├®elle, mais encore par le sentiment. Notre vie nŌĆÖest pas remplie par lŌĆÖactivit├® conceptuelle. Le r├®alisme des ├¬tres primitifs trouve m├¬me, dans le sentiment, une vie plus r├®elle que dans lŌĆÖ├®l├®ment id├®el de notre savoir. Et, de son point de vue, ce r├®alisme a raison, car le sentiment est, du c├┤t├® subjectif, exactement ce quŌĆÖest la perception du c├┤t├® objectif. DŌĆÖapr├©s le principe m├¬me de ce r├®alisme imm├®diat : ┬½tout le perceptible est r├®el┬╗, le sentiment est la garantie de la r├®alit├® de notre personne. Mais le monisme que nous exposons ici ne peut consid├®rer le sentiment comme une r├®alit├® totale que lorsque sŌĆÖy ajoute le m├¬me compl├®ment quŌĆÖaux perceptions. Pour ce monisme, le sentiment, dans la forme primitive o├╣ il nous est donn├®, est une r├®alit├® inachev├®e ; il ne contient pas encore son second facteur qui est le concept, lŌĆÖid├®e. CŌĆÖest pourquoi le sentiment, comme la perception, appara├«t toujours dans la vie avant la connaissance. Nous sentons tout dŌĆÖabord que nous existons ; et, au cours de notre ├®volution progressive, nous parvenons au stade o├╣ surgit, de cette existence confus├®ment ressentie, lŌĆÖid├®e de notre ┬½moi┬╗. Mais ce qui, pour nous, nŌĆÖappara├«t que post├®rieurement, est originellement li├® au sentiment dŌĆÖune mani├©re indissoluble. C est ├Ā cause de cela que lŌĆÖhomme primitif arrive ├Ā croire que le sentiment lui pr├®sente lŌĆÖexistence dŌĆÖune mani├©re imm├®diate, et le savoir, dŌĆÖune mani├©re m├®diate. Le d├®veloppement de la vie affective lui para├«t donc de toute premi├©re importance. Il croira avoir saisi les rapports universels lorsquŌĆÖil leur aura fait place dans sa vie sentimentale. Il cherche la connaissance, non pas par le moyen du savoir, mais par celui du sentiment. Comme le sentiment est une chose absolument individuelle, une chose qui se rapproche de la perception, il sŌĆÖensuit que les philosophes de cette ├®cole font un principe universel de ce qui nŌĆÖa aucun sens hors de leur propre personne. Ils cherchent ├Ā remplir lŌĆÖunivers de leur propre ┬½moi┬╗. Ils veulent accomplir avec le sentiment ce que le monisme expos├® ici veut saisir dans le concept, et cette union sentimentale avec les objets lui para├«t ├¬tre la connaissance la plus intime.
LŌĆÖ├®cole philosophique que nous venons de d├®finir, la philosophie du sentiment, est souvent d├®sign├®e sous le nom de mystique. LŌĆÖerreur dŌĆÖune conception mystique bas├®e sur le sentiment seul, cŌĆÖest quŌĆÖelle veut ┬½├®prouver┬╗ ce quŌĆÖil sŌĆÖagit de ┬½conna├«tre┬╗, et quŌĆÖelle veut ├®lever un principe individuel, le sentiment, au rang de principe universel.
Le sentiment, en effet, est un fait purement individuel, cŌĆÖest la relation du monde ext├®rieur ├Ā notre sujet, dans la mesure o├╣ cette relation constitue une exp├®rience purement subjective.
Il y a encore une autre manifestation de la personnalit├® humaine. Le ┬½moi┬╗ participe par la pens├®e ├Ā la vie g├®n├®rale de lŌĆÖunivers ; par elle, il rapporte id├®ellement (conceptuellement) les perceptions ├Ā lui-m├¬me, et lui-m├¬me aux perceptions. Dans le sentiment, il ressent une relation des objets ├Ā son sujet ; dans la volont├®, cŌĆÖest le contraire qui arrive. La volont├® nous apporte ├®galement une perception, qui est celle du rapport individuel de notre ┬½moi┬╗ aux objets. Ce qui, dans la volont├®, nŌĆÖest pas un facteur id├®el, est simplement un objet de perception comme toutes les autres choses du monde.
Cependant, le r├®alisme primitif croira voir encore, dans cette volont├®, une existence plus r├®elle que dans la pens├®e. Il croira y voir un devenir, une causalit├® dont lŌĆÖhomme est imm├®diatement conscient, tandis que la pens├®e ne saisit le devenir quŌĆÖ├Ā travers les concepts. Pour cette ├®cole philosophique, les actes volontaires quŌĆÖaccomplit le ┬½moi┬╗ constituent un processus que lŌĆÖhomme vit dŌĆÖune fa├¦on imm├®diate. Dans la volont├®, lŌĆÖhomme croit tenir en main le devenir universel. Tandis quŌĆÖil ne peut suivre les autres ├®v├®nements quŌĆÖ├Ā travers la perception, il croit, par le vouloir, vivre directement en un ├®l├®ment absolument r├®el. Le mode dŌĆÖexistence sous lequel lui appara├«t la volont├®, au sein m├¬me de son ┬½moi┬╗, devient pour lui le principe m├¬me de la r├®alit├®. Sa volont├® personnelle est alors un cas particulier du devenir universel ; et ce dernier, inversement, nŌĆÖest quŌĆÖune volont├® universelle. Cette ├®cole ├®rige la volont├® en principe du monde, comme la mystique, d├®finie plus haut, ├®rige le sentiment en principe de connaissance. Cette ├®cole est la philosophie de la volont├® (th├®lisme). Elle fait, de ce qui ne se peut vivre quŌĆÖindividuellement, le premier facteur constitutif du monde.
Cette philosophie de la volont├® ne m├®rite pas plus le nom de science que la mystique du sentiment. Toutes deux affirment quŌĆÖon ne saurait p├®n├®trer dans lŌĆÖessence du monde par des actes purement conceptuels. ├Ć c├┤t├® du principe id├®el de lŌĆÖ├¬tre, elles veulent trouver encore un principe r├®el. Elles ont, jusquŌĆÖ├Ā un certain point, raison. Mais, ces soi-disant ┬½principes r├®els┬╗ nous nŌĆÖavons dŌĆÖautre moyen de les saisir que la perception ; par cons├®quent, les doctrines de la mystique du sentiment et de la philosophie de la volont├® reviennent ├Ā dire : notre connaissance a deux sources, celle de la pens├®e, et celle de la perception qui prend un caract├©re individuel dans le sentiment et dans la volont├®. ├ētant donn├® que, pour ces ├®coles, les produits de la seconde source (les exp├®riences sentimentales et volontaires) ne peuvent ├¬tre directement incorpor├®s ├Ā ceux de la premi├©re (pens├®e), les deux sources de connaissance demeurent isol├®es, sans aucun moyen de communication sup├®rieure. ├Ć c├┤t├® du principe id├®el, dont le savoir sŌĆÖempare, il y aurait encore un principe r├®el du monde, qui serait inaccessible ├Ā la pens├®e. En dŌĆÖautres termes : ces deux doctrines se r├®sument en un r├®alisme primitif, elles admettent que ┬½tout ce qui se per├¦oit est r├®el┬╗. Elles commettent seulement une incons├®quence de plus que le r├®alisme primitif. CŌĆÖest de consid├®rer certaines formes sp├®ciales de perception (le sentiment et la volont├®) comme des moyens universels et uniques de connaissance r├®elle, alors que, pour cela, il leur a fallu admettre dŌĆÖabord que ┬½tout ce qui se per├¦oit est r├®el┬╗. Elles devraient donc attribuer aux formes ext├®rieures de la perception la m├¬me valeur quŌĆÖau sentiment et quŌĆÖ├Ā la volont├®.
La philosophie de la volont├® devient ┬½r├®alisme m├®taphysique┬╗ lorsquŌĆÖelle introduit la volont├® jusque dans des sph├©res dŌĆÖexistence o├╣ lŌĆÖon ne peut plus la percevoir directement. Elle admet hypoth├®tiquement, hors du sujet, un principe pour lequel lŌĆÖexp├®rience subjective est pr├®cis├®ment le seul crit├®rium de r├®alit├®. En tant que r├®alisme m├®taphysique, la philosophie de la volont├® tombe sous la critique que nous avons faite dans le pr├®c├©dent chapitre. Nous avons, en effet, signal├® la contradiction inh├®rente ├Ā tout r├®alisme m├®taphysique, et nous devons reconna├«tre que la volont├®, si elle peut ├¬tre consid├®r├®e comme une force universelle, lŌĆÖest uniquement dans la mesure o├╣ elle sŌĆÖins├©re id├®ellement dans le reste du monde.
APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
SŌĆÖil est particuli├©rement difficile ├Ā notre pouvoir dŌĆÖobservation de saisir la pens├®e dans son ├¬tre r├®el, cŌĆÖest que cet ├¬tre ne nous ├®chappe que trop rapidement, ├Ā lŌĆÖinstant m├¬me o├╣ nous dirigeons sur lui notre attention. Alors, il ne reste de la pens├®e vivante quŌĆÖun r├®sidu abstrait et mort, une sorte de cadavre. Si lŌĆÖon consid├©re ce r├®sidu, on se sentira tent├® de lui opposer lŌĆÖ├®l├®ment vraiment ┬½plein de vie┬╗ de la mystique sentimentale, ou de la m├®taphysique de la volont├®. On trouvera singulier quŌĆÖune philosophie cherche la possession du r├®el dans de ┬½pures pens├®es┬╗. Mais, si on sŌĆÖ├®l├©ve jusquŌĆÖ├Ā vivre vraiment dans la pens├®e, on sŌĆÖapercevra quŌĆÖon ne peut aucunement comparer les effusions de la pure sentimentalit├®, ni la force de lŌĆÖ├®l├®ment volontaire, ├Ā cette richesse int├®rieure, ├Ā ces exp├®riences ├Ā la fois concentr├®es et mobiles qui constituent cette vie dans la pens├®e, - ├Ā supposer que lŌĆÖon ait ├®t├® tent├® de placer ces deux activit├®s au-dessus de la pens├®e.
CŌĆÖest justement cette richesse, cette pl├®nitude intime de la pens├®e, qui, dans lŌĆÖattitude ordinaire de lŌĆÖ├óme, donne ├Ā son reflet une apparence froide et inanim├®e. Aucune des activit├®s de lŌĆÖhomme nŌĆÖest aussi facilement m├®connue. La volont├®, le sentiment, r├®chauffent lŌĆÖ├óme humaine, alors m├¬me quŌĆÖils sont ├Ā lŌĆÖ├®tat de souvenirs. Dans le souvenir, au contraire, la pens├®e demeure le plus souvent une chose indiff├®rente : il semble quŌĆÖelle dess├©che lŌĆÖ├óme. Mais ceci est pr├®cis├®ment lŌĆÖeffet dŌĆÖombre projet├® par sa r├®alit├® lumineuse et chaleureuse, qui plonge en toutes les apparences de lŌĆÖunivers. Cette descente dans la pens├®e active sŌĆÖop├©re avec une force qui d├®borde dŌĆÖelle-m├¬me, et qui, spirituellement, peut ├¬tre nomm├®e une force dŌĆÖamour. Il ne faut pas objecter que voir de lŌĆÖamour dans la pens├®e, cŌĆÖest y transposer un sentiment. Car cette objection nŌĆÖest que la confirmation de nos paroles. Celui qui sŌĆÖadonne ├Ā la r├®alit├® profonde de la pens├®e retrouve, en celle-ci, aussi bien le sentiment que la volont├®, mais dans la forme substantielle de leur ├¬tre. Celui qui, au contraire, se d├®tourne de la pens├®e pour aborder directement le sentiment et la volont├®, perd de ceux-ci ce qui est leur r├®alit├® essentielle.
LŌĆÖexp├®rience intuitive de la pens├®e rend au sentiment et ├Ā la volont├® la pleine possession de leurs droits. Par contre, la mystique du sentiment et la m├®taphysique de la volont├® sont forc├®ment injustes ├Ā lŌĆÖ├®gard de lŌĆÖintuition pensante. Elles sont forc├®ment amen├®es ├Ā se croire en plein domaine du r├®el, et ├Ā consid├®rer, au contraire, que lŌĆÖintuition pensante se cr├®e de lŌĆÖunivers une image abstraite, priv├®e de vie et de sentiment, un reflet plut├┤t quŌĆÖune r├®alit├®.
9. LŌĆÖid├®e de la libert├®
Le concept dŌĆÖarbre est conditionn├®, pour la connaissance, par la perception dŌĆÖun arbre. Vis-├Ā-vis de cette perception, je ne puis choisir, dans mon syst├©me g├®n├®ral de concepts, quŌĆÖun seul concept bien d├®fini. Le rapport du concept ├Ā la perception est d├®termin├®, imm├®diatement et objectivement, par la pens├®e. Ce rapport nŌĆÖest connu quŌĆÖapr├©s lŌĆÖacte de perception, mais il est contenu dans la chose m├¬me.
LorsquŌĆÖil sŌĆÖagit de la connaissance, et du rapport quŌĆÖelle ├®tablit entre lŌĆÖhomme et le monde, tout se passe diff├®remment. Nous avons essay├® de montrer dans les pr├®c├®dents chapitres que ce rapport sŌĆÖ├®claire lorsque la simple observation sŌĆÖy applique de bonne foi. Cette observation nous fournit la certitude que la pens├®e est en soi une entit├® compl├©te, qui peut-├¬tre directement connue par lŌĆÖhomme. Ce serait m├®conna├«tre les r├®sultats de cette observation que de supposer, au-dessous de la pens├®e, la n├®cessit├® dŌĆÖun substratum quelconque, tel que les ph├®nom├©nes physiques du cerveau, ou encore des processus spirituels inconscients. LŌĆÖhomme qui observe la pens├®e vit directement, ├Ā lŌĆÖinstant o├╣ il lŌĆÖobserve, au sein dŌĆÖune essence spirituelle qui subsiste par elle-m├¬me. On peut aller plus loin et dire que, pour saisir lŌĆÖesprit dans la forme sous laquelle il commence ├Ā se faire conna├«tre aux hommes, on ne peut que prendre conscience de lŌĆÖessence immuable, et fond├®e en elle-m├¬me, quŌĆÖest la pens├®e.
Dans lŌĆÖobservation de la pens├®e, les deux termes dont lŌĆÖapparition ├®tait jusquŌĆÖalors forc├®ment s├®par├®e (concept et perception) se trouvent r├®unis en un seul. Tant que lŌĆÖon m├®conna├«t cette v├®rit├®, on pourra imaginer que les concepts sont les reflets inconsistants des perceptions, et les perceptions sembleront ├¬tre la seule r├®alit├®. CŌĆÖest alors quŌĆÖon se met ├Ā construire des univers m├®taphysiques calqu├®s sur le monde de ses propres perceptions : monde des atomes, de la volont├®, de lŌĆÖesprit... chacun les voit ├Ā sa mani├©re. Mais d├©s que lŌĆÖon a saisi ce que la pens├®e offre de tout diff├®rent, on comprend que la perception est la moiti├® seulement de la r├®alit├®, et que lŌĆÖautre moiti├® (la p├®n├®tration de la perception par la pens├®e, processus v├®cu par lŌĆÖhomme) lui est indispensable pour constituer une r├®alit├® totale.
LŌĆÖessence qui se manifeste dans notre conscience sous la forme de pens├®e nŌĆÖappara├«t plus alors comme un reflet fugace des choses, mais comme une r├®alit├® spirituelle reposant absolument sur elle-m├¬me. Et, de cette r├®alit├®, lŌĆÖon peut dire quŌĆÖelle se fait conna├«tre ├Ā lŌĆÖhomme par une intuition. LŌĆÖintuition consiste ├Ā vivre consciemment dans un monde purement spirituel. CŌĆÖest seulement par un acte intuitif que lŌĆÖessence de la pens├®e peut ├¬tre saisie.
Et cŌĆÖest seulement lorsquŌĆÖon a connu cette essence, par un tel acte intuitif, que lŌĆÖon peut commencer ├Ā juger de lŌĆÖorganisation physique et psychique de lŌĆÖhomme. On aper├¦oit alors que cette organisation ne saurait rien changer ├Ā lŌĆÖessence de la pens├®e. Cette assertion semble dŌĆÖabord en contradiction avec les faits les plus certains. ├ēvidemment, pour lŌĆÖexp├®rience ordinaire, la pens├®e humaine nŌĆÖappara├«t quŌĆÖau sein de lŌĆÖorganisme et ├Ā travers lui. Le mode de cette apparition sŌĆÖimpose si puissamment au regard, quŌĆÖon perd de vue lŌĆÖind├®pendance r├®elle et compl├©te de la pens├®e ; mais rien de lŌĆÖorganisme ne peut agir sur elle. Il existe entre lŌĆÖorganisme et elle un rapport tout ├Ā fait sp├®cial que lŌĆÖon peut d├®finir comme suit : LŌĆÖorganisme nŌĆÖa aucune influence sur elle, mais il sŌĆÖefface, pour ainsi dire, lorsquŌĆÖelle entre en activit├®. Il inhibe en quelque sorte sa propre activit├®, il laisse la place libre pour que la pens├®e y apparaisse. La force de la pens├®e fait reculer celle de lŌĆÖorganisme et agit ├Ā sa place. On voit, dŌĆÖapr├©s cela, que lŌĆÖorganisme de lŌĆÖhomme forme, en un certain sens, un pendant avec la pens├®e ; cette notion est de toute importance pour bien comprendre ses rapports avec elle, et le r├┤le quŌĆÖil joue dans sa gen├©se. LorsquŌĆÖon marche sur un sol amolli, les pieds y impriment leur trace. Nul ne dira que ces traces sont caus├®es par les forces du sol, de bas en haut. On nŌĆÖattribuera aux forces du sol aucun r├┤le actif dans le ph├®nom├©ne. De m├¬me, lorsquŌĆÖon a observ├® de bonne foi ce quŌĆÖest la pens├®e, on nŌĆÖest aucunement tent├® de la croire conditionn├®e ou caus├®e par les traces quŌĆÖelle imprime dans lŌĆÖorganisation humaine en pr├®parant son apparition ├Ā travers cette derni├©re [nota: LŌĆÖauteur, dans les ouvrages qui ont suivi ce livre a montr├® ├Ā diff├®rents points de vue comment cette assertion se trouve confirm├®e par les donn├®es de la Psychologie, de la Physiologie, etc.. Ici, il nŌĆÖa expos├® que les r├®sultats dŌĆÖune observation impartiale de la pens├®e elle-m├¬me].
Mais ici, une question dŌĆÖun grand int├®r├¬t se pose si lŌĆÖorganisation humaine ne participe pas ├Ā lŌĆÖessence de la pens├®e, quel est, en d├®finitive, son r├┤le dans la constitution de lŌĆÖentit├® humaine globale ? Or, les ph├®nom├©nes que la pens├®e provoque dans lŌĆÖorganisation physique et psychique de lŌĆÖhomme sont sans rapport avec lŌĆÖessence m├¬me de la pens├®e, mais contribuent ├Ā la formation de la ┬½conscience du moi┬╗, telle quŌĆÖelle surgit de lŌĆÖacte pensant. Le vrai ┬½moi┬╗ est r├®ellement compris dans lŌĆÖessence de la pens├®e, mais non pas la ┬½conscience du moi┬╗. Il suffit dŌĆÖune observation impartiale de la pens├®e pour sŌĆÖen rendre compte. Si le ┬½moi┬╗ se trouve exister dans la pens├®e m├¬me, la conscience de ce ┬½moi┬╗ surgit, par contre, du fait que la pens├®e imprime ses traces dans la conscience ordinaire, comme on lŌĆÖa expos├® plus haut. (CŌĆÖest donc gr├óce ├Ā lŌĆÖorganisme que lŌĆÖhomme prend conscience du ┬½moi┬╗, mais quŌĆÖon nŌĆÖen d├®duise pas que cette conscience du moi, une fois apparue, demeure d├®pendante de cet organisme. Il nŌĆÖen est rien. Une fois apparue, la conscience du moi entre dans le domaine de la pens├®e et en partage dor├®navant la nature spirituelle.)
La conscience du moi est b├ótie sur lŌĆÖorganisme. CŌĆÖest de lui que d├®coulent les actes volontaires. Observons comment lŌĆÖacte volontaire surgit de lŌĆÖorganisme humain, et nous pourrons, dans le sens m├¬me des expos├®s qui pr├®c├©dent, entrer dans lŌĆÖexamen des rapports qui existent entre le moi conscient, lŌĆÖacte volontaire, et la pens├®e [nota: Le passage qui pr├®c├©de a ├®t├® remani├® en vue de la nouvelle ├®dition (1918)].
Dans un acte volontaire, il faut consid├®rer le motif et le mobile. Le motif est un facteur conceptuel ou repr├®sentatif. Le mobile est un facteur qui d├®pend directement de lŌĆÖorganisme humain. Le facteur conceptuel, ou motif, est le d├®terminant momentan├® du vouloir. Le mobile est une causalit├® durable qui fait partie de lŌĆÖindividu. Un concept pur, ou une repr├®sentation (concept individualis├®), peuvent devenir des motifs par le fait quŌĆÖils influencent lŌĆÖ├¬tre humain et le disposent ├Ā agir en un certain sens. N├®anmoins, le m├¬me concept (ou la m├¬me repr├®sentation) agira autrement sur diff├®rentes personnes, et am├©nera, selon leur mani├©re dŌĆÖ├¬tre, des vouloirs divers.
Le vouloir ne r├®sulte donc pas seulement de la repr├®sentation ou du concept, mais aussi de lŌĆÖidiosyncrasie de chaque homme, - nous nommerons ainsi les ┬½aptitudes caract├®ristiques┬╗ (on peut, ├Ā ce point de vue, sŌĆÖen r├®f├®rer ├Ā ├ēdouard von Hartmann). La mani├©re dont agissent les concepts ou les repr├®sentations sur lŌĆÖidiosyncrasie de lŌĆÖhomme conf├©re ├Ā la vie de celui-ci une certaine empreinte morale (├®thique).
De quoi ces ┬½aptitudes caract├®ristiques┬╗ sont-elles form├®es ? du contenu plus ou moins fixe de notre vie subjective, de la somme de nos repr├®sentations et de nos sentiments. Une repr├®sentation mŌĆÖincite plus ou moins au vouloir, selon quŌĆÖelle se comporte de telle ou telle fa├¦on vis-├Ā-vis de mes autres repr├®sentations et de mes sentiments personnels. Or, la somme de mes repr├®sentations est conditionn├®e par la somme de concepts qui, le long de ma vie, se sont adjoints ├Ā mes perceptions, cŌĆÖest-├Ā-dire sont devenus des repr├®sentations. Elle d├®pend donc de ma facult├® dŌĆÖintuition, qui est plus ou moins grande, et de mon champ dŌĆÖobservation ; autrement dit, du facteur subjectif et du facteur objectif de mon exp├®rience : facult├®s int├®rieures et milieu. Quant ├Ā mes sentiments, ils d├®terminent nettement mes ┬½aptitudes caract├®ristiques┬╗. Selon quŌĆÖune repr├®sentation me cause de la joie ou de la peine, elle peut devenir, ou non, motif de mon vouloir. Tels sont les ├®l├®ments qui entrent dans la gen├©se de lŌĆÖacte volontaire. La repr├®sentation imm├®diatement pr├®sente, ou le concept, en devenant motifs, fournissent le but, la fin de mon vouloir. Mon ┬½idiosyncrasie┬╗ mŌĆÖinvite ├Ā orienter mon activit├® vers cette fin. Par exemple la repr├®sentation dŌĆÖune promenade ├Ā faire pendant la demi-heure qui vient d├®termine le but de mon action, mais elle ne devient un motif de vouloir que si elle rencontre en moi une idiosyncrasie appropri├®e, cŌĆÖest-├Ā-dire si toute ma vie pr├®c├®dente mŌĆÖa amen├® ├Ā reconna├«tre lŌĆÖutilit├® des promenades, la valeur de la sant├® et, enfin, si la repr├®sentation de promenade ├®veille en moi un sentiment de joie.
Nous avons par cons├®quent ├Ā distinguer : 1┬░ les ┬½aptitudes caract├®ristiques┬╗ possibles, qui permettent ├Ā tels concepts ou ├Ā telles perceptions de devenir des motifs ; 2┬░ les concepts et les repr├®sentations possibles, capables dŌĆÖinfluencer mes dispositions de caract├©re jusquŌĆÖ├Ā amener un vouloir. Les premi├©res conditions sont les mobiles, et les secondes, les fins de notre conduite morale.
Les mobiles de notre conduite morale peuvent ├¬tre trouv├®s par lŌĆÖexamen des ├®l├®ments constitutifs de notre vie individuelle.
La premi├©re phase de cette vie individuelle est la perception et, plus exactement, la perception par les sens. CŌĆÖest l├Ā une r├®gion de notre ├¬tre o├╣ le vouloir est imm├®diatement d├®clench├® par la perception sans quŌĆÖintervienne ni sentiment, ni concept. Les mobiles de cet ordre sont g├®n├®ralement nomm├®s app├®tits. La satisfaction de nos besoins animaux et inf├®rieurs (faim, d├®sir sexuel, etc.), sŌĆÖaccomplit de cette mani├©re. La caract├®ristique de ce stade de vie, cŌĆÖest la mani├©re imm├®diate dont une perception isol├®e y d├®termine un vouloir. Ce mode de d├®termination, qui, originellement, sŌĆÖapplique dans la vie proprement sensuelle, peut ├®galement sŌĆÖ├®tendre ├Ā des actes plus ├®lev├®s. Il arrive que nous agissions imm├®diatement apr├©s une perception, sans y r├®fl├®chir et sans que rien se produise dans notre vie sentimentale ; par exemple, les conventions de la vie sociale appellent de tels actes, et lŌĆÖon peut embrasser leurs mobiles sous le nom g├®n├®ral de tact ou de go├╗t moral. Plus ces actes se r├®p├©tent, plus le sujet devient apte ├Ā les accomplir sous la pure influence du tact, cŌĆÖest-├Ā-dire que le tact devient une de ses aptitudes caract├®ristiques.
La seconde sph├©re de la vie humaine est celle du sentiment. Aux perceptions du monde ext├®rieur sŌĆÖadjoignent certains sentiments, et ceux-ci peuvent devenir mobiles dŌĆÖaction. Lorsque, par exemple, je vois un homme affam├®, mon sentiment de piti├® peut constituer un mobile dŌĆÖaction. Citons de tels sentiments : la honte, la fiert├®, le sentiment de lŌĆÖhonneur, le respect, le remords, la piti├®, le d├®sir de vengeance, la reconnaissance, la pi├®t├®, la fid├®lit├®, lŌĆÖamour, le sentiment du devoir [nota: une ├®tude compl├©te des principes de la moralit├® a ├®t├® faite, du point de vue du r├®alisme m├®taphysique, par ├ēd von Hartmann dans "Ph├®nom├®nologie de la conscience morale"].
La troisi├©me sph├©re de la vie est celle de la pens├®e et de la repr├®sentation. Il se peut quŌĆÖun concept ou une repr├®sentation devienne mobile dŌĆÖaction ├Ā la suite dŌĆÖune pure r├®flexion. Des repr├®sentations deviennent des mobiles par le fait que nous ne cessons, au cours de notre vie, de rattacher des buts dŌĆÖaction ├Ā des perceptions, et que ces perceptions se r├®p├©tent sous une forme plus ou moins inchang├®e. Il y a donc, chez lŌĆÖhomme dou├® de quelque exp├®rience, des perceptions pr├®cises qui appellent in├®vitablement lŌĆÖid├®e de certaine action, parce que, dans des cas semblables, il lŌĆÖa ex├®cut├®e ou lŌĆÖa vu ex├®cuter. Ces id├®es dŌĆÖaction lŌĆÖaccompagnent dor├®navant comme des mod├©les d├®terminants, et font partie de ses aptitudes caract├®ristiques. On peut dire que les mobiles de ce genre forment lŌĆÖexp├®rience pratique de lŌĆÖhomme. Cette exp├®rience pratique se fond peu ├Ā peu dans ce que nous avons nomm├® le tact, car lŌĆÖhomme arrive ├Ā lier si ├®troitement, ├Ā certaines situations de la vie, certaines images typiques dŌĆÖaction, quŌĆÖil saute bient├┤t par-dessus toute r├®flexion et ex├®cute lŌĆÖacte dŌĆÖune fa├¦on imm├®diate.
Le stade sup├®rieur de la vie individuelle, cŌĆÖest la pens├®e pure conceptuelle, sans rapport avec aucun contenu de perception. Nous d├®terminons alors le contenu dŌĆÖun concept par une intuition pure, nous le tirons enti├©rement de la sph├©re id├®elle. Un tel concept est, ├Ā son origine, sans rapport avec aucune perception. Or, dans le cas o├╣ nous d├®terminons notre vouloir dŌĆÖapr├©s une repr├®sentation (cŌĆÖest-├Ā-dire dŌĆÖapr├©s un concept relatif ├Ā une perception), cŌĆÖest, en derni├©re analyse, la perception qui nous d├®termine. Mais, lorsque nous agissons sous lŌĆÖinfluence dŌĆÖune intuition, notre mobile est la pens├®e pure. Comme on a lŌĆÖusage, en philosophie, dŌĆÖappeler la pure facult├® pensante raison, il nous para├«t juste de nommer le mobile que nous venons de d├®finir raison pratique. On en trouve lŌĆÖ├®tude la plus claire dans Kreyenb├╝hl [voir: "Cahiers mensuels de philosophie" par Kreyenb├╝hl, vol. XVIII, cahier 3]. JŌĆÖestime que cette ├®tude est un des documents les plus importants de la philosophie moderne, et surtout en ce qui concerne lŌĆÖ├®thique. Kreyenb├╝hl d├®finit les mobiles dont nous venons de parler comme un a priori pratique, cŌĆÖest-├Ā-dire une impulsion d├®coulant imm├®diatement de lŌĆÖintuition.
Naturellement, ce genre dŌĆÖimpulsions ne peut plus ├¬tre mis au rang des aptitudes caract├®ristiques. Car ici, il nŌĆÖy a plus seulement un ├®l├®ment individuel, mais un contenu id├®el et, par cons├®quent commun ├Ā tous, de mon intuition. Lorsque jŌĆÖadmets que ce contenu devienne la base et le point de d├®part de mon action, jŌĆÖentre aussit├┤t dans la sph├©re du vouloir, et peu mŌĆÖimporte que le concept initial ait ├®t├® mien depuis longtemps d├®j├Ā, ou quŌĆÖil vienne seulement de mŌĆÖappara├«tre ; cŌĆÖest-├Ā-dire, peu importe quŌĆÖil ait ├®t├® d├®j├Ā pr├®sent au titre dŌĆÖ┬½aptitude caract├®ristique┬╗, ou non.
La seule chose qui importe pour quŌĆÖil y ait r├®ellement acte volontaire, cŌĆÖest que lŌĆÖimpulsion momentan├®e agisse, au moyen dŌĆÖun concept ou dŌĆÖune repr├®sentation, sur les aptitudes caract├®ristiques. Cette impulsion devient alors un motif de vouloir.
Les motifs de la conduite morale sont des repr├®sentations et des concepts. Il y a des moralistes qui voient aussi dans le sentiment un motif ├®thique. Ils affirment, par exemple, que la pr├®tention de lŌĆÖindividu ├Ā un maximum de joie est un motif dŌĆÖaction morale. Mais la joie elle-m├¬me ne saurait devenir un motif, seule la repr├®sentation de la joie peut jouer ce r├┤le. La repr├®sentation dŌĆÖun sentiment futur peut agir sur mes ┬½aptitudes caract├®ristiques┬╗, mais non point le sentiment lui-m├¬me. Car le sentiment, au moment de lŌĆÖaction, nŌĆÖest pas encore donn├® ; on attend justement quŌĆÖil r├®sulte de cette action.
La repr├®sentation de son propre bien, ou du bien dŌĆÖautrui, est consid├®r├®e, ├Ā juste titre, comme un motif du vouloir. Le principe dŌĆÖapr├©s lequel on recherche le maximum de sa propre joie, cŌĆÖest-├Ā-dire le bonheur individuel, est lŌĆÖ├®go├»sme. Les uns veulent atteindre ce bonheur personnel sans ├®gard ├Ā celui des autres, et m├¬me aux d├®pens des individualit├®s voisines (pur ├®go├»sme). Les autres travaillent au bien dŌĆÖautrui parce quŌĆÖils se promettent de recevoir ensuite de ces personnes heureuses une influence favorable, ou parce que, du dommage ressenti par les autres, ils craignent une l├®sion de leurs propres int├®r├¬ts (morale de lŌĆÖint├®r├¬t). La nuance de la morale ├®go├»ste d├®pend de la repr├®sentation quŌĆÖon se fait de son bien et de celui des autres. DŌĆÖapr├©s ce quŌĆÖon estime ├¬tre enviable (bien-├¬tre, espoir de b├®atitude future, d├®livrance de certains maux), le but de cette morale se trouve pr├®cis├®.
Passons ├Ā un second ordre de motifs : le contenu purement conceptuel des actions. Tandis que la repr├®sentation de la joie, par exemple, sŌĆÖapplique ├Ā une action isol├®e, le contenu conceptuel base lŌĆÖaction sur tout un syst├©me de principes moraux. Ces principes moraux peuvent ├¬tre ├®nonc├®s sous forme de r├©gles abstraites sans que lŌĆÖindividu se pr├®occupe de conna├«tre leur origine. Il ressent alors simplement sa subordination au concept moral qui plane au-dessus de ses actes comme un commandement, comme une n├®cessit├® morale. Il laisse alors le soin de justifier ces principes ├Ā ceux qui repr├®sentent une autorit├® morale (chef de famille, ├ētat, moeurs et coutumes, commandement de lŌĆÖ├ēglise, r├®v├®lation divine). Un mode particulier de cette morale, cŌĆÖest le cas o├╣ le commandement nŌĆÖest plus donn├® par une autorit├® ext├®rieure, mais int├®rieure (autonomie morale). Nous entendons alors une voix int├®rieure ├Ā laquelle nous devons ob├®ir. Cette voix est appel├®e conscience.
Il y a un progr├©s moral d├©s lŌĆÖinstant o├╣ lŌĆÖhomme, non content dŌĆÖob├®ir simplement ├Ā un commandement ext├®rieur ou int├®rieur, sŌĆÖefforce de comprendre les causes pour lesquelles telle ou telle maxime dŌĆÖaction doit lui devenir un motif. Par ce progr├©s, il sŌĆÖ├®l├©ve, de la morale dŌĆÖautorit├®, ├Ā une morale bas├®e sur la compr├®hension. ├Ć cette ├®tape de la moralit├®, lŌĆÖhomme va reconna├«tre lui-m├¬me quels sont les besoins de la vie morale, et la connaissance quŌĆÖil en aura va d├®terminer sa conduite. Ces besoins sont, entre autres : 1┬░ le plus grand bien possible de toute lŌĆÖhumanit├®, ce bien ├®tant consid├®r├® comme un but en soi ; 2┬░ le progr├©s de la civilisation, ou lŌĆÖ├®volution morale de lŌĆÖhumanit├® vers une perfection toujours plus grande ; 3┬░ la r├®alisation de fins morales individuelles et intuitivement donn├®es.
Le plus grand bien possible de toute lŌĆÖhumanit├®, voici ce que chacun peut concevoir ├Ā sa mani├©re. Cette maxime, en effet, ne se rapporte pas ├Ā une repr├®sentation pr├®cise du bien que lŌĆÖon recherche ; elle implique seulement que lŌĆÖindividu, lorsquŌĆÖil lŌĆÖaura reconnue, sŌĆÖefforcera de toujours faire ce qui, ├Ā son avis, favorisera le plus le bien de toute lŌĆÖhumanit├®.
Le progr├©s de la civilisation, au cas o├╣ lŌĆÖon associe aux pr├®sents de la civilisation une id├®e de joie, nŌĆÖest quŌĆÖun cas particulier du principe pr├®c├®dent. On est seulement oblig├®, ici, de se r├®signer ├Ā la destruction de certaines choses qui, cependant, servaient le bien de lŌĆÖhumanit├®. Il arrive aussi que lŌĆÖon fait abstraction de la joie associ├®e au progr├©s de la civilisation, et qu'on aper├¦oit ce dernier comme une n├®cessit├® morale. Il devient alors un nouveau principe qui sŌĆÖajoute au pr├®c├®dent.
Ces deux maximes, celle du plus grand bien, comme celle du progr├©s, reposent sur la repr├®sentation, cŌĆÖest-├Ā-dire sur le rapport quŌĆÖon a ├®tabli entre des contenus dŌĆÖid├®es morales, et des exp├®riences (perceptions). Le principe moral le plus ├®lev├® quŌĆÖon puisse concevoir, cŌĆÖest celui qui ne pr├®suppose aucune relation de ce genre, celui qui jaillit ├Ā la source de la pure intuition, et cherche, ensuite seulement, son rapport ├Ā la perception (├Ā la vie). La d├®termination du vouloir proc├©de alors dŌĆÖune toute autre instance que dan les premiers cas. LŌĆÖhomme qui veut servir le bien de lŌĆÖhumanit├® se demande, ├Ā chacun de ses actes, en quoi ils contribuent ├Ā ce bien. Il en est de m├¬me pour lŌĆÖhomme qui sert le progr├©s de la civilisation. Mais il y a un principe plus ├®lev├® qui, dans chaque cas particulier, ne d├®pend plus de telle ou telle fin morale, qui, pr├®cis├®ment, donne ├Ā toutes les fins morales leur valeur, et qui d├®cide, en chaque cas, de celle qui doit pr├®dominer. Il peut arriver que lŌĆÖon se croie justifi├® dŌĆÖagir, en certaines circonstances, au nom du progr├©s de la civilisation, en dŌĆÖautres, au nom du bien de lŌĆÖhumanit├®, et, en dŌĆÖautres encore, pour son propre bien. Mais lorsque toutes les causes d├®terminantes passent ├Ā lŌĆÖarri├©re-plan, alors lŌĆÖintuition conceptuelle entre en jeu. Tandis que les autres motifs c├©dent le gouvernail, le contenu id├®el de lŌĆÖaction devient seul d├®terminant.
Nous avons d├®fini, comme ├®tant la plus ├®lev├®e parmi les ┬½aptitudes caract├®ristiques┬╗, la pens├®e pure agissant comme raison pratique. Parmi les motifs, nous dirons que le plus ├®lev├® est lŌĆÖintuition conceptuelle. Il appara├«t donc, ├Ā lŌĆÖexamen, quŌĆÖ├Ā ce degr├® de la moralit├®, motif et mobile ne font plus quŌĆÖun, cŌĆÖest-├Ā-dire quŌĆÖil nŌĆÖy a plus pour d├®terminer nos actes ni ┬½aptitude caract├®ristique┬╗ d├®j├Ā existante, ni ┬½principe de moralit├®┬╗ admis comme norme. LŌĆÖacte, alors, nŌĆÖest plus mesur├® ├Ā aucun ├®talon ; il ne sŌĆÖaccomplit plus dŌĆÖapr├©s aucune r├©gle ; et il nŌĆÖest plus de ceux que lŌĆÖhomme ex├®cute automatiquement sous une pouss├®e de lŌĆÖext├®rieur. Il est absolument d├®termin├® par son contenu id├®el.
La condition premi├©re dŌĆÖun tel acte, cŌĆÖest notre facult├® dŌĆÖintuition morale. LŌĆÖhomme auquel manque le don de vivre, pour chaque cas particulier, la maxime de moralit├® correspondante, est incapable de sŌĆÖ├®lever jusquŌĆÖau vouloir r├®ellement individuel.
Le principe de moralit├® que nous venons dŌĆÖexposer est directement oppos├® ├Ā celui de Kant : ┬½Agis, dit Kant, de telle sorte que les principes de ton action puissent ├¬tre valables pour tous les hommes┬╗. Cette phrase est la mort de toute impulsion individuelle. Ce nŌĆÖest pas ┬½comme tous les hommes┬╗ que je d├®termine mon action morale, mais comme je dois lŌĆÖaccomplir, moi, dans le cas individuel qui se pr├®sente.
Un jugement superficiel pourrait objecter comment lŌĆÖaction peut-elle ├¬tre ├Ā la fois individuelle, sp├®ciale au cas pr├®sent et ├Ā la situation particuli├©re, - et issue de la pure intuition id├®elle ? Cette objection repose sur une confusion entre le motif moral et le contenu perceptible de lŌĆÖaction. Il arrive que ce dernier soit un motif, par exemple dans le cas du progr├©s, ou dans celui de lŌĆÖacte ├®go├»ste ; mais, lorsquŌĆÖon agit par pure intuition morale, il ne lŌĆÖest pas. Le moi dirige naturellement son attention sur ce contenu perceptible, mais il ne se laisse pas d├®terminer par lui. Il lŌĆÖutilise seulement pour se former un concept de connaissance, mais le concept moral ne ressort pas de cet objet perceptible. Le concept de connaissance que je tire dŌĆÖune certaine situation ne saurait ├¬tre en m├¬me temps motif moral que si je me tiens sur le terrain dŌĆÖun certain principe de moralit├®. Par exemple, si je demeure sur le terrain exclusif de la morale dite ┬½du progr├©s de la civilisation┬╗, je mŌĆÖen irai par le monde avec un itin├®raire tout trac├®. De chaque ├®v├®nement auquel je serai m├¬l├®, jaillira pour moi un devoir moral, ├Ā savoir, celui de contribuer, par cet ├®v├®nement, ├Ā servir le progr├©s de la civilisation. Outre le concept que me d├®voile la structure naturelle des ph├®nom├©nes ou des choses, ces ph├®nom├©nes et ces choses portent alors une sorte dŌĆÖ├®tiquette morale qui, pour lŌĆÖ├¬tre humain, pour lŌĆÖ├¬tre moral, contient lŌĆÖindication de la conduite ├Ā tenir. Cette ├®tiquette morale est parfaitement justifi├®e dans son domaine, mais elle co├»ncide, ├Ā un stade sup├®rieur, avec lŌĆÖid├®e qui jaillit dans lŌĆÖesprit humain vis-├Ā-vis du cas concret.
La facult├® dŌĆÖintuition varie selon les hommes. Chez les uns, les id├®es jaillissent sans cesse ; les autres les acqui├©rent p├®niblement. Les situations dans lesquelles lŌĆÖhomme se trouve sont non moins variables, et ce sont elles qui lui fournissent le th├®├ótre de ses actions. Ainsi, les actions dŌĆÖun homme d├®pendent du contact qui sŌĆÖ├®tablit entre sa facult├® dŌĆÖintuition dŌĆÖune part, et les situations de sa vie de lŌĆÖautre. La somme des id├®es actives, le contenu r├®el des intuitions dŌĆÖun homme, ├®chappe au caract├©re g├®n├®ral et commun que rev├¬t dŌĆÖordinaire le monde id├®el, et appara├«t avec un caract├©re franchement individuel en chacun de nous. Cette somme dŌĆÖintuitions, dans la mesure o├╣ elle est mise en acte, constitue la moralit├® r├®elle de lŌĆÖindividu. La laisser vivre et se r├®aliser, cŌĆÖest l├Ā le mobile moral supr├¬me, et cŌĆÖest, en m├¬me temps, le motif moral supr├¬me pour quiconque a reconnu que tous les autres principes de moralit├® sont fond├®s, en derni├©re analyse, sur lui. Nous nommerons le point de vue que nous venons dŌĆÖexposer lŌĆÖindividualisme ├®thique.
Dans un cas concret, lŌĆÖaction telle que nous venons de la d├®finir ne se r├©gle que sur lŌĆÖintuition correspondante et toute individuelle. ├Ć ce stade de la moralit├®, on ne peut parler de lois morales g├®n├®rales (normes, principes) que dans la mesure o├╣ elles sont la g├®n├®ralisation des impulsions personnelles. Les normes g├®n├®rales pr├®supposent certains ├®tats de faits concrets, dŌĆÖo├╣ on les peut d├®duire. Mais cŌĆÖest lŌĆÖaction humaine elle-m├¬me qui doit cr├®er des ├®tats de fait.
La recherche des ├®l├®ments conceptuels normaux qui d├®terminent les actions des individus, des peuples, des ├®poques, fournit bien une ├®thique ; celle-ci nŌĆÖest pas une science des commandements moraux, elle est plut├┤t une ├®tude naturelle de la moralit├®. Les lois quŌĆÖelle d├®couvre se comportent, vis-├Ā-vis des actions humaines, comme les lois naturelles vis-├Ā-vis des ph├®nom├©nes. Mais ces lois ne sont absolument pas identiques ├Ā nos impulsions individuelles. Pour comprendre comment un acte humain jaillit du vouloir moral de lŌĆÖhomme, il faut, tout dŌĆÖabord, ├®tudier le rapport de ce vouloir ├Ā lŌĆÖacte. Il faut envisager des actions vraiment d├®termin├®es par lui. Lorsqu'on r├®fl├®chit, par la suite, ├Ā de telles actions, on peut trouver les maximes morales qui sŌĆÖy appliquaient. Au moment de lŌĆÖaction, la maxime morale, dans la mesure o├╣ elle pouvait prendre en moi une existence intuitive, me poussait ; elle ├®tait associ├®e ├Ā un sentiment dŌĆÖamour pour lŌĆÖobjet que je cherchais ├Ā r├®aliser. Je ne demandais lŌĆÖavis de personne et ne me confiais ├Ā nulle r├©gle. JŌĆÖagissais parce que jŌĆÖavais con├¦u lŌĆÖid├®e de cette action. Et cŌĆÖest par l├Ā quŌĆÖelle ├®tait mon action. Au contraire, lorsquŌĆÖon agit parce quŌĆÖon reconna├«t certaines normes morales, lŌĆÖaction nŌĆÖest quŌĆÖun r├®sultat du principe inscrit dans le code moral. LŌĆÖhomme nŌĆÖest que lŌĆÖex├®cuteur. Il est un automate dŌĆÖordre ├®lev├®. QuŌĆÖon lui donne lŌĆÖoccasion dŌĆÖagir, et aussit├┤t se mettent ├Ā tourner les rouages de ses principes moraux, pour amener, dŌĆÖune fa├¦on automatique, une action chr├®tienne, humanitaire, ├®go├»ste, civilisatrice, etc.. CŌĆÖest seulement lorsquŌĆÖon agit par amour pour lŌĆÖobjet de lŌĆÖaction, que lŌĆÖon peut dire : jŌĆÖagis moi-m├¬me. Ce nŌĆÖest plus parce quŌĆÖon reconna├«t tel ou tel ma├«tre, telle autorit├® ext├®rieure, ou telle voix soi-disant int├®rieure. LŌĆÖaction nŌĆÖa plus aucun principe au dehors ; parce quŌĆÖon a trouv├® en soi-m├¬me sa v├®ritable base, qui est lŌĆÖamour de cette action. On nŌĆÖexamine plus logiquement si elle doit ├¬tre nomm├®e bonne ou mauvaise, on lŌĆÖaccomplit parce quŌĆÖon lŌĆÖaime. Elle est ┬½bonne┬╗ ├Ā la condition que lŌĆÖintuition, satur├®e dŌĆÖamour, soit r├®ellement accord├®e aux grandes lois universelles dont la connaissance ne peut ├¬tre, justement, quŌĆÖintuitive. Au cas contraire, elle est ┬½mauvaise┬╗. On ne se demande pas non plus comment les autres hommes agiraient en pareil cas. On agit selon le vouloir dont on trouve lŌĆÖindication en soi. On nŌĆÖest conduit ni par lŌĆÖusage commun, ni par les coutumes, ni par une maxime humaine g├®n├®rale, ni par une norme morale, mais bien par lŌĆÖamour de lŌĆÖaction elle-m├¬me. On ne se soumet ├Ā aucun joug, ni celui de la nature (instincts), ni celui des lois morales ; on veut simplement accomplir ce que lŌĆÖon se sent appel├® ├Ā accomplir.
Les d├®fenseurs des lois morales pourraient nous dire si chaque individu nŌĆÖa quŌĆÖ├Ā vivre ainsi sa propre vie et faire ce qui lui pla├«t, alors il nŌĆÖy ├Ā plus de diff├®rence entre les bonnes actions et les crimes. NŌĆÖimporte quel caprice, dont je trouve en moi lŌĆÖindication, peut pr├®tendre ├Ā se r├®aliser aussi bien que mon intention de servir le bien g├®n├®ral. Et ils ajoutent : ce qui peut servir de crit├®rium ├Ā lŌĆÖhomme moral nŌĆÖest pas le fait quŌĆÖil a saisi lŌĆÖid├®e dŌĆÖune action, mais lŌĆÖexamen qui d├®cr├©te cette action bonne ou mauvaise. LŌĆÖhomme moral ne lŌĆÖex├®cute que dans le premier cas.
Cette objection se pr├®sente assez naturellement, mais elle ressort n├®anmoins dŌĆÖune fausse compr├®hension de nos principes. Voici la r├®ponse que nous y faisons : pour reconna├«tre la nature du vouloir humain, il faut distinguer entre le chemin par lequel le vouloir sŌĆÖ├®l├©ve jusquŌĆÖ├Ā un certain degr├® dŌĆÖ├®volution, et lŌĆÖaspect personnel que rev├¬t le vouloir lorsquŌĆÖil se rapproche du degr├® dŌĆÖind├®pendance que nous avons d├®fini ici. Sur ce chemin de lŌĆÖ├®volution, les normes jouent un r├┤le qui se justifie parfaitement. Mais le vrai but du vouloir humain, cŌĆÖest la r├®alisation de buts moraux con├¦us par pure intuition. LŌĆÖhomme se rapproche plus ou moins de ce but, selon la mesure dans laquelle il est apte ├Ā la p├®n├®tration intuitive des bases id├®elles de lŌĆÖunivers. Le plus souvent, dans le vouloir individuel, dŌĆÖautres ├®l├®ments se m├¬lent aux buts moraux, ├Ā titre de motifs ou de mobiles. Mais lŌĆÖintuition peut toujours ├¬tre d├®terminante ou co-d├®terminante. Elle est la causalit├® morale. LŌĆÖhomme apporte le champ dŌĆÖaction o├╣ sŌĆÖop├©re la transformation de cette causalit├® en acte. Il en r├®sulte ce que lŌĆÖon appelle la conduite personnelle dŌĆÖun ├¬tre. LŌĆÖorigine de lŌĆÖaction appartient ├Ā lŌĆÖindividualit├®. Et, en v├®rit├®, seule lŌĆÖaction issue de lŌĆÖintuition morale m├®rite le nom dŌĆÖaction individuelle. Mais compter lŌĆÖaction mauvaise, le crime, au rang des actions individuelles, ce serait compter les instincts aveugles parmi les facteurs de lŌĆÖindividualit├®. Or, lŌĆÖinstinct aveugle qui m├©ne au crime ne ressort pas de lŌĆÖintuition ; et il nŌĆÖappartient pas ├Ā lŌĆÖ├¬tre individuel de lŌĆÖhomme, mais, au contraire, ├Ā ce que lŌĆÖhomme a de plus commun, ├Ā ce qui r├©gne en tous les hommes, ├Ā ce dont lŌĆÖindividualit├® cherche justement ├Ā d├®gager lŌĆÖhomme de plus en plus. Mon ├¬tre individuel, ce nŌĆÖest pas mon organisme avec ses tendances et ses affectivit├®s, cŌĆÖest le monde unitaire des id├®es, qui sŌĆÖ├®claire au sein de cet organisme. Mes d├®sirs, mes instincts, mes passions, me font simplement appartenir ├Ā lŌĆÖesp├©ce humaine. Au contraire, le fait quŌĆÖun ├®l├®ment id├®el sŌĆÖ├®claire et se r├®alise au sein de ces d├®sirs, instincts et passions, ce fait fonde ma propre individualit├®. Par mes d├®sirs et instincts, je suis seulement un homme comme il en est ├Ā la douzaine ; par la forme particuli├©re dŌĆÖid├®e qui me distingue au sein de la douzaine, je suis ┬½individu┬╗. Les particularit├®s de ma nature animale ne peuvent me diff├®rencier des autres que pour un regard ├®tranger, tandis que par ma pens├®e, qui est la compr├®hension active et consciente de lŌĆÖ├®l├®ment id├®el pr├®sent en moi, je me distingue moi-m├¬me des autres. Or, on ne peut aucunement dire de lŌĆÖaction du criminel quŌĆÖelle jaillit de lŌĆÖid├®e. Ce qui la caract├®rise, au contraire, cŌĆÖest justement quŌĆÖelle ressort de lŌĆÖ├®l├®ment extra-id├®el du monde.
Toute action bas├®e sur lŌĆÖ├®l├®ment id├®el de lŌĆÖ├¬tre est ressentie comme ├®tant une action libre. Celles qui se basent sur dŌĆÖautres ├®l├®ments, que ce soit le joug de la nature, ou une norme morale, sont ressenties comme des actions impos├®es.
LŌĆÖhomme est libre dans la mesure o├╣ il est capable de nŌĆÖob├®ir quŌĆÖ├Ā lui-m├¬me, ├Ā chaque instant de sa vie. Une action morale nŌĆÖest mon action que si elle peut ├¬tre nomm├®e libre, dans le sens que nous venons de pr├®ciser. Nous nŌĆÖexaminerons pour lŌĆÖinstant que les conditions dans lesquelles une action voulue est ressentie par lŌĆÖhomme comme ├®tant libre ; nous verrons plus loin comment cette id├®e de la libert├®, que nous concevons ici dŌĆÖune mani├©re purement ├®thique, se r├®alise dans lŌĆÖ├¬tre humain total.
LŌĆÖaction n├®e de la libert├® nŌĆÖexclut pas les lois morales, elle les inclut au contraire ; elle se montre seulement sup├®rieure aux actions qui sont simplement dict├®es par ces lois. Pourquoi mon action servirait-elle moins bien le bonheur de tous, lorsque je lŌĆÖaccomplis par amour, que lorsque je lŌĆÖaccomplis seulement parce que jŌĆÖai reconnu le devoir de servir ce bonheur de tous ? La conception du devoir pur ├®limine la libert├® humaine, parce quŌĆÖelle se refuse ├Ā tenir compte de lŌĆÖindividuel et quŌĆÖelle soumet tous les hommes ├Ā une loi uniforme. La libert├® de lŌĆÖaction nŌĆÖest concevable que du point de vue de lŌĆÖindividualisme ├®thique.
Seulement, comment la vie collective sŌĆÖorganisera-t-elle lorsque chacun ne cherchera quŌĆÖ├Ā mettre son individualit├® en valeur ? CŌĆÖest l├Ā une objection courante du ┬½moralisme┬╗ mal compris. Il croit quŌĆÖune collectivit├® humaine nŌĆÖest possible que si un ordre moral fixe et commun en r├®unit tous les membres. Ce moralisme-l├Ā m├®conna├«t le caract├©re unitaire du monde id├®el. Il ne sait pas que le monde dŌĆÖid├®es qui agit en moi est le m├¬me que celui qui agit en chacun de mes semblables. ├Ć vrai dire, si nous savons que cette unit├® existe, cŌĆÖest seulement gr├óce ├Ā la constatation que nous pouvons en faire dŌĆÖune mani├©re universelle. Cette unit├®, dŌĆÖailleurs, doit ├¬tre objet dŌĆÖexp├®rience, car si elle ├®tait connaissable par une autre voie que celle de lŌĆÖobservation, son domaine cesserait dŌĆÖ├¬tre celui de lŌĆÖexp├®rience individuelle, pour devenir celui dŌĆÖune norme commune. LŌĆÖindividualit├® nŌĆÖest possible que l├Ā o├╣ chaque ├¬tre individuel ne conna├«t les autres que par son observation individuelle. La diff├®rence entre mon semblable et moi, ce nŌĆÖest pas que nous vivons dans deux mondes spirituels diff├®rents, mais que nous recevons dŌĆÖun m├¬me monde id├®el des intuitions diff├®rentes. Lui, veut r├®aliser ses intuitions, et moi, les miennes. Si nous puisons tous deux, v├®ritablement ├Ā lŌĆÖid├®e, et non point ├Ā des sources ext├®rieures dŌĆÖimpulsion (physique ou spirituelle), nous nous rencontrerons forc├®ment dans le m├¬me effort, dans les m├¬mes intentions. Tout malentendu, toute collision, est impossible entre des hommes moralement libres. Seul, lŌĆÖhomme encha├«n├® encore ├Ā lŌĆÖinstinct naturel, ou ├Ā un devoir imp├®ratif, se heurte ├Ā ceux de ses semblables qui nŌĆÖob├®issent pas au m├¬me instinct ou au m├¬me devoir. La maxime fondamentale de lŌĆÖhomme libre, cŌĆÖest ┬½agir par lŌĆÖamour de lŌĆÖaction, et laisser agir par la compr├®hension des vouloirs ├®trangers┬╗. Il ne conna├«t pas dŌĆÖautre ┬½tu dois┬╗ que la nature m├¬me des actions intuitivement con├¦ues et voulues ; la mani├©re dont il se comporte en tel ou tel cas ne d├®pend que de son propre pouvoir id├®el.
Si la base de lŌĆÖentente entre les hommes ne se trouvait pas donn├®e dans la nature m├¬me de lŌĆÖ├¬tre humain, il nŌĆÖy aurait pas de loi ext├®rieure qui la lui puisse fournir. Si les individus humains arrivent ├Ā vivre en commun, cŌĆÖest quŌĆÖils participent ├Ā un seul et m├¬me esprit. LŌĆÖhomme libre base sa vie sur la confiance quŌĆÖil a en dŌĆÖautres hommes libres, sachant quŌĆÖils appartiennent au m├¬me monde spirituel que lui, et que leurs intentions rencontreront les siennes. LŌĆÖhomme libre nŌĆÖexige pas lŌĆÖapprobation des autres, mais il lŌĆÖattend parce quŌĆÖelle est conforme ├Ā la nature humaine. Ceci ne concerne pas telles ou telles institutions ext├®rieures sur lesquelles les avis peuvent diff├®rer, mais le caract├©re g├®n├®ral des intentions et de lŌĆÖ├®tat dŌĆÖ├óme gr├óce auxquels lŌĆÖhomme arrive ├Ā vivre sa propre individualit├®, dans un respect parfait de la dignit├® humaine, au milieu dŌĆÖautres hommes libres quŌĆÖil sait estimer.
On me dira sans doute que cette conception de lŌĆÖhomme libre est une pure chim├©re et quŌĆÖon ne la trouve r├®alis├®e nulle part. Nous avons affaire ├Ā des hommes r├®els, et il nŌĆÖest gu├©re ├Ā esp├®rer en leur moralit├® que sŌĆÖils veulent bien ob├®ir ├Ā un commandement moral, concevoir leur mission morale comme un devoir, et ma├«triser leurs inclinations, leur amour. Je ne le nie point, car ce serait faire preuve dŌĆÖaveuglement. Mais alors, quŌĆÖon renonce ├Ā toute flatterie, et si cette derni├©re opinion doit seule pr├®valoir, que lŌĆÖon dise simplement : tant que la nature humaine nŌĆÖest pas libre, il faut lŌĆÖobliger ├Ā agir. Que lŌĆÖon exerce un joug par des moyens physiques, ou par des lois morales, que lŌĆÖhomme soit esclave parce quŌĆÖil est entra├«n├® par son instinct sexuel ou parce quŌĆÖil est encha├«n├® dans les liens de la morale conventionnelle, cŌĆÖest indiff├®rent au point de vue de la libert├®. Mais quŌĆÖon ne pr├®tende pas que cet homme-l├Ā a le droit de nommer siennes des actions quŌĆÖun pouvoir ├®tranger le force ├Ā accomplir. Cependant, du sein de lŌĆÖordre imp├®ratif surgissent les esprits libres, les hommes v├®ritables qui ont su se trouver eux-m├¬mes dans le r├®seau des usages, des lois, des pratiques religieuses, etc. Ils sont libres dans la mesure o├╣ ils nŌĆÖob├®issent quŌĆÖ├Ā eux-m├¬mes, non-libres dans la mesure o├╣ ils se soumettent. Qui de nous peut pr├®tendre ├¬tre libre en toutes ses actions ? Nul sans doute, mais en chacun de nous habite lŌĆÖentit├® profonde en qui parle la voix de lŌĆÖhomme libre.
Notre vie se compose dŌĆÖactions libres et dŌĆÖactions non libres. Mais il est impossible dŌĆÖavoir un concept de lŌĆÖ├¬tre humain tant quŌĆÖon ne pose pas la libert├® de lŌĆÖesprit comme le degr├® supr├¬me de son ├®panouissement. Nous ne sommes v├®ritablement des hommes que dans la mesure o├╣ nous sommes libres.
Sans doute, ce nŌĆÖest l├Ā quŌĆÖun id├®al, mais un id├®al qui travaille en toute r├®alit├® dans la profondeur de notre ├¬tre. Non point un id├®al dŌĆÖimagination ou de r├¬ve, mais un id├®al dou├® de vie, qui se fait conna├«tre avec pr├®cision malgr├® la forme encore imparfaite de son d├®veloppement. Si lŌĆÖhomme nŌĆÖ├®tait quŌĆÖune cr├®ature naturelle, la recherche des id├®als, cŌĆÖest-├Ā-dire dŌĆÖid├®es momentan├®ment inefficaces, dont on esp├©re la r├®alisation, serait une absurdit├®. Pour les choses de la nature, en effet, lŌĆÖid├®e est d├®termin├®e par la perception ; nous avons tout fait lorsque nous avons reconnu le lien de lŌĆÖid├®e ├Ā la perception. Mais, pour lŌĆÖhomme, ce nŌĆÖest plus le cas. La somme de son existence nŌĆÖest pas d├®termin├®e sans sa propre participation, son v├®ritable concept dŌĆÖhomme moral (esprit libre) nŌĆÖest pas uni de prime abord et objectivement ├Ā lŌĆÖimage de perception ┬½homme┬╗, de mani├©re ├Ā ├¬tre connu ensuite par la pens├®e. LŌĆÖhomme doit unir lui-m├¬me, et de son propre pouvoir, son propre concept ├Ā la perception ┬½homme┬╗. Le concept et la perception, ici, ne se recouvrent plus que si lŌĆÖhomme les am├©ne ├Ā se recouvrir. Et il ne le peut que sŌĆÖil a trouv├® le concept dŌĆÖesprit libre qui est son propre concept. Autrement dit : dans le monde objectif, une fronti├©re nous est trac├®e entre la perception et le concept notre connaissance triomphe de cette fronti├©re. Dans la nature subjective de lŌĆÖhomme, la m├¬me fronti├©re existe. LŌĆÖhomme en triomphe seulement au cours de son ├®volution, lorsquŌĆÖil arrive ├Ā faire de son ├¬tre apparent lŌĆÖexpression parfaite de son concept. Ainsi, la vie morale de lŌĆÖhomme, tout comme sa vie intellectuelle, nous oblige ├Ā constater sa double nature : percevante (exp├®rience directe) et pensante. La vie intellectuelle unifie cette double nature par la connaissance ; la vie morale, par la r├®alisation de lŌĆÖesprit libre. Tout ├¬tre, hormis lŌĆÖhomme, a son concept inn├® (la loi de son existence et de son activit├®) ; dans le monde ext├®rieur, il est indissolublement uni ├Ā la perception de cet ├¬tre ; il nŌĆÖen est s├®par├® quŌĆÖ├Ā lŌĆÖint├®rieur de notre organisme spirituel. Mais, chez lŌĆÖhomme, le concept et la perception sont s├®par├®s en fait, pour ├¬tre ensuite r├®unis en fait par lŌĆÖhomme. Certes, ├Ā notre perception de lŌĆÖhomme correspond, ├Ā chaque instant de sa vie, un concept aussi pr├®cis quŌĆÖ├Ā la perception de tout autre ├¬tre. On peut se former le concept de lŌĆÖhomme-esp├©ce et on peut ├®galement le trouver dans le monde des perceptions. Si on y ajoute celui de lŌĆÖesprit libre, dira-t-on quŌĆÖon a deux concepts pour le m├¬me objet ?
Ce serait une faute de raisonnement. Moi, objet de perception, je suis soumis ├Ā un perp├®tuel changement. Je suis autre dans mon enfance que dans mon adolescence ou mon ├óge m├╗r. Bien plus, ├Ā chaque instant, lŌĆÖimage de perception que je fournis est diff├®rente. Ces changements peuvent se succ├®der de mani├©re ├Ā exprimer toujours le m├¬me homme-esp├©ce, ou de mani├©re ├Ā pr├®senter lŌĆÖexpression de lŌĆÖesprit libre. LŌĆÖobjet de perception que fournit mon activit├® est soumis ├Ā ces m├¬mes changements.
LŌĆÖobjet de perceptions ┬½homme┬╗ a la facult├® de se m├®tamorphoser, comme la graine de la plante a la facult├® de se d├®velopper en plante compl├©te. La plante se d├®veloppera selon les lois objectives contenues en elle ; lŌĆÖhomme, par contre, demeurera dans son ├®tat imparfait sŌĆÖil ne sŌĆÖempare pas en lui-m├¬me de la mati├©re ├Ā transformer, et ne la m├®tamorphose par sa propre force. La Nature fait seulement de lŌĆÖhomme une cr├®ature naturelle ; la soci├®t├® ne fait de lui quŌĆÖun ex├®cuteur de ses lois ; lui seul peut se transformer en ├¬tre libre. ├Ć un certain degr├® dŌĆÖ├®volution, la Nature le laisse ├®chapper de ses cha├«nes ; la soci├®t├® m├©ne cette ├®volution plus loin ; lŌĆÖhomme seul peut la parachever.
La morale de la libert├® nŌĆÖimplique donc pas que lŌĆÖesprit libre soit la seule forme sous laquelle lŌĆÖhomme puisse exister. Elle voit seulement dans la libert├® spirituelle le dernier degr├® de lŌĆÖ├®volution humaine. Ceci nŌĆÖemp├¬che pas quŌĆÖ├Ā une certaine ├®tape de cette ├®volution, lŌĆÖaction, selon des normes ait sa raison dŌĆÖ├¬tre. Mais elle ne saurait ├¬tre reconnue comme un point de vue moral absolu. LŌĆÖesprit libre triomphe des normes en ce sens que, non content de trouver ses motifs dans des commandements, il organise son action dŌĆÖapr├©s ses impulsions spirituelles (intuition).
Lorsque Kant sŌĆÖ├®crie : ┬½Devoir ! nom sublime qui ne supporte pas le plaisir ni la flatterie, mais r├®clame les soumissions┬╗... ┬½loi qui impose une loi..., devant laquelle toutes les inclinations se taisent, m├¬me alors quŌĆÖelles la combattent secr├©tement┬╗, - lŌĆÖhomme lui r├®pond, de par la conscience de son libre esprit : ┬½Libert├® ! nom amical, nom humain, qui contiens en toi tout mon plaisir moral tout ce quŌĆÖhonore le plus mon humanit├®, et ne me fais serviteur de personne, et ne mŌĆÖimposes pas simplement un ordre, mais attends ce que mon amour moral reconna├«tra lui-m├¬me pour son ordre, parce quŌĆÖil se sentirait esclave en regard de toute loi impos├®e┬╗.
Tel est le contraste entre la morale de lŌĆÖautorit├® et la morale de la libert├®.
Le ┬½philistin┬╗, qui voit la morale fix├®e une fois pour toutes dans un ordre ext├®rieurement ├®tabli, trouvera peut-├¬tre que lŌĆÖesprit libre est un homme dangereux. Ceci, parce que son regard born├® ne franchit point les limites de son ├®poque. SŌĆÖil consid├®rait la chose de plus loin, il sŌĆÖapercevrait que lŌĆÖesprit libre nŌĆÖa pas plus souvent besoin dŌĆÖenfreindre les lois de son pays que le philistin lui-m├¬me, et que jamais il ne se trouve en v├®ritable confit avec elles. Car les lois des ├ētats sont inspir├®es enti├©rement par les intuitions dŌĆÖesprits libres ; de m├¬me pour toutes les lois objectives de moralit├®. Il nŌĆÖest pas, dans lŌĆÖordre de lŌĆÖautorit├® familiale, de commandement qui nŌĆÖait ├®t├® con├¦u, au d├®but, par quelque anc├¬tre, de mani├©re intuitive, et ├®tabli comme tel ; les conventions morales elles-m├¬mes ont ├®t├®, au d├®but, fix├®es par des hommes, et les lois des ├ētats naissent tout dŌĆÖabord dans la t├¬te des hommes dŌĆÖ├ētat. Ces esprits ont impos├® leurs lois aux autres humains, et ceux-ci ne sont esclaves que lorsque, oubliant cette origine humaine des lois, ils voient en elles soit une r├®v├®lation divine, soit des concepts objectifs et imp├®ratifs ind├®pendants de lŌĆÖhomme, soit encore lŌĆÖentit├® faussement mystique dŌĆÖune voix ┬½int├®rieure┬╗ dou├®e dŌĆÖinfrangible autorit├®. Par contre, celui qui conna├«t lŌĆÖorigine humaine des lois, honorera en elles des productions de ce monde spirituel auquel il puise lui-m├¬me ses intuitions morales. SŌĆÖil pense que ses propres intuitions sont meilleures, il essayera de les mettre ├Ā la place de celles qui r├©gnent actuellement ; mais sŌĆÖil trouve ces derni├©res l├®gitimes, il agira dŌĆÖapr├©s elles, tout comme si elles provenaient de lui.
Nous ne saurions admettre la formule dŌĆÖapr├©s laquelle lŌĆÖhomme est mis au monde pour r├®aliser un certain ordre moral universel, con├¦u en dehors de lui. Cette formule est du m├¬me ressort, en ce qui concerne la science de lŌĆÖhomme, que la formule ancienne des naturalistes qui disaient : le taureau a des cornes pour pouvoir se d├®fendre. La science moderne a heureusement fait justice de ces croyances finalistes. LŌĆÖ├®thique a plus de mal ├Ā sŌĆÖen d├®barrasser. Et cependant, si le taureau nŌĆÖa point de cornes pour se d├®fendre, mais se d├®fend gr├óce ├Ā ses cornes, de m├¬me lŌĆÖhomme nŌĆÖest pas fait pour la moralit├®, mais la moralit├® appara├«t gr├óce ├Ā lŌĆÖhomme. LŌĆÖhomme libre agit moralement parce quŌĆÖil a une id├®e morale et non point pour que la moralit├® existe. Les individus humains, avec leur facult├® intuitive, sont les premi├©res conditions de lŌĆÖordre moral universel.
LŌĆÖindividu humain est la source de toute moralit├®, et le centre de toute vie terrestre. Les ├ētats, les soci├®t├®s, ne sont que les r├®sultats n├®cessaires de la vie individuelle. Certes, les ├ētats et les soci├®t├®s r├®agissent ensuite sur la vie individuelle, comme lŌĆÖacte de se d├®fendre r├®agit sur lŌĆÖ├®volution des cornes du taureau, quŌĆÖil favorise, tandis que lŌĆÖinaction les atrophierait. LŌĆÖindividu, lui aussi, sŌĆÖatrophierait sŌĆÖil menait sa vie isol├®ment, hors de toutes collectivit├®s humaines. LŌĆÖordre social se forme pr├®cis├®ment avec le but de r├®agir, dŌĆÖune fa├¦on aussi heureuse que possible, sur les individus.
10. La philosophie de la libert├® et le monisme
LŌĆÖhomme peu ├®volu├®, qui ne croit ├Ā la r├®alit├® des choses que sŌĆÖil peut les voir et les toucher, r├®clame ├®galement pour sa vie morale des motifs de vouloir qui lui soient perceptibles. Il lui faut un ├¬tre qui lui fasse comprendre ces motifs dŌĆÖune mani├©re accessible ├Ā ses sens. Il se les laisse dicter, sous forme de commandements, par celui quŌĆÖil estime ├¬tre plus sage et plus puissant que lui, ou auquel il attribue, pour une raison quelconque, un pouvoir sup├®rieur au sien. CŌĆÖest de cette mani├©re que se sont form├®s tous les principes moraux, d├®j├Ā nomm├®s, dŌĆÖautorit├® familiale, gouvernementale, sociale, eccl├®siastique ou divine. LŌĆÖhomme le plus primitif a toujours quelque foi en un autre homme ; celui qui est un peu plus ├®volu├® se laisse ordonner sa conduite morale par une communaut├® (├ētat, Soci├®t├®). Ce sont toujours des pouvoirs perceptibles sur lesquels on se fonde. Celui qui commence ├Ā sŌĆÖ├®clairer, se disant que sa foi repose sur des hommes aussi faibles que lui, cherche alors un secours aupr├©s dŌĆÖune puissance surhumaine, aupr├©s dŌĆÖun Dieu quŌĆÖil pourvoit dŌĆÖattributs perceptibles. De cet ├¬tre, il re├¦oit les concepts propres ├Ā remplir sa vie morale, et il les re├¦oit toujours encore sous forme perceptible, soit que Dieu apparaisse dans le buisson ardent, soit quŌĆÖil vienne parmi les hommes sous une forme corporelle, et leur fasse entendre ce quŌĆÖils doivent faire ou ne pas faire.
Le degr├® sup├®rieur de ce r├®alisme primitif, en ce qui concerne la vie morale, cŌĆÖest celui que nous d├®finirons comme suit le commandement (id├®e morale) est con├¦u sans rapport avec aucune entit├® ext├®rieure, et lŌĆÖhomme suppose quŌĆÖil provient de lui-m├¬me, que cŌĆÖest une force absolue qui surgit de lui.
Tandis quŌĆÖil entendait jadis la voix ext├®rieure de Dieu, il per├¦oit ├Ā pr├®sent le pouvoir ind├®pendant de sa propre vie int├®rieure ; cette voix int├®rieure, lŌĆÖhomme la nomme ┬½conscience┬╗.
├Ć ce degr├®, on sŌĆÖ├®l├©ve d├®j├Ā au-dessus du r├®alisme primitif ; les lois morales deviennent des normes dou├®es dŌĆÖexistence ind├®pendante. NŌĆÖayant plus de porteur, elles sŌĆÖ├®rigent en entit├®s m├®taphysiques. Elles deviennent analogues aux forces visibles-invisibles du r├®alisme m├®taphysique, qui ne cherche pas la r├®alit├® l├Ā o├╣ la pens├®e de lŌĆÖhomme y participe vraiment, mais la situe hypoth├®tiquement en dehors de lŌĆÖexp├®rience. Ce r├®alisme m├®taphysique sŌĆÖaccompagne toujours de normes morales extra-humaines. Il cherche naturellement lŌĆÖorigine de la moralit├® dans le domaine de la r├®alit├® extra-humaine quŌĆÖil a suppos├®e. L├Ā, plusieurs possibilit├®s lui sont offertes. Si lŌĆÖentit├® suppos├®e est con├¦ue comme une puissance m├®canique priv├®e de pens├®e, - et cŌĆÖest le cas dans la conception mat├®rialiste, - alors lŌĆÖindividu humain lŌĆÖengendre par une n├®cessit├® ├®galement m├®canique. La conscience de la libert├® ne peut ├¬tre alors quŌĆÖillusoire. Car, tandis que je me crois cr├®ateur de mon action, cŌĆÖest la mati├©re qui agit en moi selon ses lois complexes. Je me crois libre, mais toutes mes actions sont les r├®sultats des ph├®nom├©nes mat├®riels qui constituent mon organisme physique et spirituel. Le sentiment de la libert├® nŌĆÖexiste, au regard du mat├®rialisme [nota: Au sujet de nos attaques contre le mat├®rialisme, et de ce que nous entendons par ces mots, voir la note ├Ā la fin de ce chapitre (1918)], que parce que nous ignorons les motifs qui nous contraignent : ┬½Remarquons bien que notre sentiment de libert├® repose sur lŌĆÖabsence des motifs ext├®rieurs qui nous contraignent┬╗. ┬½Notre action est n├®cessit├®e comme notre pens├®e┬╗. [voir: "Leitfaden der physiologischen Psychologie" par Ziehen, p. 207].
Une autre possibilit├® qui sŌĆÖoffre au partisan du r├®alisme m├®taphysique, cŌĆÖest de concevoir comme un ├¬tre spirituel cette r├®alit├® absolue, cach├®e derri├©re les apparences. Alors, cŌĆÖest dans cette force spirituelle quŌĆÖil croit puiser ses impulsions actives.
Il consid├©re les principes moraux que fournit la raison humaine comme des inspirations dues ├Ā cet ├¬tre, qui a sur lŌĆÖhomme des intentions pr├®cises. Pour ce dualisme-l├Ā, les lois morales sont dict├®es par lŌĆÖ├¬tre absolu. La raison humaine nŌĆÖa quŌĆÖ├Ā ├®tudier et r├®aliser ses desseins. LŌĆÖordre moral du monde nŌĆÖest que le reflet perceptible dŌĆÖun ordre sup├®rieur cach├®. La moralit├® terrestre est la manifestation de lŌĆÖordre universel extra-humain. Elle ne d├®pend pas de lŌĆÖhomme, mais de lŌĆÖ├¬tre en soi, de lŌĆÖ├¬tre extra-humain. LŌĆÖhomme doit ce que cet ├¬tre veut. Pour ├ēdouard von Hartmann, lŌĆÖ├¬tre en soi est une divinit├®, pour qui sa propre existence est douleur ; cette divinit├® aurait cr├®├® le monde pour se lib├®rer de sa douleur infinie. Ce philosophe envisage donc lŌĆÖ├®volution morale de lŌĆÖhomme comme un ph├®nom├©ne de r├®demption de la divinit├®. ┬½Le processus universel ne sera men├® vers sa fin que si les individus raisonnables et conscients dŌĆÖeux-m├¬mes construisent un ordre moral universel┬╗. ┬½La r├®alit├® est lŌĆÖincarnation de la divinit├®, lŌĆÖhistoire du monde est la passion du Dieu fait chair, et elle est, en m├¬me temps, la voie de r├®demption de ce Dieu crucifi├® dans la chair. Or, par la moralit├®, lŌĆÖhomme concourt ├Ā abr├®ger ce calvaire et cette r├®demption┬╗. [voir: "Ph├®nom├®nologie de la conscience morale" par Hartmann] Donc, pour ce philosophe, lŌĆÖhomme nŌĆÖagit pas parce quŌĆÖil veut, mais parce quŌĆÖil doit, parce que Dieu veut ├¬tre lib├®r├®. Si le mat├®rialisme fait de lŌĆÖhomme un automate ob├®issant ├Ā des lois purement m├®caniques, le dualisme spiritualiste (celui qui place lŌĆÖ├¬tre en soi, lŌĆÖabsolu, dans un domaine spirituel, dont lŌĆÖhomme ne saurait avoir aucune exp├®rience consciente), en fait un esclave de la volont├® de lŌĆÖAbsolu.
La libert├® est aussi impossible dans un syst├©me que dans lŌĆÖautre, parce que tous deux transposent la r├®alit├® v├®ritable en un domaine extra-humain, inaccessible ├Ā lŌĆÖexp├®rience.
Donc, le r├®alisme primitif et les r├®alismes m├®taphysiques arrivent ├®galement ├Ā nier la libert├®, ├Ā voir dans lŌĆÖhomme lŌĆÖex├®cuteur de principes n├®cessairement impos├®s. Le r├®alisme primitif tue la libert├® en ├®tablissant le joug de quelque autorit├® perceptible, ou dŌĆÖun ├¬tre imagin├® par analogie avec des choses perceptibles, ou, enfin, de la voix int├®rieure abstraite quŌĆÖil nomme ┬½conscience┬╗ ; les m├®taphysiciens de lŌĆÖ┬½├¬tre en soi┬╗ ne peuvent, eux non plus, accorder la libert├® ├Ā lŌĆÖhomme ; ils le laissent d├®terminer par un absolu m├®canique ou moral.
Le Monisme se voit oblig├® de donner raison, jusquŌĆÖ├Ā un certain point, au r├®alisme primitif, car il reconna├«t la valeur de la perception. Tant que lŌĆÖhomme est incapable de produire par intuition des id├®es morales, il lui faut en recevoir dŌĆÖautre part. Dans la mesure o├╣ il les re├¦oit des autres, il est d├®pourvu de libert├®. Mais le monisme accorde ├Ā lŌĆÖId├®e autant de valeur quŌĆÖ├Ā la perception. LŌĆÖId├®e peut appara├«tre au sein de lŌĆÖindividualit├® humaine et, dans la mesure o├╣ lŌĆÖhomme en re├¦oit lŌĆÖimpulsion, il est libre. Mais le monisme rejette toute la m├®taphysique simplement syllogistique et, par cons├®quent, il rejette aussi les impulsions soi-disant issues de lŌĆÖ┬½├¬tre en soi┬╗. LŌĆÖhomme ne peut, dŌĆÖapr├©s le monisme, quŌĆÖagir non-librement, sŌĆÖil ob├®it ├Ā un joug ext├®rieur et perceptible, ou quŌĆÖagir librement, sŌĆÖil nŌĆÖob├®it quŌĆÖ├Ā lui-m├¬me. Le monisme nŌĆÖadmet aucune obligation inconsciente, cach├®e derri├©re la perception et le concept. LorsquŌĆÖon d├®cr├©te quŌĆÖune action nŌĆÖest pas libre, cŌĆÖest que lŌĆÖon peut trouver au sein du monde perceptible la chose, ou lŌĆÖhomme, ou lŌĆÖinstitution, qui lŌĆÖont d├®cid├®e. Si lŌĆÖon pr├®tend que la cause en r├®side au del├Ā du monde sensible r├®el, ou du monde spirituel r├®el, le monisme refuse simplement dŌĆÖaccepter cette affirmation.
DŌĆÖapr├©s le monisme, lŌĆÖhomme agit en partie librement, en partie non librement. Esclave dans le monde des perceptions, il r├®alise en lui-m├¬me le libre esprit.
Les commandements moraux, dans lesquels la m├®taphysique aper├¦oit les inspirations dŌĆÖun ├¬tre sup├®rieur, ne sont pour le monisme que des pens├®es de lŌĆÖhomme ; lŌĆÖordre moral du monde nŌĆÖest ├Ā ses yeux ni le d├®calque dŌĆÖun ordre naturel purement m├®canique, ni celui dŌĆÖun ordre sup├®rieur extra-humain ; il est une oeuvre absolument libre de lŌĆÖhomme. LŌĆÖhomme nŌĆÖa pas ├Ā accomplir les volont├®s dŌĆÖun ├¬tre cosmique ext├®rieur ├Ā lui-m├¬me, mais ses propres volont├®s. Derri├©re lŌĆÖaction humaine, le monisme ne croit pas voir une direction universelle ├®trang├©re aux hommes, qui les d├®terminerait selon ses fins cach├®es ; les hommes, lorsquŌĆÖils r├®alisent leurs id├®es intuitives, ne tendent quŌĆÖ├Ā leurs propres fins humaines. Bien plus, chaque individu ne tend quŌĆÖ├Ā ses fins particuli├©res. Car le monde des id├®es ne se manifeste pas dans une collectivit├® humaine, mais seulement dans des individus. Si les collectivit├®s ont des fins g├®n├®rales, ce ne sont que les sommes des actes volontaires des individus, et g├®n├®ralement de quelques individus dŌĆÖ├®lite, auxquels les autres reconnaissent de lŌĆÖautorit├®. Mais chaque ├¬tre humain est appel├® ├Ā devenir esprit libre, comme chaque bouton de rose est appel├® ├Ā devenir rose.
Le monisme est donc, sur le terrain de lŌĆÖaction morale, une philosophie de la libert├®. ├ētant une philosophie du r├®el, il rejette les limites irr├®elles que la m├®taphysique voudrait imposer ├Ā la libert├® de lŌĆÖesprit, mais il sait reconna├«tre les limites physiques et historiques qui bornent la libert├® de lŌĆÖhomme peu ├®volu├®. LŌĆÖhomme nŌĆÖest pas, ├Ā ses yeux, un produit complet ├®panouissant ├Ā chaque instant de sa vie la pl├®nitude de ses possibilit├®s ; et cŌĆÖest pourquoi il lui semble absurde de discuter si lŌĆÖhomme, en soi, est libre ou non ; mais, connaissant que lŌĆÖentit├® humaine ├®volue sans cesse, il se demande seulement si cette ├®volution la m├©ne, oui ou non, ├Ā r├®aliser lŌĆÖ├®tat dŌĆÖesprit libre.
Le monisme sait que la Nature nŌĆÖenfante pas un ├¬tre humain achev├® et d├®j├Ā libre, mais quelle le laisse, au contraire, ├Ā un certain degr├® dŌĆÖ├®volution de l├Ā, sans ├¬tre libre encore, il continue ├Ā se d├®velopper jusquŌĆÖ├Ā ce quŌĆÖil arrive ├Ā se trouver lui-m├¬me.
Le monisme estime quŌĆÖun ├¬tre agissant sous lŌĆÖempire dŌĆÖune obligation physique ou psychique ne peut pas ├¬tre r├®ellement moral. Il consid├©re le passage par lŌĆÖaction automatique (selon les d├®sirs et instincts naturels) et par lŌĆÖaction dŌĆÖob├®issance (dŌĆÖapr├©s des normes morales) comme des ├®tapes pr├®paratoires indispensables ├Ā la moralit├®. Mais il sait quŌĆÖil est possible de les d├®passer par lŌĆÖ├®closion de lŌĆÖesprit libre. DŌĆÖune fa├¦on g├®n├®rale, le monisme lib├©re la morale des maximes terrestres du r├®alisme primitif, et des maximes de la m├®taphysique sp├®culative. Il ne saurait bannir les premi├©res, car ce serait bannir la perception ; mais il peut supprimer les secondes, car cŌĆÖest dans le monde lui-m├¬me quŌĆÖil pr├®tend trouver lŌĆÖexplication de tous ses ph├®nom├©nes, et non en dehors du monde. Il ne veut dŌĆÖautres principes de connaissance que ceux de cette sorte, ni dŌĆÖautres principes de morale. Comme la connaissance humaine, la moralit├® humaine nŌĆÖest conditionn├®e que par la nature de lŌĆÖhomme. Et de m├¬me que des ├¬tres diff├®rents de nous peuvent entendre par ┬½connaissance┬╗ une toute autre chose, ils peuvent ├®galement avoir une toute autre moralit├®. Pour le monisme, la moralit├® est une qualit├® sp├®cifique de lŌĆÖhomme, et la libert├® est la forme sous laquelle lŌĆÖhomme atteint ├Ā cette moralit├®.
PREMIER APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
Dans le jugement que lŌĆÖon portera sur les deux pr├®c├®dents chapitres, il pourrait surgir quelque difficult├® du fait que lŌĆÖon croira se trouver en face dŌĆÖune contradiction. DŌĆÖune part, nous parlons de lŌĆÖexp├®rience que nous faisons de la pens├®e, comme dŌĆÖune chose absolument g├®n├®rale et de m├¬me valeur pour chaque conscience humaine. DŌĆÖautre part, nous signalons que les id├®es que r├®alise la vie morale, et qui sont de m├¬me sorte que celles quŌĆÖ├®labore la pens├®e ordinaire, se manifestent en chacun de nous dŌĆÖune mani├©re individuelle. On nŌĆÖarrivera jamais ├Ā comprendre la nature de la connaissance, ni de la libert├®, si, devant ce double ordre de faits, on sŌĆÖobstine ├Ā parler de contradiction, sans se rendre compte que ce contraste est donn├® en fait, et que sa compr├®hension vivante est justement propre ├Ā nous r├®v├®ler en partie lŌĆÖ├¬tre v├®ritable de lŌĆÖhomme. Certes, la pens├®e que nous avons d├®velopp├®e ici demeure une ┬½pure contradiction┬╗ pour ceux qui croient les concepts simplement extraits (abstraits) du monde ext├®rieur, et qui refusent de mettre lŌĆÖintuition dans ses droits. Mais ceux qui p├®n├©trent lŌĆÖorigine intuitive, des id├®es et leur ind├®pendance absolue de substance, savent aussi que, dans lŌĆÖacte de connaissance, lŌĆÖhomme prend part ├Ā une unit├® spirituelle qui est la m├¬me pour tous ses semblables, tandis que, lorsquŌĆÖil emprunte ├Ā ce monde spirituel les intuitions n├®cessaires aux actes de sa volont├®, il en individualise une parcelle ; et ceci par la m├¬me activit├® qui, tout ├Ā lŌĆÖheure, lui permettait une participation toute collective ├Ā la r├®alit├® spirituelle de la connaissance.
Cette contradiction logique apparente, entre la g├®n├®ralit├® des id├®es de connaissance et lŌĆÖindividualit├® des id├®es morales, devient pr├®cis├®ment un concept vivant d├©s quŌĆÖon le saisit dans sa pleine v├®rit├®. La caract├®ristique de lŌĆÖentit├® humaine est justement cette oscillation de la r├®alit├® intuitive, qui tant├┤t se manifeste en lui sous la forme g├®n├®rale de la connaissance, et tant├┤t sous une forme individualis├®e. LorsquŌĆÖon n├®glige de saisir la r├®alit├® de la premi├©re de ces formes, on ne voit dans la pens├®e quŌĆÖune occupation subjective de lŌĆÖhomme. LorsquŌĆÖon n├®glige, au contraire, la seconde forme, toute vie individuelle semble retir├®e ├Ā la pens├®e humaine. Le penseur se trouve impuissant ├Ā percer, dans le premier, cas, le myst├©re de la connaissance, et, dans le second cas, le myst├©re de la vie morale. Il cherche ├Ā sŌĆÖexpliquer lŌĆÖune ou lŌĆÖautre gr├óce ├Ā toutes sortes de repr├®sentations qui nŌĆÖy peuvent suffire ; ou lŌĆÖexp├®rience r├®elle de la pens├®e lui ├®chappe, ou il la m├®conna├«t en la confondant avec un simple processus dŌĆÖabstraction.
DEUXI├łME APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
Nous parlons [voir: chapitre "10. La philosophie de la libert├® et le monisme"] du mat├®rialisme. Nous savons fort bien que nombre de penseurs, et entre autres le philosophe cit├®, Th. Ziehen, ne se d├®signent absolument pas sous le nom de mat├®rialistes, et doivent, cependant, du point de vue de ce livre, ├¬tre consid├®r├®s comme tels. Il importe peu que quelquŌĆÖun nous dise : ┬½pour moi, ce monde ne se borne pas ├Ā lŌĆÖexistence mat├®rielle ; donc je ne suis pas mat├®rialiste┬╗. Mais il nous importe que ce quelquŌĆÖun expose des conceptions qui ne peuvent sŌĆÖappliquer quŌĆÖ├Ā une existence mat├®rielle. Celui qui ├®nonce : ┬½Notre action est n├®cessit├®e comme notre pens├®e┬╗, formule une conception qui sŌĆÖapplique ├Ā des ph├®nom├©nes mat├®riels, mais ne convient ni ├Ā lŌĆÖaction, ni ├Ā la pens├®e ; et il devrait, sŌĆÖil allait jusquŌĆÖau bout de son id├®e, ├¬tre mat├®rialiste. SŌĆÖil ne lŌĆÖest pas, cela provient de cette incons├®quence qui, si souvent, r├®sulte dŌĆÖune pens├®e arr├¬t├®e en chemin. On entend souvent dire que le mat├®rialisme du XIXe si├©cle est scientifiquement mort. En r├®alit├®, il ne lŌĆÖest pas du tout. Seulement, ├Ā lŌĆÖheure actuelle, nous ne remarquons pas toujours que nous avons des id├®es avec lesquelles on ne saurait aborder que la vie mat├®rielle. Le mat├®rialisme, qui se montrait ouvertement durant la seconde moiti├® du XIXe si├©cle, se d├®guise aujourdŌĆÖhui sous cette forme. Et ce mat├®rialisme d├®guis├® nŌĆÖest pas moins intol├®rant que lŌĆÖautre ├Ā lŌĆÖ├®gard des conceptions r├®ellement spirituelles. Beaucoup sŌĆÖy laissent tromper, et croient devoir refuser une conception vraiment spirituelle du monde, sous le pr├®texte que la science moderne a depuis longtemps abandonn├® le mat├®rialisme┬╗.
11. La finalit├® dans lŌĆÖunivers et dans lŌĆÖhomme
(d├®termination de lŌĆÖhomme)
Parmi les courants multiples qui traversent la vie spirituelle de lŌĆÖhumanit├®, on peut remarquer un effort persistant pour bannir le concept de finalit├® des domaines auxquels on lŌĆÖavait ill├®gitimement ├®tendu. La finalit├® est une certaine mani├©re dŌĆÖencha├«ner les ph├®nom├©nes. Contrairement ├Ā ce qui a lieu dans le rapport de causalit├®, o├╣ un premier ph├®nom├©ne en d├®termine un second, cŌĆÖest ici le second ph├®nom├©ne qui agit sur celui qui lŌĆÖa pr├®c├®d├®. Ce rapport de finalit├® nŌĆÖexiste, ├Ā premi├©re vue, que dans les actions humaines. LŌĆÖhomme accomplit une action quŌĆÖauparavant il se repr├®sente, et cŌĆÖest cette repr├®sentation qui le d├®termine ├Ā agir. Le second ph├®nom├©ne, lŌĆÖaction, influence le premier ph├®nom├©ne, lŌĆÖhomme, par lŌĆÖinterm├®diaire de la repr├®sentation. Cet interm├®diaire de la repr├®sentation est in├®vitable pour que le rapport de finalit├® existe.
Dans le processus que lŌĆÖon subdivise en cause et effet, il faut distinguer, comme toujours, le facteur ┬½perception┬╗ et le facteur ┬½concept┬╗. La perception de la cause pr├®c├©de la perception de lŌĆÖeffet ; cause et effet demeureraient simplement juxtapos├®s dans notre conscience, si nous ne pouvions pas les unir gr├óce aux concepts qui leur conviennent. La perception de lŌĆÖeffet ne peut et ne pourra jamais que suivre la perception de la cause. Si lŌĆÖeffet doit avoir une influence r├®elle sur la cause, ce ne pourra jamais ├¬tre que gr├óce au facteur conceptuel. Car le facteur ┬½perception┬╗ de lŌĆÖeffet nŌĆÖexiste aucunement avant celui de la cause. Celui qui pr├®tend que la fleur est le but de la racine, cŌĆÖest-├Ā-dire que la fleur a une influence sur la racine, ne peut ├®mettre cette affirmation quŌĆÖen ce qui concerne ce que sa pens├®e a saisi de la fleur. Car, ├Ā lŌĆÖ├®poque o├╣ se forme la racine, le facteur ┬½perception┬╗ de la fleur nŌĆÖexiste pas encore. Mais pour quŌĆÖil y ait finalit├®, il ne faut pas seulement quŌĆÖil existe un rapport id├®el r├®gulier entre le fait post├®rieur et le fait ant├®rieur, mais encore il faut que le concept, la loi de lŌĆÖeffet, influence r├®ellement la cause, et que ce processus dŌĆÖinfluence soit perceptible. Or, lŌĆÖinfluence perceptible dŌĆÖun concept sur quelque chose dŌĆÖautre, voil├Ā qui nŌĆÖexiste que dans lŌĆÖaction humaine. LŌĆÖid├®e de finalit├® sŌĆÖy applique donc exclusivement. LŌĆÖhomme peu ├®volu├®, qui ne croit quŌĆÖ├Ā la perception, cherche toujours du perceptible l├Ā o├╣ il nŌĆÖexiste que de lŌĆÖid├®el. Dans les faits perceptibles, il cherche des relations perceptibles, et lorsquŌĆÖil ne les trouve pas, il les imagine. La finalit├®, telle quŌĆÖelle se manifeste dans lŌĆÖaction subjective de lŌĆÖhomme, est un ├®l├®ment particuli├©rement apte ├Ā fournir de ces relations imaginaires. LŌĆÖhomme simple sait quŌĆÖil provoque les ph├®nom├©nes, et il en conclut que la nature doit faire comme lui. Dans les relations purement id├®elles qui sont ├Ā la base de la nature, il voit, non seulement des forces invisibles, mais encore des fins r├®elles non perceptibles. LŌĆÖhomme sait se fabriquer des instruments ├Ā telle ou telle fin, et il croit, dans sa na├»vet├®, que le cr├®ateur construit des organismes selon la m├¬me m├®thode. Cette fausse conception de la finalit├® dispara├«t peu ├Ā peu de la science, mais, dans la philosophie, elle jette encore le plus grand trouble. ├Ć chaque instant, on y pose des questions telles que celle du but supranaturel du monde, de la mission ou de la d├®termination supra-humaine de lŌĆÖhomme, etc.
Le monisme rejette la conception finaliste de tous les domaines ├Ā lŌĆÖexception de la seule action humaine. Il cherche des lois naturelles, mais non point des fins naturelles. Les fins naturelles sont des hypoth├©ses injustifiables, comme le sont les forces non perceptibles [voir: chapitre "7. Y a-t-il des limites ├Ā la connaissance ?" - rechercher "Les forces non perceptibles agissant au sein"], et comme le sont ├®galement, du point de vue moniste, toutes les fins humaines que lŌĆÖhomme ne sŌĆÖest pas propos├®es lui-m├¬me. Les choses ne peuvent ├¬tre vou├®es ├Ā un but que si lŌĆÖhomme les fait telles, car cŌĆÖest seulement la r├®alisation dŌĆÖune id├®e qui peut leur donner ce caract├©re de finalit├®. Or, lŌĆÖid├®e nŌĆÖest active, au sens r├®aliste de ce mot, que dans lŌĆÖhomme. CŌĆÖest pourquoi la vie humaine nŌĆÖa dŌĆÖautre fin, dŌĆÖautre d├®termination, que celles que lŌĆÖhomme lui donne. LorsquŌĆÖon demande quelle t├óche lŌĆÖhomme doit-il accomplir ? le monisme r├®pond : celle quŌĆÖil se propose ├Ā lui-m├¬me. La mission que jŌĆÖai en ce monde nŌĆÖest pas d├®termin├®e dŌĆÖavance, elle est, ├Ā chaque instant, celle que je me choisis. Je nŌĆÖentre pas dans la vie avec un itin├®raire trac├® dŌĆÖavance.
Lorsque des id├®es deviennent des buts, et se r├®alisent, ce ne peut ├¬tre que par lŌĆÖhomme. Il est donc injuste de parler de la r├®alisation dŌĆÖid├®es ├Ā travers lŌĆÖhistoire. Toutes les formules telles que : ┬½LŌĆÖhistoire est lŌĆÖ├®volution de lŌĆÖhomme vers la libert├®┬╗, ou ┬½la r├®alisation dŌĆÖun ordre moral sup├®rieur┬╗, etc., ne peuvent se d├®fendre au regard du monisme.
Les partisans de la doctrine finaliste croient expliquer, par son secours, toute lŌĆÖordonnance et lŌĆÖharmonie de lŌĆÖunivers. QuŌĆÖon entende, par exemple, Robert Hamerling [voir: "Atomistique de la volont├®" par Robert Hamerling, volume II] : ┬½Aussi longtemps quŌĆÖil y aura des app├®tits dans la nature, ce sera une absurdit├® que dŌĆÖy nier lŌĆÖexistence de buts. La conformation dŌĆÖun membre du corps humain nŌĆÖest pas d├®termin├®e, ni conditionn├®e, par une ┬½id├®e┬╗ flottant en lŌĆÖair, mais par le rapport de ce membre ├Ā lŌĆÖensemble plus grand auquel il appartient, cŌĆÖest-├Ā-dire au corps. De m├¬me, la conformation de toute cr├®ature naturelle, que ce soit la plante, lŌĆÖanimal ou lŌĆÖhomme, nŌĆÖest pas d├®termin├®e ni conditionn├®e par une ┬½id├®e┬╗ correspondante, flottant en lŌĆÖair au-dessus dŌĆÖelle, mais par le principe formel de lŌĆÖensemble plus grand auquel elle appartient : la nature┬╗. Et plus loin : ┬½La th├®orie finaliste affirme seulement que, malgr├® les innombrables mis├©res de cette vie cr├®aturelle, une harmonie indiscutable r├®v├©le les plans et les buts de la nature en chacune de ses formations et de ses ├®volutions. Mais cette conformit├® ├Ā un but ne se r├®alise que dans les limites des lois naturelles, et elle ne tend pas ├Ā r├®aliser un pays de Cocagne dans lequel la vie existerait sans la mort, et le devenir sans lŌĆÖan├®antissement, et sans les phases plus ou moins d├®sagr├®ables, mais in├®vitables, qui le pr├®c├©dent. Lorsque les adversaires de la conception finaliste opposent un faible monceau, p├®niblement accumul├®, de petites exceptions ├Ā la merveilleuse finalit├® qui r├©gne dans tous les domaines de la nature, je trouve cela plut├┤t comique.┬╗
QuŌĆÖest-ce quŌĆÖon nomme ici la finalit├® ? Une harmonie entre les perceptions particuli├©res et leur ensemble. Mais puisque ├Ā la base de chaque perception il y a une loi, id├®e, que nous d├®couvrons gr├óce ├Ā notre pens├®e, lŌĆÖharmonie entre les parties dŌĆÖun ensemble perceptible nŌĆÖest autre quŌĆÖune harmonie entre les parties de lŌĆÖensemble id├®el qui y est contenu. LorsquŌĆÖon dit : lŌĆÖanimal, ou lŌĆÖhomme, nŌĆÖest pas d├®termin├® par une id├®e flottant en lŌĆÖair, on sŌĆÖexprime mal, et il suffit de r├®tablir lŌĆÖexpression dans ses v├®ritables termes pour lui faire perdre son caract├©re dŌĆÖabsurdit├®. LŌĆÖanimal nŌĆÖest certes pas d├®termin├® par une id├®e flottant en lŌĆÖair, mais bel et bien par une id├®e inn├®e qui contient les lois de son existence. CŌĆÖest justement parce que lŌĆÖid├®e nŌĆÖest pas ext├®rieure aux choses, mais agit en elles comme ├®tant leur essence m├¬me, quŌĆÖon ne peut parler de finalit├®. Et cŌĆÖest justement lorsque lŌĆÖon nie que la cr├®ature soit d├®termin├®e du dehors, par une id├®e flottant en lŌĆÖair, ou existant hors de la cr├®ature dans lŌĆÖesprit dŌĆÖun cr├®ateur universel, que lŌĆÖon doit nier aussi que cette cr├®ature soit d├®termin├®e selon un plan, ou selon des buts ext├®rieurs. Elle lŌĆÖest seulement par ses causes et ses lois int├®rieures.
Je construis une machine selon des fins, lorsque je mets ses parties dans un certain rapport non donn├® par la nature. La finalit├® de cette construction repose sur ce fait que jŌĆÖai mis comme id├®e, ├Ā la base de la machine, celle de son mode dŌĆÖaction. La machine est devenue par l├Ā un objet de perception poss├®dant son id├®e correspondante. Les cr├®atures naturelles sont ├®galement des objets de cette sorte. Si lŌĆÖon croit un objet dou├® de finalit├® parce quŌĆÖil est construit selon des lois, alors on peut appliquer cette qualification aux cr├®atures naturelles. Mais cette finalit├® nŌĆÖest pas la m├¬me que celle de lŌĆÖaction humaine. Pour quŌĆÖil y ait vraiment un but, il faut que la cause agissante soit un concept, ├Ā savoir, le concept de lŌĆÖeffet ├Ā produire. Or, nulle part, dans la nature, on ne trouve des concepts qui soient des causes ; le concept nŌĆÖappara├«t jamais que comme un rapport id├®el de la cause ├Ā lŌĆÖeffet. Les causes, dans la nature, ne sont jamais donn├®es que sous forme de perceptions.
Le dualisme a le droit de parler des fins de lŌĆÖunivers et des fins de lŌĆÖhomme. L├Ā o├╣ nous percevons un rapport normal de cause ├Ā effet, le dualisme peut admettre que nous voyons le d├®calque dŌĆÖun rapport con├¦u par lŌĆÖ├¬tre absolu pour la r├®alisation de ses fins. Mais, pour le monisme, lŌĆÖexclusion de tout ├¬tre absolu hypoth├®tique, cŌĆÖest-├Ā-dire inaccessible ├Ā lŌĆÖexp├®rience, entra├«ne aussi lŌĆÖexclusion de toute finalit├® universelle ou humaine.
APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
Il ne faudrait pas conclure de ce qui pr├®c├©de que lŌĆÖauteur, lorsquŌĆÖil refusait ainsi dŌĆÖadmettre aucune finalit├® dans les ph├®nom├©nes extra-humains, sŌĆÖaccordait avec les penseurs qui trouvent l├Ā un pr├®texte ├Ā ne plus voir hors de lŌĆÖhomme, et m├¬me dans lŌĆÖhomme, que des processus naturels. On ne sŌĆÖy trompera pas, car on aura remarqu├® que dans ce livre le processus de la pens├®e est d├®crit comme un ph├®nom├©ne purement spirituel. Si nous rejetons la conception finaliste, m├¬me du monde spirituel ext├®rieur ├Ā lŌĆÖhomme, cŌĆÖest quŌĆÖil se manifeste dans ce monde spirituel quelque chose de sup├®rieur ├Ā la finalit├® que r├®alise le genre humain. Et quand nous estimons erron├®e lŌĆÖid├®e dŌĆÖune d├®termination finale du genre humain, con├¦ue sur le mod├©le des buts que lŌĆÖhomme se propose, nous voulons dire que lŌĆÖindividu seul peut se donner ├Ā lui-m├¬me des fins ; mais que lŌĆÖactivit├® globale de lŌĆÖhumanit├®, comme r├®sultante de toutes ces fins individuelles, constitue une chose sup├®rieure ├Ā ces fins.
12. LŌĆÖimagination morale
(darwinisme et moralit├®)
LŌĆÖesprit libre agit selon ses impulsions propres, cŌĆÖest-├Ā-dire selon ses intuitions, choisies par la pens├®e au sein du monde id├®el. Pour lŌĆÖesprit qui nŌĆÖest point libre, la cause qui d├®termine le choix dŌĆÖune certaine intuition, qui servira dŌĆÖimpulsion active, nŌĆÖest quŌĆÖune part de ses perceptions et exp├®riences ant├®rieures. Il se rappelle, avant de se d├®cider, ce quŌĆÖil a vu faire ├Ā quelquŌĆÖun dŌĆÖautre en pareil cas, ou lŌĆÖavis de quelquŌĆÖun, ou le commandement de Dieu, etc., et cŌĆÖest l├Ā ce qui d├®termine son action. Ces circonstances pr├®paratoires, chez lŌĆÖesprit libre, nŌĆÖagissent pas seules. La d├®cision quŌĆÖil prend est, en un certain sens, une d├®cision premi├©re. Peu lui importe ce que dŌĆÖautres ont fait ou command├® en pareil cas. Il a des raisons purement id├®elles de choisir, parmi la somme de ses concepts, celui quŌĆÖil va r├®aliser en acte. Mais cet acte va sŌĆÖincorporer ├Ā la r├®alit├® sensible. LŌĆÖhomme va accomplir une chose qui est identique ├Ā un certain complexus perceptible. Son concept va prendre corps en un ├®v├®nement concret et particulier. Or, en sa qualit├® de concept, il ne contient pas cet ├®v├©nement concret ; il ne peut sŌĆÖy rapporter que de la mani├©re que nous avons d├®finie plus haut au sujet du concept ┬½lion┬╗ et du lion particulier. Nous avons vu que le passage du concept ├Ā la perception se fait par la repr├®sentation. [voir: chapitre "6. LŌĆÖindividualit├® humaine"]. CŌĆÖest ce terme interm├®diaire que lŌĆÖesprit non-libre re├¦oit tout dŌĆÖabord ; les motifs apparaissent dans sa conscience sous forme de repr├®sentations. Il d├®cide de faire ce quŌĆÖil a vu faire d├®j├Ā, ou bien ce qui est command├® pour ce cas sp├®cial. CŌĆÖest pourquoi lŌĆÖautorit├® sŌĆÖexerce si bien sur les esprits non-libres par le moyen dŌĆÖexemples, cŌĆÖest-├Ā-dire par la transmission dŌĆÖactes tr├©s particuliers et tr├©s concrets.
Le chr├®tien agit beaucoup moins dŌĆÖapr├©s la doctrine que dŌĆÖapr├©s le mod├©le du Sauveur. Les r├©gles ont beaucoup moins de valeur pour lŌĆÖaction positive, que pour lŌĆÖinterdiction de certains actes. Les lois ne rev├¬tent une forme conceptuelle g├®n├®rale que lorsquŌĆÖelles d├®fendent une action, non point lorsquŌĆÖelles en ordonnent. Ce quŌĆÖil doit faire, lŌĆÖesprit non-libre ne le peut apprendre que sous une forme absolument concr├©te : ┬½Nettoyez la rue devant la porte de votre maison ! Payez tels imp├┤ts ├Ā tel bureau de perception ! etc.┬╗ La forme conceptuelle ne sŌĆÖapplique quŌĆÖaux lois de d├®fense. ┬½Vous ne volerez pas ! Vous ne serez point adult├©res !┬╗ Et encore ces lois nŌĆÖagissent-elles sur lŌĆÖesprit non-libre que par leur allusion ├Ā une repr├®sentation concr├©te, telle que la dur├®e dŌĆÖemprisonnement, les remords de conscience, la damnation ├®ternelle, etc..
D├©s que lŌĆÖimpulsion active est donn├®e sous une forme purement g├®n├®rale et conceptuelle, par exemple : ┬½Vous devez faire le bien ├Ā vos semblables !┬╗ ou : ┬½Vous devez vivre de mani├©re ├Ā favoriser le plus possible votre propre bien-├¬tre┬╗, il faut quŌĆÖ├Ā chaque cas concret, la repr├®sentation de lŌĆÖaction, le rapport du concept ├Ā un complexus perceptible, soient trouv├®s par lŌĆÖhomme. Cet acte dŌĆÖinvention est toujours n├®cessaire ├Ā lŌĆÖesprit libre, que ne pousse ni lŌĆÖexemple, ni la crainte de la punition, ni rien de semblable. Il lui faut trouver lui-m├¬me la transformation de son concept en repr├®sentation.
La facult├® gr├óce ├Ā laquelle lŌĆÖhomme engendre, du sein de son tr├®sor dŌĆÖid├®es, des repr├®sentations concr├©tes, est tout dŌĆÖabord lŌĆÖimagination. La facult├® dont lŌĆÖesprit libre a besoin pour mener ses id├®es jusquŌĆÖ├Ā la r├®alisation, nous la nommerons donc lŌĆÖimagination morale. Elle est la source de lŌĆÖaction de lŌĆÖesprit libre. Et seuls les hommes dou├®s dŌĆÖimagination morale peuvent ├¬tres dits productifs au point de vue ├®thique. Ceux qui se contentent de pr├¬cher la morale, cŌĆÖest-├Ā-dire les gens qui b├ótissent des r├©gles en lŌĆÖair, sans les r├®aliser en repr├®sentations concr├©tes, ces gens-l├Ā sont moralement improductifs. Ils ressemblent ├Ā ces critiques qui savent expliquer savamment comment on fait une oeuvre dŌĆÖart, tout en ├®tant incapables dŌĆÖen produire une.
LŌĆÖimagination morale, lorsquŌĆÖelle se r├®alise, intervient forc├®ment dans un domaine du monde perceptible. LŌĆÖaction de lŌĆÖhomme ne cr├®e ├®videmment pas des perceptions, mais elle transforme les perceptions d├®j├Ā existantes et leur pr├¬te un aspect nouveau. Pour accomplir cette transformation dŌĆÖun objet ou dŌĆÖune somme dŌĆÖobjets dŌĆÖapr├©s la repr├®sentation morale, il faut avoir con├¦u la structure et la loi de cet objet ou de cette somme, cŌĆÖest-├Ā-dire sa mani├©re dŌĆÖ├¬tre et son action ant├®rieure, que lŌĆÖon veut recr├®er ou orienter diff├®remment. Il faut ensuite trouver le mode selon lequel cette structure se laissera transformer en une structure nouvelle. Cette partie de lŌĆÖactivit├® morale n├®cessite une certaine connaissance du monde sensible auquel on sŌĆÖadresse ; connaissance g├®n├®ralement fournie par une des branches de la science. LŌĆÖaction morale demande, par cons├®quent, non seulement la facult├® dŌĆÖengendrer des id├®es morales, et des imaginations morales, mais encore celle de savoir transformer le monde des perceptions sans violer sa structure ni ses lois naturelles [nota: il faudrait lire bien superficiellement pour apercevoir dans le mot de ┬½facult├®┬╗, que nous employons ├Ā diff├®rentes reprises, un retour ├Ā lŌĆÖancienne th├®orie de la psychologie (facult├®s de lŌĆÖ├óme). En se reportant au chapitre "5. La connaissance du monde" rechercher "lŌĆÖindividu priv├® de facult├® intuitive" - on verra exactement ce que nous entendons par ce mot]. Cette facult├® est la technique morale. Elle sŌĆÖapprend comme sŌĆÖapprennent toutes les sciences. En g├®n├®ral, les hommes sont mieux dou├®s pour trouver les concepts correspondant au monde donn├®, que pour d├®terminer et produire imaginativement des actions futures. Il est donc tr├©s possible que des hommes mal dou├®s dŌĆÖimagination morale re├¦oivent les imaginations morales des autres et les incorporent adroitement ├Ā la r├®alit├®. Par contre, il peut arriver aussi que les hommes bien dou├®s dŌĆÖimagination morale soient priv├®s dŌĆÖadresse technique et oblig├®s de charger dŌĆÖautres hommes de r├®aliser leurs repr├®sentations. Notre activit├® n├®cessite donc, dans une certaine mesure, la connaissance des objets contenus dans notre sph├©re dŌĆÖaction. L├Ā nŌĆÖagissent que les lois naturelles. Il sŌĆÖagit donc, non point dŌĆÖ├®thique, mais de science naturelle.
LŌĆÖimagination morale, et le pouvoir dŌĆÖengendrer des id├®es morales, ne peuvent devenir objet de connaissance quŌĆÖapr├©s quŌĆÖil ont ├®t├® produits par lŌĆÖindividu. Mais alors ils, ne r├©glent plus la vie, ils lŌĆÖont d├®j├Ā r├®gl├®e. On ne doit plus les consid├®rer que comme des causes agissantes au m├¬me titre que les autres causes ; ils ne sont des fins que pour le sujet. La morale ne peut donc ├¬tre quŌĆÖune science naturelle des repr├®sentations morales.
Il ne peut y avoir, en dehors de l├Ā, aucune morale con├¦ue comme science des normes.
On a tent├® de conserver aux lois morales leur caract├©re normatif en les concevant ├Ā la mani├©re de la di├®t├®tique, qui d├®duit des r├©gles g├®n├®rales des n├®cessit├®s de lŌĆÖorganisme, pour les faire ensuite r├®agir sur ce dernier [voir: "Syst├©me de lŌĆÖ├ēthique" par Paulsen]. CŌĆÖest une mauvaise comparaison, car notre vie morale ne ressemble aucunement ├Ā la vie de notre organisme. LŌĆÖactivit├® de notre organisme existe sans notre intervention ; nous trouvons ses lois toutes donn├®es dans le monde, et pouvons les chercher, pour en faire ensuite lŌĆÖapplication. Mais cŌĆÖest nous qui cr├®ons tout dŌĆÖabord les lois morales. Il nous est impossible de les appliquer avant quŌĆÖelles soient cr├®├®es. LŌĆÖerreur provient de ce fait que les contenus des lois morales ne sont pas recr├®├®s ├Ā chaque instant ; ils se transmettent h├®r├®ditairement ; celles que nous recevons de nos anc├¬tres nous semblent alors donn├®es, comme les lois de lŌĆÖorganisme. Mais nous nŌĆÖavons aucun droit ├Ā les appliquer de la m├¬me mani├©re que des r├©gles di├®t├®tiques. Car elles se rapportent ├Ā lŌĆÖindividu, au lieu de se rapporter, comme les lois naturelles, ├Ā lŌĆÖexemplaire dŌĆÖune esp├©ce animale. En qualit├® dŌĆÖorganisme, je suis un exemplaire de mon esp├©ce et je vivrai selon la nature si jŌĆÖapplique, en chaque cas particulier, les lois de mon esp├©ce, mais, en qualit├® dŌĆÖ├¬tre moral, je suis un individu et jŌĆÖai ma loi propre [nota: Paulsen nŌĆÖest pas loin de la v├®rit├® quand il dit (page 15 du livre cit├®) : ┬½Des dispositions naturelles et des conditions de vie diff├®rentes exigent non seulement un r├®gime physique mais aussi un r├®gime moral et spirituel diff├®rent┬╗. Cependant le point essentiel lui ├®chappe. En tant quŌĆÖindividu, je nŌĆÖai pas besoin de r├®gime particulier. La di├®t├®tique est lŌĆÖart dŌĆÖaccorder tel repr├®sentant de lŌĆÖesp├©ce avec cette esp├©ce m├¬me. Or, en tant quŌĆÖindividu, je ne suis pas le repr├®sentant dŌĆÖune esp├©ce].
Cette opinion para├«tra en contradiction avec la doctrine fondamentale de la science moderne, la th├®orie de lŌĆÖ├®volution. Mais ce nŌĆÖest quŌĆÖune contradiction apparente. Par ├®volution, on entend la production r├®elle dŌĆÖ├®tats post├®rieurs par les ├®tats ant├®rieurs, selon des modes naturels. Par ├®volution dans le monde organique, on entend ce fait que les descendants perfectionn├®s sont des rejetons r├®els dŌĆÖascendants moins parfaits, et sont issus dŌĆÖeux conform├®ment aux lois de la science. Les partisans de cette doctrine se repr├®sentent quŌĆÖil y eut, une fois, sur la terre, une ├®poque o├╣ un observateur aurait pu voir les reptiles na├«tre des amniotes, ├Ā condition de disposer dŌĆÖun temps, dŌĆÖobservation suffisant pour assister ├Ā cette m├®tamorphose. De m├¬me, ces th├®oriciens imaginent quŌĆÖun observateur plac├® assez longtemps dans lŌĆÖ├®ther aurait pu voir le syst├©me solaire sortir peu ├Ā peu de la n├®buleuse de Kant-Laplace. Sans doute, pour justifier ces repr├®sentations, faudrait-il comprendre les amniotes et la n├®buleuse de Kant-Laplace tout autrement que ne le fait la science mat├®rialiste, mais peu importe ici. Ce qui importe, cŌĆÖest quŌĆÖaucun des th├®oriciens ├®volutionnistes nŌĆÖaura lŌĆÖid├®e dŌĆÖaffirmer que le concept de reptile, avec toutes ses propri├®t├®s, peut-├¬tre tir├® du concept dŌĆÖamniote par quelquŌĆÖun qui nŌĆÖa jamais vu de reptile. Pas plus que le concept de syst├©me solaire ne saurait ├¬tre tir├® du concept de la n├®buleuse de Kant-Laplace, en admettant que ce dernier concept ait ├®t├® form├® seulement ├Ā la perception directe de cette n├®buleuse. En dŌĆÖautres termes : lŌĆÖ├®volutionniste, sŌĆÖil est cons├®quent avec lui-m├¬me, ne peut quŌĆÖaffirmer ce qui suit : Aux phases ant├®rieures de lŌĆÖ├®volution ont succ├®d├® des phases post├®rieures r├®elles, et lorsque nous comparons notre concept des premi├©res ├Ā notre concept des secondes, nous apercevons le lien qui unit les stades moins parfaits aux stades plus parfaits. Mais il ne peut admettre que le concept acquis ├Ā lŌĆÖexamen des phases ant├®rieures suffise ├Ā former le concept des phases post├®rieures. Pour lŌĆÖ├®thique, il en va de m├¬me. On peut, certes, concevoir le rapport des concepts moraux post├®rieurs ├Ā ceux qui les pr├®c├®d├©rent ; mais il nŌĆÖen ressort point quŌĆÖune seule id├®e morale nouvelle puisse ├¬tre tir├®e des id├®es anciennes. En qualit├® dŌĆÖ├¬tre moral, lŌĆÖindividu produit toute sa propre valeur. Ce contenu individuel est pour le moraliste un objet donn├®, comme le reptile lŌĆÖest pour le biologiste ; les reptiles sont issus des amniotes, mais le biologiste ne saurait tirer le concept du reptile de celui dŌĆÖamniotes. De m├¬me, les id├®es morales post├®rieures sont issues, par ├®volution, des ant├®rieures ; mais le moraliste ne saurait tirer les concepts moraux de son ├®poque des concepts moraux dŌĆÖune ├®poque pass├®e. La confusion provient de ce fait que le naturaliste trouve les choses toutes donn├®es devant lui, tandis quŌĆÖen ce qui concerne lŌĆÖaction morale, il nous faut cr├®er dŌĆÖabord ce quŌĆÖensuite nous consid├®rons. Dans le processus dŌĆÖ├®volution de lŌĆÖunivers moral, nous accomplirons ce quŌĆÖaccomplit la nature dans les r├©gnes inf├®rieurs : nous transformons les donn├®es perceptibles. La norme ├®thique ne peut donc ├¬tre imm├®diatement connue, comme le serait une loi naturelle ; elle doit ├¬tre dŌĆÖabord cr├®├®e. CŌĆÖest seulement lorsquŌĆÖelle est l├Ā, quŌĆÖelle devient lŌĆÖobjet de connaissance.
Cependant, ne peut-on mesurer les valeurs nouvelles dŌĆÖapr├©s les anciennes ? Tout homme nŌĆÖest-il pas oblig├® de comparer les produits de son intuition aux doctrines morales d├®j├Ā ├®tablies ? Les manifestations r├®ellement neuves et productives de lŌĆÖintuition morale ne sauraient pas plus supporter cette commune mesure que les formes nouvelles de la nature ne se peuvent mesurer aux formes disparues. Ne serait-il pas absurde de dire des reptiles quŌĆÖils ne co├»ncident pas exactement avec les amniotes et que, par cons├®quent, ils sont une forme ill├®gitime (maladive) ?
LŌĆÖindividualisme ├®thique ne sŌĆÖoppose donc point ├Ā une doctrine ├®volutionniste bien comprise, il en ressort, au contraire, directement. LŌĆÖarbre g├®n├®alogique de Haeckel peut bien se poursuivre depuis les animaux primitifs jusquŌĆÖ├Ā lŌĆÖorganisme humain, sans interruption de lŌĆÖ├®volution naturelle, il peut m├¬me se laisser ├®tendre jusquŌĆÖ├Ā lŌĆÖindividu moral, dans une certaine acceptation de ce terme. Mais nulle part on ne pourra d├®duire, de lŌĆÖ├¬tre dŌĆÖune esp├©ce ancestrale, lŌĆÖ├¬tre des esp├©ces descendantes. De m├¬me, autant il est exact que les id├®es morales des individus sont descendues, perceptiblement, de celles de leurs anc├¬tres, autant il est vrai que lŌĆÖindividu est moralement inf├®cond tant quŌĆÖil nŌĆÖa pas lui-m├¬me des id├®es morales.
LŌĆÖindividualisme ├®thique, que lŌĆÖon vient dŌĆÖ├®tablir en conclusion de ce qui pr├®c├©de, pourrait aussi bien se d├®duire de la th├®orie ├®volutionniste. Le r├®sultat serait le m├¬me, on lŌĆÖobtiendrait seulement dŌĆÖune autre mani├©re.
LŌĆÖapparition dŌĆÖid├®es morales enti├©rement nouvelles, dues ├Ā lŌĆÖimagination morale, ne devrait pas plus surprendre lŌĆÖ├®volutionniste que ne le surprend la succession dŌĆÖune esp├©ce animale ├Ā une autre esp├©ce animale. La doctrine ├®volutionniste, en tant que conception moniste du monde, se refuse ├Ā admettre toute influence dŌĆÖau-del├Ā (m├®taphysique) qui ne soit pas un objet dŌĆÖexp├®rience id├®elle. Elle cherche ├Ā expliquer les nouvelles apparitions organiques sans admettre quŌĆÖaucune force cr├®atrice extra-naturelle les ait provoqu├®es. Or, de m├¬me que le monisme explique les ph├®nom├©nes de la vie sans le secours dŌĆÖaucune cr├®ation surnaturelle, il doit trouver ├Ā lŌĆÖordre moral universel des causes enti├©rement contenues dans le champ de notre exp├®rience. Un vouloir moral ne saurait ├¬tre expliqu├® ├Ā ses yeux lorsquŌĆÖon lŌĆÖa ramen├® ├Ā une influence surnaturelle continue (toute-puissance divine), ou ├Ā une r├®v├®lation historique de Dieu (les dix commandements), ou encore ├Ā une apparition de Dieu sur la terre (le Christ). Ces diff├®rentes causes ne se transforment dans lŌĆÖhomme en un vouloir moral que si elles deviennent son exp├®rience personnelle, son bien propre. Pour le monisme, les ph├®nom├©nes moraux sont des produits de la nature comme tous les autres, et on ne doit chercher leurs causes que dans la nature, cŌĆÖest-├Ā-dire, puisque lŌĆÖhomme est le porteur de ces ph├®nom├©nes, dans lŌĆÖhomme.
LŌĆÖindividualisme ├®thique est donc le couronnement de lŌĆÖ├®difice quŌĆÖont ├®lev├® Darwin et Haeckel, sur le terrain de la science naturelle. CŌĆÖest un ├®volutionnisme spiritualis├®, ├®tendu jusquŌĆÖ├Ā la vie morale.
Ceux qui assignent ├Ā la notion de lŌĆÖordre naturel des limites ├®troites et arbitraires, arrivent fatalement ├Ā ne plus trouver de place, dans cet ordre naturel, pour la libre action de lŌĆÖindividu. LŌĆÖ├®volutionniste, sŌĆÖil raisonne de mani├©re cons├®quente, ne commet point cette erreur. Il ne cl├┤t pas, apr├©s le singe, la s├®rie de lŌĆÖ├®volution naturelle des ├¬tres, pour conf├®rer ├Ā lŌĆÖhomme une origine ┬½surnaturelle┬╗. D├®j├Ā dans lŌĆÖ├®tude des anc├¬tres de lŌĆÖhomme, il sait chercher lŌĆÖesprit. Aussi ne peut-il sŌĆÖen tenir ├Ā lŌĆÖexamen des fonctions organiques de lŌĆÖhomme, et les trouver seules ┬½naturelles┬╗ ; il doit voir dans la vie morale, et dans la libert├®, la continuation spirituelle de lŌĆÖ├®volution organique.
Tout ce que peut affirmer lŌĆÖ├®volutionniste, de par le fondement m├¬me de sa doctrine, cŌĆÖest que lŌĆÖaction morale actuelle est sortie de certains ├®tats ant├®rieurs et diff├®rents du devenir universel. Mais caract├®riser cette action morale, cŌĆÖest-├Ā-dire la nommer libre, voil├Ā qui est du ressort de lŌĆÖobservation imm├®diate, et lŌĆÖ├®volutionniste ne peut que lŌĆÖaccepter comme il accepte toutes les choses donn├®es. Il se borne ├Ā pr├®tendre que les hommes se sont d├®velopp├®s peu ├Ā peu, et que leurs anc├¬tres nŌĆÖ├®taient pas encore humains. Ce que sont actuellement les hommes, cŌĆÖest lŌĆÖobservation seule qui le peut ├®tablir. Il est impossible que les r├®sultats de lŌĆÖobservation viennent contredire lŌĆÖhistoire r├®elle de lŌĆÖ├®volution du monde. Un conflit ne pourrait sŌĆÖ├®lever que si nous pr├®tendions que les r├®sultats susdits excluent lŌĆÖordre naturel de lŌĆÖunivers [nota: nous nous croyons autoris├®s ├Ā nommer des pens├®es (les id├®es morales) des objets dŌĆÖobservation. Car si les formations de la pens├®e, au moment m├¬me o├╣ elles entrent en jeu, ├®chappent ├Ā lŌĆÖobservation, elles nŌĆÖen peuvent pas moins devenir objets dŌĆÖobservation par la suite. CŌĆÖest par ce moyen que nous avons ├®tabli les caract├®ristiques de lŌĆÖaction humaine].
LŌĆÖindividualisme ├®thique nŌĆÖa rien ├Ā craindre de la science naturelle, ├Ā la condition que celle-ci se comprenne elle-m├¬me : lŌĆÖobservation nous pr├®sente, comme caract├®ristique de lŌĆÖaction humaine parfaite, la libert├®. Force nous est dŌĆÖaccorder ce caract├©re de libert├® ├Ā la volont├® humaine, dans la mesure o├╣ elle proc├©de dŌĆÖintuitions purement id├®elles. Car ces derni├©res ne sont point les effets dŌĆÖune n├®cessit├® ext├®rieure ; elles ne reposent que sur elles-m├¬mes. D├©s que lŌĆÖhomme voit en son action lŌĆÖempreinte parfaite dŌĆÖune telle intuition, il ressent la libert├® de cette action cŌĆÖest l├Ā le seul crit├®rium de la libert├® humaine.
QuŌĆÖadvient-il, d├©s lors, de la distinction que nous avons expos├®e plus haut [voir: chapitre "1. L'action humaine consciente" - rechercher "il sŌĆÖimagine ├¬tre libre"] entre les deux propositions dont la premi├©re est ; ┬½├Ŗtre libre, cŌĆÖest pouvoir faire ce que lŌĆÖon veut┬╗, et la seconde : ┬½Le v├®ritable sens du dogme du libre arbitre, cŌĆÖest que lŌĆÖhomme peut, ├Ā son gr├®, d├®sirer ou ne pas d├®sirer.┬╗ Hamerling fonde sur cette distinction toute sa doctrine de la libert├® ; la premi├©re proposition lui para├«t juste, et la seconde nŌĆÖest, dit-il, quŌĆÖune tautologie absurde. Il ├®crit : ┬½On peut dire : ┬½Je puis faire ce que je veux┬╗, mais dire : ┬½je puis vouloir ce que je veux┬╗ est une vaine tautologie┬╗. Or, faire ce que je veux, cŌĆÖest-├Ā-dire transmuer en r├®alit├® lŌĆÖid├®e que je me suis propos├®e, cela d├®pend des circonstances ext├®rieures et de mon adresse technique [voir: chapitre "12. LŌĆÖimagination morale" - rechercher "priv├®s dŌĆÖadresse technique"]. ├Ŗtre libre, cŌĆÖest pouvoir d├®terminer de soi-m├¬me, gr├óce ├Ā lŌĆÖimagination morale, les repr├®sentations initiales de lŌĆÖaction. La libert├® nŌĆÖexiste pas tant que quelque chose dŌĆÖext├®rieur ├Ā moi (ph├®nom├©ne m├®canique ou puissance surnaturelle) d├®termine mes repr├®sentations morales. Elle existe si je les produis moi-m├¬me. Ce nŌĆÖest pas ├¬tre libre que pouvoir ex├®cuter les intentions quŌĆÖun autre ├¬tre a mises en moi. Un ├¬tre libre est donc celui qui peut vouloir ce que lui-m├¬me tient pour juste. Celui qui fait autrement quŌĆÖil ne veut, y est pouss├® par des motifs qui ne lui sont pas propres. Il nŌĆÖest donc pas libre. LorsquŌĆÖon dit : ┬½pouvoir ├Ā son gr├® vouloir ce quŌĆÖon tient pour juste ou ce quŌĆÖon ne tient pas pour juste┬╗, cela veut dire : ┬½pouvoir, ├Ā son gr├®, ├¬tre libre ou ne pas lŌĆÖ├¬tre┬╗. Et cŌĆÖest tout aussi absurde que de voir la libert├® dans le pouvoir de faire ce que lŌĆÖon est forc├® de vouloir. Cette derni├©re proposition est celle de Hamerling : ┬½Il est absolument exact, ├®crit-il, que la volont├® est toujours d├®termin├®e par des motifs, mais il est absurde dŌĆÖen conclure quŌĆÖelle nŌĆÖest pas libre. Car on ne peut souhaiter, ni m├¬me concevoir pour elle de plus grande libert├® que celle de se r├®aliser dans la mesure de sa force et de sa d├®cision┬╗. Si, on peut souhaiter une libert├® plus grande, et cŌĆÖest la seule vraie : ├Ā savoir, celle de d├®terminer soi-m├¬me les raisons de son vouloir.
Il arrive que lŌĆÖhomme se laisse amener ├Ā abandonner lŌĆÖex├®cution de ce quŌĆÖil veut. Mais se laisser prescrire ce quŌĆÖil doit faire, cŌĆÖest-├Ā-dire vouloir ce quŌĆÖun autre tient pour juste et non lui, voil├Ā ce quŌĆÖil ne saurait consentir quŌĆÖen faisant abdication de sa libert├®.
Les pouvoirs ext├®rieurs peuvent mŌĆÖemp├¬cher de faire ce que je veux, alors ils me condamnent simplement ├Ā lŌĆÖinaction ou ├Ā la non-libert├®. CŌĆÖest seulement lorsquŌĆÖils r├®duisent mon esprit en esclavage, cŌĆÖest seulement lorsquŌĆÖils chassent de ma t├¬te mes motifs dŌĆÖaction pour mettre les leurs ├Ā la place, quŌĆÖils entament r├®ellement ma libert├®. CŌĆÖest pourquoi lŌĆÖ├ēglise ne d├®fend pas seulement certains actes, mais aussi les pens├®es impures, cŌĆÖest-├Ā-dire les motifs dŌĆÖaction. Elle combat la libert├® de lŌĆÖhomme en nommant impur tout motif qui nŌĆÖest pas prescrit par elle. Une ├®glise, ou toute autre association, est ennemie de la libert├® dans la mesure o├╣ ses pr├¬tres, ou ses ma├«tres, sŌĆÖ├®rigent en directeurs de conscience ; cŌĆÖest-├Ā-dire lorsque ses fid├©les sont oblig├®s de puiser en elle (au confessionnal) les motifs de leurs actions.
APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
Dans ces consid├®rations sur la volont├® humaine, nous avons montr├® de quelle fa├¦on lŌĆÖhomme doit vivre ses actions pour quŌĆÖelles lui procurent la conscience de la libert├® de son vouloir. Il est particuli├©rement important de signaler que cŌĆÖest lŌĆÖexp├®rience int├®rieure qui permet de certifier quŌĆÖune volont├® est libre. Cette exp├®rience consiste en une r├®alisation de lŌĆÖintuition id├®elle par la volont├®. Ceci ne peut ├¬tre quŌĆÖun r├®sultat dŌĆÖobservation ; il consiste g├®n├®ralement en ce fait que la volont├® humaine se sent entra├«n├®e par une ├®volution, dont le but est pr├®cis├®ment dŌĆÖatteindre ├Ā cette possibilit├® de libre vouloir uniquement support├® par lŌĆÖintuition id├®elle. Si cette possibilit├® peut ├¬tre obtenue, cŌĆÖest que, dans lŌĆÖintuition id├®elle, il nŌĆÖentre aucun autre ├®l├®ment que la substance m├¬me de cette intuition. Lorsque une telle intuition existe dans la conscience humaine, elle nŌĆÖy est aucunement engendr├®e par les ph├®nom├©nes de lŌĆÖorganisme [voir: chapitre "9. LŌĆÖid├®e de la libert├®" - rechercher "la pens├®e humaine nŌĆÖappara├«t quŌĆÖau sein de lŌĆÖorganisme"]. Au contraire, lŌĆÖactivit├® organique sŌĆÖest pour ainsi dire retir├®e, afin de faire place ├Ā lŌĆÖactivit├® id├®elle. Une volont├® qui est le reflet de lŌĆÖintuition ne se r├®alise, ├®galement, que par un recul des activit├®s n├®cessaires de lŌĆÖorganisme : cette volont├® est libre. On ne saurait constater cette libert├® de la volont├®, tant quŌĆÖon est incapable dŌĆÖobserver comment lŌĆÖ├®l├®ment intuitif paralyse et repousse les actions n├®cessaires de lŌĆÖorganisme humain, et comment lŌĆÖactivit├® spirituelle de la volont├® enti├©rement inspir├®e par la pens├®e peut prendre leur place. CŌĆÖest l├Ā la condition de la libert├®. Ceux qui ne peuvent faire cette observation ne croient ├Ā la libert├® dŌĆÖaucun vouloir. Mais ceux qui la font arrivent ├Ā se rendre parfaitement compte que lŌĆÖhomme est esclave dans la mesure o├╣ il ne peut pousser ├Ā bout cet obscurcissement des activit├®s organiques ; cet esclavage tend ├Ā la libert├®, et cette libert├® nŌĆÖest aucunement un id├®al abstrait, mais une force directrice pr├®sente ├Ā chaque instant dans la nature humaine. LŌĆÖhomme est libre, dans la mesure o├╣ il peut r├®aliser par sa volont├® le m├¬me mode de cr├®ation que par ses intuitions purement id├®elles spirituelles).
13. La valeur de la vie
(pessimisme et optimisme)
Comme pendant ├Ā la question des fins universelles et des fins humaines, autrement dit, de la d├®termination de la vie [voir: chapitre "11. La finalit├® dans lŌĆÖunivers et dans lŌĆÖhomme"], les philosophes se posent celles de la valeur de la vie. On trouve ici deux opinions contraires, et de lŌĆÖune ├Ā lŌĆÖautre tous les essais possibles de conciliation. LŌĆÖune de ces opinions est la suivante : notre monde est le plus excellent quŌĆÖon puisse imaginer et qui puisse exister ; vivre et agir en ce monde, cŌĆÖest un privil├©ge dŌĆÖune inestimable valeur. Les choses nous offrent le spectacle dŌĆÖune activit├® harmonieuse et raisonnable, qui m├®rite toute notre admiration. Ce qui para├«t ├¬tre le mal nŌĆÖest, ├Ā un point de vue sup├®rieur, quŌĆÖune manifestation du bien. Car le mal forme un contraste bienfaisant avec le bien, et nous en estimons dŌĆÖautant mieux ce dernier. DŌĆÖailleurs le mal nŌĆÖest pas r├®el ; il est seulement un degr├® inf├®rieur du bien. Le mal, ├®tant lŌĆÖabsence du bien, nŌĆÖa pas dŌĆÖexistence en soi.
LŌĆÖopinion contraire, cŌĆÖest que la vie est d├®bordante de souffrances et de mis├©res, que le d├®plaisir surpasse partout le plaisir, que la souffrance surpasse partout la joie. LŌĆÖexistence est un fardeau, et le non-├¬tre serait en tous les cas pr├®f├®rable ├Ā lŌĆÖ├¬tre. Parmi les repr├®sentants de la premi├©re opinion (optimisme), nous trouvons Shaftesbury et Leibnitz. Parmi ceux de la seconde (pessimisme), Schopenhauer et ├ēdouard von Hartmann. Leibnitz trouve que le monde est aussi bon que possible. Un monde meilleur ne peut exister. Car Dieu est bon et sage. Un Dieu bon veut cr├®er le meilleur des mondes ; un Dieu sage conna├«t ce qui est le meilleur des mondes, et peut le distinguer de tous les autres mondes possibles, qui seraient plus mauvais. Seul un Dieu mauvais, ou d├®pourvu de sagesse, pourrait cr├®er un monde qui ne soit pas le meilleur possible.
LorsquŌĆÖon part de ce point de vue, il est facile de prescrire ├Ā lŌĆÖaction humaine la voie par laquelle elle peut collaborer ├Ā lŌĆÖexcellence du monde. LŌĆÖhomme nŌĆÖaura quŌĆÖ├Ā ├®tudier les voies de Dieu, et quŌĆÖ├Ā les suivre. D├©s quŌĆÖil saura ce que sont les intentions de Dieu sur le monde et sur le genre humain, il saura aussi se bien conduire. Et il se sentira heureux de contribuer au bien universel. Par cons├®quent, du point de vue optimiste, lŌĆÖexistence vaut dŌĆÖ├¬tre v├®cue ; elle doit susciter notre int├®r├¬t et notre collaboration.
Schopenhauer voit la chose tout autrement. Il se repr├®sente, ├Ā la base de lŌĆÖunivers, non point un ├¬tre de bont├® et de sagesse parfaites, mais une impulsion, une volont├® aveugles. Un d├®sir ├®ternel, une soif incessante de satisfactions qui jamais ne peuvent ├¬tre atteintes, tel est le caract├©re fondamental de tout vouloir. Car, d├©s quŌĆÖun but est atteint, il en r├®sulte de nouveaux d├®sirs, etc.. La satisfaction ne peut jamais ├¬tre que dŌĆÖune dur├®e d├®risoire. Tout le reste de notre existence est d├®sir, inassouvissement, souffrance. Que le d├®sir sŌĆÖ├®mousse enfin, et voici quŌĆÖil manque ├Ā notre vie tout support, voici quŌĆÖun ennui infini nous envahit. Le bien relatif, cŌĆÖest donc dŌĆÖ├®teindre nos d├®sirs, de supprimer nos besoins, de tuer notre volont├®. Le pessimisme de Schopenhauer nous conduit ├Ā lŌĆÖinaction ; son but moral est la paresse universelle.
├ēd. von Hartmann ├®tablit le pessimisme sur de tout autres bases, et tente de lŌĆÖappliquer tout diff├®remment ├Ā lŌĆÖ├®thique. Hartmann, c├®dant ├Ā une impulsion propre ├Ā son ├®poque, cherche ├Ā appuyer sur lŌĆÖexp├®rience lŌĆÖ├®dification de son syst├©me philosophique. CŌĆÖest par lŌĆÖobservation de la vie quŌĆÖil cherche ├Ā ├®tablir si la joie ou la souffrance y pr├®dominent. Il passe en revue tout ce que les hommes tiennent pour du bonheur ou du plaisir, et il d├®montre que toutes les pr├®tendues satisfactions sont, ├Ā les examiner de pr├©s, des illusions. La sant├®, la jeunesse, la libert├®, lŌĆÖaisance, lŌĆÖamour (plaisir sexuel), la piti├®, lŌĆÖamiti├®, la vie de famille, le sentiment de lŌĆÖhonneur, la gloire, la domination, lŌĆÖ├®dification religieuse, les occupations artistiques et scientifiques, lŌĆÖespoir en lŌĆÖau-del├Ā, la collaboration au progr├©s, ne sont que des sources de bonheur illusoires. ├Ć les consid├®rer froidement, on trouve que chacune dŌĆÖelles apporte plus de malheur que de bonheur.
Le d├®plaisir est toujours pr├®dominant en ce monde. Il nŌĆÖest pas un homme qui, si on le lui proposait, accepterait de recommencer cette vie de mis├©res. Or, Hartmann ne nie point la pr├®sence de lŌĆÖid├®e, (la sagesse), dans le monde, mais lui accorde, au contraire, une place ├®gale ├Ā celle de la volont├® aveugle ; il ne peut donc sŌĆÖexpliquer la cr├®ation du monde par son ┬½├¬tre originel┬╗ que si celui-ci sŌĆÖest propos├® un but de sagesse en donnant libre cours ├Ā la souffrance universelle. Cette souffrance universelle est la souffrance m├¬me de Dieu, car la vie du monde, dans son ensemble, est identique ├Ā la vie de Dieu. Or, un ├¬tre infiniment sage ne peut avoir dŌĆÖautre but que de d├®livrer le monde de la souffrance, et, par cons├®quent, puisque toute existence est souffrance, de d├®livrer le monde de lŌĆÖexistence. Transformer lŌĆÖ├¬tre en un non-├¬tre infiniment sup├®rieur, tel est le but de la cr├®ation du monde. Le processus universel est un perp├®tuel combat contre la souffrance divine, qui ne prendra fin quŌĆÖavec lŌĆÖan├®antissement de toute existence. La vie morale de lŌĆÖhomme consiste donc ├Ā prendre part ├Ā la destruction universelle. Dieu a cr├®├® le monde pour se lib├®rer, gr├óce ├Ā lui, de sa douleur. Le monde est, pour ainsi dire, un ┬½abc├©s de lŌĆÖabsolu┬╗ gr├óce auquel sa force inconsciente de gu├®rison se d├®livre dŌĆÖune maladie int├®rieure, ou encore ┬½un empl├ótre douloureux que lŌĆÖ├Ŗtre-unique sŌĆÖapplique ├Ā lui-m├¬me pour faire d├®river vers lŌĆÖext├®rieur une souffrance int├®rieure, et la gu├®rir par la suite┬╗. Or, les hommes sont des membres de lŌĆÖunivers ; cŌĆÖest Dieu qui souffre en eux. Il les a cr├®├®s pour morceler sa douleur infinie. La douleur que chacun de nous ├®prouve nŌĆÖest quŌĆÖune goutte dŌĆÖeau dans la mer infinie de la douleur divine. [voir: "Ph├®nom├®nologie de la conscience morale" par Hartmann]
La connaissance apprendra donc ├Ā lŌĆÖhomme que la chasse aux satisfactions individuelles (├®go├»sme) est une folie, et que sa seule mission est de se vouer, en faisant abn├®gation enti├©re de son ├¬tre, au processus universel de la lib├®ration divine. Contrairement au pessimisme de Schopenhauer, celui de Hartmann nous prescrit une t├óche dŌĆÖactivit├® d├®sint├®ress├®e et sublime.
Mais que devons-nous penser de son fondement exp├®rimental ? Dans la recherche des satisfactions, lŌĆÖ├®nergie vitale demande ├Ā la vie plus que celle-ci ne lui fournit. Un ├¬tre a faim, il d├®sire sŌĆÖassouvir, lorsque ses fonctions organiques ont besoin, pour suivre leur cours, dŌĆÖun nouvel apport de vie sous forme de nourriture. La qu├¬te de la gloire indique que lŌĆÖhomme ne tient ses propres actes en estime que si une approbation leur vient du dehors. Le d├®sir de connaissance appara├«t lorsque lŌĆÖhomme trouve que lŌĆÖunivers quŌĆÖil voit, quŌĆÖil entend, etc., nŌĆÖest pas complet tant quŌĆÖil ne lŌĆÖa pas compris. La r├®alisation du d├®sir provoque chez lŌĆÖindividu de la joie, et la non-r├®alisation, de la peine. Il est important de remarquer que la joie et la peine d├®pendent de la r├®alisation ou de la non-r├®alisation du d├®sir. Le d├®sir lui-m├¬me ne peut-├¬tre, en aucune fa├¦on, consid├®r├® comme un d├®plaisir. Par cons├®quent, si lŌĆÖon ├®tablit quŌĆÖau moment o├╣ se r├®alise un d├®sir, un autre d├®sir le remplace, cela ne veut pas dire que la jouissance ait engendr├® du d├®plaisir. QuŌĆÖelle soit suivie du d├®sir de son renouvellement, ou du d├®sir dŌĆÖune nouvelle jouissance, il nŌĆÖy a d├®plaisir que si ce nouveau d├®sir rencontre un obstacle. M├¬me au cas o├╣ la jouissance engendre le d├®sir dŌĆÖune nouvelle jouissance plus grande ou plus raffin├®e, on ne saurait parler de d├®plaisir que si cette seconde jouissance se montre impossible. La jouissance nŌĆÖest cr├®atrice de souffrance que lorsque cette derni├©re en provient selon une loi naturelle, comme dans le cas de la jouissance sexuelle de la femme, qui donne lieu aux douleurs de lŌĆÖenfantement et aux fatigues de la maternit├®. Si le d├®sir lui-m├¬me engendrait de la souffrance, toute suppression du d├®sir serait accompagn├®e de joie. Or, ce nŌĆÖest pas le cas. LŌĆÖabsence de d├®sir provoque en nous lŌĆÖennui, qui est li├® ├Ā un d├®plaisir. Mais comme le d├®sir peut durer fort longtemps avant quŌĆÖil lui soit donn├® satisfaction, et comme on se r├®jouit pendant tout ce temps de lŌĆÖesp├®rance de cette satisfaction, il faut bien reconna├«tre que le d├®plaisir nŌĆÖa rien ├Ā faire avec le d├®sir lui-m├¬me, et quŌĆÖil provient seulement de la non-r├®alisation de ce dernier. Schopenhauer a donc absolument tort de consid├®rer le d├®sir ou la volont├®, en soi, comme une source de souffrance.
CŌĆÖest m├¬me, en r├®alit├®, le contraire qui est vrai. D├®sirer une chose, sŌĆÖefforcer vers elle, cŌĆÖest une cause de joie. Qui de nous ignore le bonheur que nous procure lŌĆÖesp├®rance dŌĆÖatteindre un but lointain, fortement d├®sir├® ? Cette joie est la compagne de tous les travaux dont les fruits ne seront ├Ā r├®colter que dans lŌĆÖavenir. Elle est tout ├Ā fait ind├®pendante de la r├®alisation du but. LorsquŌĆÖil est atteint, la joie de lŌĆÖaccomplissement est un ├®l├®ment nouveau qui se surajoute ├Ā celui de lŌĆÖeffort. On me r├®pondra peut-├¬tre quŌĆÖau cas o├╣ le d├®sir ne trouve pas sa satisfaction, au d├®plaisir de cet ├®chec se surajoute aussi celui de lŌĆÖesp├®rance tromp├®e, et que, finalement, le d├®plaisir total est beaucoup plus grand que nŌĆÖaurait ├®t├® la joie de la r├®alisation. Je r├®pliquerai que le contraire peut ├®galement se produire : le souvenir de toute la joie ├®prouv├®e au temps de lŌĆÖesp├®rance peut adoucir la peine finale de lŌĆÖ├®chec. Quiconque, au moment o├╣ son espoir sŌĆÖ├®croulait, a pu se dire : jŌĆÖai fait tout ce qui ├®tait en mon pouvoir, - sait combien cette observation est vraie. Le sentiment heureux dŌĆÖavoir voulu le bien dans toute la mesure de ses forces, voil├Ā ce quŌĆÖoublient ceux qui pr├®tendent quŌĆÖun ├®chec ne supprime pas seulement la joie de la r├®alisation, mais d├®truit jusquŌĆÖ├Ā la joie du d├®sir.
La r├®alisation dŌĆÖun d├®sir appelle du plaisir, la non-r├®alisation appelle du d├®plaisir. N├®anmoins, il ne faut pas en conclure que le plaisir soit la r├®alisation du d├®sir, ni le d├®plaisir sa non-r├®alisation. Le plaisir, comme le d├®plaisir, peuvent survenir sans ├¬tre les suites dŌĆÖaucun d├®sir. La maladie est une souffrance quŌĆÖaucun d├®sir ne pr├®c├©de. On ne peut pr├®tendre que la maladie soit un d├®sir inassouvi de sant├®, car ce serait prendre pour un d├®sir positif le souhait tout naturel, et qui nŌĆÖest m├¬me pas conscient, de ne pas tomber malade. Lorsque lŌĆÖon fait un h├®ritage dŌĆÖun parent lointain dont on ne soup├¦onnait m├¬me pas lŌĆÖexistence, cet ├®v├®nement procure une joie qui nŌĆÖa ├®t├®, elle non plus, pr├®c├®d├®e dŌĆÖaucun d├®sir.
Par cons├®quent, lorsquŌĆÖon veut savoir, du plaisir ou du d├®plaisir, ce qui lŌĆÖemporte en ce monde, il faut mettre en ligne de compte : la joie de d├®sirer, celle de r├®aliser ses d├®sirs, et celle qui survient sans d├®sir pr├®alable. En regard, il faut mettre le d├®plaisir de sŌĆÖennuyer, celui de ne pas r├®aliser ses d├®sirs, et enfin celui qui survient sans d├®sir pr├®alable. Dans cette derni├©re cat├®gorie se range ├®galement le d├®plaisir dŌĆÖaccomplir des travaux quŌĆÖon nous impose et que nous nŌĆÖavons pas choisis.
Or, une question se pose : Quel est le moyen de faire le bilan de ces plaisirs et de ces d├®plaisirs ? ├ēd. von Hartmann est dŌĆÖavis que cŌĆÖest la critique rationnelle. Il dit cependant [voir: "Philosophie de lŌĆÖInconscient" par Hartmann] que ┬½le plaisir et la douleur nŌĆÖexistent quŌĆÖautant quŌĆÖils sont ressentis┬╗. Il devrait en r├®sulter quŌĆÖil nŌĆÖy a pour la joie aucune autre mesure que celle de notre impression subjective. Il me faut ressentir si la somme de mes sentiments d├®sagr├®ables ├®gale ou d├®passe celle de mes sentiments agr├®ables. Sans avoir ├®gard ├Ā cette cons├®quence, Hartmann ├®crit : ┬½Si la valeur de la vie dŌĆÖune cr├®ature ne peut ├¬tre ├®valu├®e que dŌĆÖapr├©s ses propres mesures subjectives, cela ne veut pas dire que chaque cr├®ature effectue la somme alg├®brique juste des affections de sa vie ; en dŌĆÖautres termes, il nŌĆÖest pas dit que son jugement global sur sa propre existence soit exact quant ├Ā la vraie valeur de ses exp├®riences subjectives.┬╗ Il estime donc que le jugement rationnel du sentiment est arbitre en cette mati├©re. [nota!: lorsquŌĆÖon veut compter si la somme des joies d├®passe ou non celle des souffrances, on ne sŌĆÖaper├¦oit pas que lŌĆÖon veut une addition entre des termes qui nŌĆÖexistent nulle part. Le sentiment ne sŌĆÖadditionne pas, et pour ├®valuer v├®ritablement la vie, il importe de conna├«tre ce que lŌĆÖhomme sent r├®ellement, et non pas le r├®sultat dŌĆÖune addition imaginaire]
Ceux qui se rallient, plus ou moins enti├©rement, ├Ā des conceptions du genre de celles de Hartmann, croient sans doute que, pour estimer la vie ├Ā sa juste valeur, il faut faire abstraction de tous les facteurs qui faussent notre jugement ├Ā son sujet. Ils peuvent lŌĆÖessayer de deux mani├©res. Premi├©rement, en montrant que nos d├®sirs, instinct ou volont├®, jettent le trouble dans cette estimation qui devrait ├¬tre impartiale : par exemple, alors que nous devrions nous dire que lŌĆÖinstinct sexuel est une source de maux, nous sommes troubl├®s par le fait que cet instinct ├®voque en nous le mirage dŌĆÖune grande joie, tandis que cette joie, en fait, est infiniment moindre. Nous voulons jouir, et cŌĆÖest pourquoi nous ne nous avouons pas que cette jouissance est une source de souffrance. Deuxi├©mement, en soumettant tous nos sentiments ├Ā une critique rationnelle, en prouvant que les objets auxquels ils se rattachent sŌĆÖ├®vanouissent au regard de la raison, et quŌĆÖils disparaissent d├©s que notre intelligence sŌĆÖaccro├«t suffisamment pour en transpercer lŌĆÖillusion.
Ils peuvent se repr├®senter la chose comme suit : Un vaniteux veut savoir si, jusquŌĆÖ├Ā lŌĆÖinstant o├╣ il fait cet examen, la joie ou le d├®plaisir ont pr├®domin├® dans sa vie. Il lui faut se pr├®server de deux sources dŌĆÖerreurs. PuisquŌĆÖil est vaniteux, il verra ses succ├©s ├Ā travers un verre grossissant, et, au contraire, toutes les blessures quŌĆÖa re├¦ues sa vanit├® lui para├«tront, ├Ā distance, amoindries. Au temps o├╣ il a re├¦u ces blessures, il les a vivement ressenties, pr├®cis├®ment parce quŌĆÖil est vaniteux ; mais leur souvenir appara├«t dans une lumi├©re voil├®e, tandis que les joies de ses succ├©s, auxquels il est si sensible, en sont dŌĆÖautant plus fortement imprim├®es dans sa m├®moire. Certes, cŌĆÖest pour le vaniteux un v├®ritable bienfait quŌĆÖil en soit ainsi. LŌĆÖillusion, ├Ā lŌĆÖinstant de son examen, lui amoindrit les sentiments de d├®plaisir quŌĆÖil a ├®prouv├®s. Et cependant, son examen est fauss├®. Les souffrances sur lesquelles son souvenir jette un voile, il les a r├®ellement ├®prouv├®es dans toute leur force, et il ne les fait pas entrer ├Ā leur juste valeur dans le bilan de sa vie. Pour parvenir ├Ā une estimation exacte, il faudrait quŌĆÖau moment de cette estimation lŌĆÖorgueilleux se d├®charge├ót de son orgueil. Il faudrait quŌĆÖil consid├®r├ót son existence pass├®e sans mettre des verres d├®formants. SŌĆÖil ne le fait point, il ressemble au marchand qui, au moment de boucler ses comptes, inscrit sur la page des recettes son z├©le dŌĆÖhomme dŌĆÖaffaires.
Les partisans de la philosophie de Hartmann peuvent dŌĆÖailleurs aller plus loin. Ils peuvent dire : le vaniteux arrivera ├Ā reconna├«tre que les succ├©s quŌĆÖil recherche sont des choses sans valeur. Il en viendra de lui-m├¬me, ou gr├óce aux autres, ├Ā comprendre quŌĆÖun homme sens├® ne se soucie pas de lŌĆÖapprobation de ses semblables, car ┬½dans toutes les questions qui ne sont pas des probl├©mes vitaux de lŌĆÖ├®volution, ou qui nŌĆÖont pas ├®t├® r├®solues une fois pour toutes par la science┬╗, il y a toutes les chances pour que ┬½les majorit├®s aient tort, et les minorit├®s raison┬╗. ┬½Voil├Ā le jugement auquel le vaniteux confie tout le bonheur de sa vie.┬╗. [voir: "Philosophie de lŌĆÖInconscient" par Hartmann]
Lorsque le vaniteux se dit tout cela, il se met ├Ā consid├®rer comme des illusions tout ce que son amour-propre lui avait repr├®sent├® jusquŌĆÖalors comme des r├®alit├®s, et aussi, par suite, les sentiments qui ├®taient li├®s ├Ā ces illusions de son amour-propre. CŌĆÖest pourquoi les partisans de la philosophie dŌĆÖ├ēd. von Hartmann disent : ┬½Il faut rayer du livre de comptes des valeurs de la vie tous les sentiments de joie caus├®s par des illusions ; il ne reste plus alors que la somme des joies non illusoires de la vie, et elle est extr├¬mement petite en regard de la somme des peines ; de sorte que la vie nŌĆÖest pas un bien, et que le non-├¬tre seul est d├®sirable┬╗.
Or, sŌĆÖil est tr├©s vrai que la vanit├®, en tant que passion, intervient pour fausser le r├®sultat du bilan de la vie, il nŌĆÖen est pas moins inadmissible que le caract├©re illusoire de nos joies puisse en d├®truire la valeur. Supprimer du bilan de notre vie tous les plaisirs provoqu├®s par des illusions, r├®elles ou suppos├®es telles, ce serait fausser totalement ce bilan. Car le vaniteux a vraiment eu sa joie ├Ā ├¬tre applaudi par la foule, et peu importe que, plus tard, lui-m├¬me ou un autre reconnaisse le caract├©re illusoire de cette joie. Ce fait post├®rieur ne diminue aucunement la joie quŌĆÖil a ├®prouv├®e. Rayer tous les sentiments illusoires du bilan de la vie, ce nŌĆÖest pas r├®tablir la justesse de ce bilan, cŌĆÖest supprimer de notre estimation des facteurs r├®ellement donn├®s.
Et pourquoi ces sentiments seraient-ils ray├®s ? ├Ć celui qui les ├®prouve, ils procurent une joie. ├Ć celui qui les a domin├®s, ils donnent une joie spiritualis├®e, et non moins intense, non pas celle de se dire : ┬½Quel homme je suis !┬╗ mais les joies objectives r├®elles qui sont contenues en tout progr├©s.
Si on raye du bilan de la vie les sentiments caus├®s par des objets que lŌĆÖexamen r├®v├©le illusoires, alors la valeur de la vie ne d├®pendra plus de la quantit├® de joie ├®prouv├®e, mais de sa qualit├®, et celle-ci sera mesur├®e ├Ā la valeur des objets qui causent la joie. Mais puisquŌĆÖil sŌĆÖagit de d├®terminer la valeur de la vie dŌĆÖapr├©s la quantit├® de joie et de souffrance quŌĆÖelle apporte, nous nŌĆÖavons pas le droit de poser tout dŌĆÖabord un autre facteur dont d├®pend la valeur ou la non-valeur de cette joie. Puisque on dit : Je veux comparer la quantit├® de joies ├Ā la quantit├® de souffrances et voir laquelle est la plus grande, - on doit mettre en ligne de compte toutes les joies et toutes les souffrances, dans leur grandeur r├®elle, sans se pr├®occuper de savoir si elles sont fond├®es sur des illusions. Mais si lŌĆÖon accorde moins de valeur ├Ā une joie fond├®e sur lŌĆÖillusion quŌĆÖ├Ā une joie l├®gitim├®e par la raison, cŌĆÖest que lŌĆÖon fait d├®pendre la valeur de la vie, non plus de la joie, mais de facteurs tout autres.
Dans ce bilan de valeurs, celui qui m├®sestime les joies caus├®es par des objets illusoires ressemble au marchand qui, sur son livre de comptes, diminuerait des trois quarts lŌĆÖimportante recette dŌĆÖune fabrique de jouets, pour la raison que cette fabrique ne fournit que des futilit├®s ├Ā lŌĆÖusage des enfants !
Donc, tant quŌĆÖil sŌĆÖagit de peser et de comparer les quantit├®s respectives de joie et de douleur que nous offre la vie, laissons de c├┤t├® le caract├©re illusoire de certaines de nos joies.
La m├®thode de Hartmann, examen rationnel des quantit├®s de joies et de souffrances que nous offre la vie, nous a amen├®s ├Ā poser le pour et le contre de chaque c├┤t├® de notre livre de comptes, mais comment faire lŌĆÖaddition ? Est-ce aussi ├Ā notre raison de d├®terminer le bilan ?
Un marchand se trompe dans ses comptes lorsque le b├®n├®fice calcul├® ne correspond pas aux biens dont son affaire lui a r├®ellement procur├®, ou va lui procurer la jouissance. De m├¬me, le philosophe se trompe certainement dans son estimation si le surplus de joie ou de souffrance, auquel son raisonnement conclut, nŌĆÖexiste pas r├®ellement pour la sensibilit├® de lŌĆÖhomme.
Je ne veux pas contr├┤ler pour lŌĆÖinstant la conclusion que tirent les pessimistes de leur examen rationnel de la vie. Mais celui qui doit d├®cider sŌĆÖil veut continuer ├Ā vivre, ou non, demandera certainement o├╣ se trouve, dans la r├®alit├®, le surplus de souffrance que ces philosophes ont calcul├®.
Nous avons donc touch├® du doigt le point critique o├╣ la raison se montre impuissante ├Ā d├®terminer, toute seule, le surplus de joie ou de souffrance que pr├®sente la vie, et o├╣ ce surplus devra se manifester dŌĆÖune mani├©re perceptible. Ce nŌĆÖest pas par le concept seul, mais par lŌĆÖ├®troite union du concept et de la perception [voir: chapitre "5. La connaissance du monde" - rechercher "caract├®ristiques de la perception"] que lŌĆÖhomme peut saisir la pleine r├®alit├®. Le marchand, lui aussi, nŌĆÖabandonnera son affaire que si la perte de biens quŌĆÖil constate sur son livre de comptes lui est confirm├®e par des faits. Lorsque ce nŌĆÖest pas le cas, il prie le comptable de recommencer lŌĆÖaddition. CŌĆÖest exactement ce que fera lŌĆÖhomme au sujet de sa vie. Le philosophe peut bien lui prouver que la souffrance est beaucoup plus grande que la joie ; sŌĆÖil ne le ressent pas, il r├®pondra au philosophe : ┬½Vous vous ├¬tes tromp├® dans vos calculs, recommencez-les.┬╗ Au contraire, si une affaire en arrive r├®ellement ├Ā des pertes telles quŌĆÖaucun cr├®dit ne lui soit plus possible, la banqueroute est in├®vitable. De m├¬me, si la quantit├® de souffrance, devient ├Ā une certaine ├®poque de la vie dŌĆÖun homme, si grande quŌĆÖaucun espoir (cr├®dit) ne peut plus lŌĆÖen d├®tourner, il se produit une banqueroute de la vie.
Or, le nombre des suicid├®s est relativement tr├©s petit en regard de la foule de ceux qui continuent courageusement ├Ā vivre. Ceux qui abandonnent la vie ├Ā cause de ses souffrances ne constituent quŌĆÖune infime minorit├®. Que faut-il en conclure ? Ou bien que la quantit├® de souffrance ne surpasse pas la quantit├® de joie, ou bien que ces quantit├®s de souffrance et de joie ne d├®terminent pas la continuation ou la non-continuation de notre vie.
Il est curieux de voir comment le pessimisme de von Hartmann en arrive ├Ā refuser toute valeur ├Ā la vie parce que la souffrance y pr├®domine, et ├Ā affirmer cependant quŌĆÖil est n├®cessaire de la vivre. Cette n├®cessit├® provient de ce que, selon lui, le but divin de lŌĆÖunivers (voir plus haut) ne pourra ├¬tre atteint que gr├óce ├Ā un travail sans tr├¬ve et enti├©rement d├®sint├®ress├® de lŌĆÖhomme. Tant que lŌĆÖhomme est esclave de ses d├®sirs ├®go├»stes, il remplit mal cette t├óche. CŌĆÖest seulement lorsque lŌĆÖexp├®rience et la raison lŌĆÖont convaincu de lŌĆÖimpossibilit├® dŌĆÖassouvir ses ├®go├»stes d├®sirs de jouissance, que lŌĆÖhomme se voue enfin ├Ā son devoir v├®ritable. Le pessimisme pr├®tend ├¬tre, par ce d├®tour, une ├®cole de d├®sint├®ressement. Une ├®ducation bas├®e sur le pessimisme d├®truirait lŌĆÖ├®go├»sme en d├®masquant son inanit├®.
DŌĆÖapr├©s cette mani├©re de voir, le d├®sir de jouissance est un principe fondamental dans la nature humaine. CŌĆÖest seulement lorsque lŌĆÖhomme aper├¦oit lŌĆÖimpossibilit├® de satisfaire ce d├®sir, quŌĆÖil se d├®tourne vers des fins sup├®rieures.
On ne peut dire de ce d├®sint├®ressement prescrit par le pessimisme quŌĆÖil obtienne vraiment un triomphe sur les d├®sirs ├®go├»stes. Les id├®als moraux ne sont, dŌĆÖapr├©s Cette doctrine, assez puissants pour sŌĆÖemparer de notre volont├® que lorsque nous avons compris que nos aspirations ├®go├»stes ne nous m├©nent ├Ā rien.
LŌĆÖ├®go├»sme de lŌĆÖhomme trouve que la joie lui offre ┬½des raisins trop verts┬╗, pour la bonne raison quŌĆÖil ne peut les atteindre ; il se d├®tourne alors de cette proie qui lui ├®chappe, et voue son existence ├Ā des buts d├®sint├®ress├®s. DŌĆÖapr├©s le pessimisme, les id├®als moraux ne sont pas assez forts pour vaincre lŌĆÖ├®go├»sme, mais ils sŌĆÖ├®tablissent sur les ruines de celui-ci, lorsque son caract├©re irr├®alisable a ├®t├® reconnu.
Or, puisquŌĆÖil est dans la nature humaine de d├®sirer la joie et de ne jamais lŌĆÖatteindre, la destruction de toute existence est le seul but raisonnable de cet univers. Et si lŌĆÖon estime que le porteur de toute sa souffrance est Dieu, les hommes nŌĆÖont dŌĆÖautre t├óche que de participer ├Ā la lib├®ration de Dieu. Le suicide de lŌĆÖindividu, loin de coop├®rer ├Ā cette lib├®ration, la retarde. Car Dieu ne peut raisonnablement avoir cr├®├® les hommes que pour les faire coop├®rer ├Ā sa d├®livrance, sans quoi la cr├®ation nŌĆÖaurait aucun but. Et le pessimisme veut lui donner des buts extra-humains. Chacun doit accomplir, dans le grand processus de lib├®ration, son travail particulier. Si je mŌĆÖy soustrais par le suicide, le travail qui mŌĆÖ├®tait attribu├® devra ├¬tre accompli par un autre. Un autre devra supporter ├Ā ma place la torture de vivre. Et comme en chacun de nous Dieu r├®side, le suicid├® nŌĆÖa pas le moins du monde diminu├® la douleur de Dieu, il a, au contraire, occasionn├® ├Ā Dieu la peine suppl├®mentaire de lui cr├®er un rempla├¦ant.
Tout ceci pr├®suppose que la joie est le crit├®rium de la valeur de la vie. La vie se manifeste par une certaine somme de d├®sire (besoins). Si la valeur de la vie d├®pend de la somme de joie ou de souffrance quŌĆÖelle apporte, alors tout d├®sir provoquant un surplus de souffrance est sans valeur. Examinons un peu le d├®sir et la joie, afin de savoir si le premier peut se mesurer ├Ā la seconde. Pour ne pas encourir le reproche de nŌĆÖenvisager la vie quŌĆÖ├Ā partir de lŌĆÖ┬½aristocratie de lŌĆÖesprit┬╗, nous commencerons par examiner un besoin ┬½purement animal┬╗, la faim.
La faim appara├«t lorsque nos organes, pour continuer ├Ā fonctionner selon leur nature, ont besoin dŌĆÖun nouvel apport de nourriture. LŌĆÖaffam├® d├®sire, avant tout, se rassasier. D├©s que lŌĆÖapport de nourriture sŌĆÖest effectu├® dans une mesure suffisante pour que la faim cesse, tout ce que r├®clame le besoin naturel est accompli. La jouissance qui sŌĆÖattache ├Ā la sati├®t├® provient, dŌĆÖune part, de la disparition de la souffrance caus├®e par la faim. Mais, au pur instinct de se nourrir, sŌĆÖajoute un besoin nouveau. LŌĆÖhomme, non content de remettre en ordre ses fonctions troubl├®es, cŌĆÖest-├Ā-dire de combattre la souffrance de la faim, cherche ├®galement ├Ā associer ├Ā cet acte des sensations gustatives agr├®ables. Il arrive m├¬me quŌĆÖayant faim et se trouvant ├Ā une demi-heure dŌĆÖattente dŌĆÖun excellent repas, il ├®vite de se satisfaire imm├®diatement par des mets moins agr├®ables, afin de ne pas g├ócher la jouissance promise. Il se sert de sa faim pour recevoir de son repas une pl├®nitude de jouissance. Par l├Ā, la faim lui devient une occasion de plaisir. Or, si toute la faim contenue dans lŌĆÖunivers pouvait ├¬tre rassasi├®e, on pourrait mesurer la totalit├® de la jouissance dont lŌĆÖunivers est redevable au besoin de nourriture. Il faudrait y ajouter encore le plaisir particulier que sŌĆÖacqui├©rent les gourmets par une culture sp├®ciale de leurs nerfs gustatifs.
Cette somme de jouissance aurait une pleine valeur ├Ā la condition quŌĆÖaucun des besoins concernant cette jouissance ne demeure insatisfait, et ├Ā la condition quŌĆÖune certaine somme de d├®plaisir ne vienne pas forc├®ment sŌĆÖy adjoindre.
La science moderne a ├®tabli que la nature engendre plus de vie quŌĆÖelle ne peut en sustenter, cŌĆÖest-├Ā-dire aussi plus de faim quŌĆÖelle nŌĆÖen peut rassasier. Le surplus de vie qui a ├®t├® engendr├® est donc destin├® ├Ā dispara├«tre parmi les souffrances de la lutte pour lŌĆÖexistence. Admettons que les besoins de la vie soient, ├Ā chaque instant, plus grands que ne le comportent les moyens de satisfaction r├®ellement donn├®s ; la somme g├®n├®rale de joie existante peut ├¬tre diminu├®e. Mais l├Ā o├╣ cette joie existe, dans les cas particuliers o├╣ la satisfaction se r├®alise, elle nŌĆÖen est aucunement amoindrie. L├Ā o├╣ le d├®sir est satisfait, la joie correspondante a sa pleine valeur, m├¬me sŌĆÖil demeure dans le m├¬me ├¬tre ou dans les ├¬tres voisins un grand nombre de besoins inassouvis. Ce qui est diminu├® par ce fait, cŌĆÖest la valeur des joies de la vie. Si les ├¬tres satisfont seulement une part de leurs d├®sirs, ils en re├¦oivent une jouissance proportionn├®e. Cette jouissance a une valeur dŌĆÖautant plus petite quŌĆÖelle est plus petite au regard des exigences totales de la vie, en ce qui concerne cet ordre de d├®sirs. On peut se repr├®senter cette valeur par une fraction dont le num├®rateur est la somme de jouissance r├®ellement donn├®e, et le d├®nominateur, la somme des besoins. La fraction a la valeur 1 lorsque num├®rateur et d├®nominateur sont ├®gaux, cŌĆÖest-├Ā-dire lorsque tous les besoins sont satisfaits. Elle est plus grande que 1 lorsque lŌĆÖ├¬tre vivant re├¦oit plus de jouissance que ses besoins nŌĆÖen comportent. Et elle est plus petite que 1 lorsque la somme des jouissances demeure en de├¦├Ā de la somme des besoins. Cette fraction ne peut jamais devenir nulle, aussi longtemps que son d├®nominateur aura la moindre valeur. QuŌĆÖun homme, avant de mourir, fasse le bilan de sa vie et se repr├®sente la somme des jouissances quŌĆÖil a ├®prouv├®es par la satisfaction de lŌĆÖun de ses besoins, la faim par exemple, en tenant compte de toutes les exigences quŌĆÖelle comporte, cette somme aura peut-├¬tre une valeur minime, mais ne saura jamais avoir une valeur nulle. ├Ć somme ├®gale en ce qui concerne la jouissance ├®prouv├®e, la valeur des joies dŌĆÖun ├¬tre d├®cro├«t ├Ā mesure que ses besoins augmentent ; ceci est valable pour toute vie existante.
Plus le nombre des ├¬tres vivants est grand en proportion du nombre de ceux qui trouvent pleine satisfaction ├Ā leurs besoins, plus la valeur courante des joies de la vie est petite. Que jŌĆÖaie de la nourriture en suffisance pendant trois jours, et quŌĆÖen revanche je doive ensuite je├╗ner pendant trois autres jours, cela ne diminue aucunement la jouissance ├®prouv├®e pendant les trois bons jours. Il me faut seulement repartir cette jouissance sur six jours cons├®cutifs, ce qui diminue de moiti├® sa valeur au regard de mon besoin de nourriture. La grandeur de la joie se comporte de cette m├¬me fa├¦on vis-├Ā-vis du degr├® de mes d├®sirs. Si jŌĆÖai faim de deux tartines de beurre, et que jŌĆÖen re├¦oive une seule, la jouissance ├®prouv├®e de cette seule tartine nŌĆÖa que la moiti├® de la valeur quŌĆÖelle aurait eue si jŌĆÖavais ├®t├® rassasi├® apr├©s lŌĆÖavoir mang├®e. Cet exemple montre bien comment on d├®finit la valeur des joies de la vie. Elle se mesure aux besoins. Nos d├®sirs sont lŌĆÖ├®talon auquel nos joies mesurent leur valeur. La jouissance de se rassasier nŌĆÖa de valeur que parce que la faim existe ; et la grandeur de cette valeur d├®pend de la grandeur de la faim.
Celles de nos exigences que notre destin├®e ne peut remplir jettent une ombre sur la satisfaction de nos d├®sirs, et amoindrissent la valeur de nos heures de jouissance. Mais on peut aussi parler de la valeur pr├®sente dŌĆÖun sentiment de joie. Cette valeur-l├Ā est dŌĆÖautant moins grande que la joie est moins grande en proportion de la dur├®e et de la force du d├®sir.
Pour quŌĆÖun plaisir ait sa pleine valeur, il faut quŌĆÖil ├®gale notre d├®sir en dur├®e et en degr├®. SŌĆÖil est plus petit que le d├®sir, sa valeur sŌĆÖamoindrit ; sŌĆÖil est plus grand, il en r├®sulte un surplus de plaisir qui nŌĆÖa pas ├®t├® d├®sir├®, et qui ne peut ├¬tre agr├®able que si nous arrivons ├Ā augmenter notre d├®sir dans la proportion voulue.
Lorsque nous ne pouvons augmenter notre d├®sir en proportion de notre augmentation de plaisir, ce dernier se change en d├®plaisir. LŌĆÖobjet qui nous e├╗t satisfaits nous assaille sans que nous le voulions, et nous souffrons de le subir. Ceci d├®montre bien que le plaisir nŌĆÖa de valeur pour nous que dans la mesure o├╣ il se proportionne ├Ā notre d├®sir. SŌĆÖil le d├®passe, son exc├©s se transforme en douleur. CŌĆÖest ce qui se remarque particuli├©rement chez les hommes qui ont un besoin minime de certains plaisirs. Par exemple, pour ceux dont lŌĆÖapp├®tit est ├®mouss├®, le plaisir de manger se transforme en d├®go├╗t. Ceci prouve une fois encore que le d├®sir est le crit├®rium de la valeur du plaisir.
Or, le pessimiste pourra dire : la faim inassouvie nŌĆÖam├©ne pas seulement un d├®plaisir par absence de jouissance, mais des souffrances positives, des tortures et des mis├©res. Il rappellera la d├®tresse des malheureux que la faim visite quotidiennement, ├Ā la somme de d├®plaisir que le besoin de nourriture leur procure. Et pour ├®tendre sa d├®monstration aux r├©gnes extra-humains, il rappellera les souffrances des animaux sauvages qui, en certaines saisons, meurent de faim. Le pessimiste estime que ces maux lŌĆÖemportent de beaucoup sur la somme de jouissance provoqu├®e dans lŌĆÖunivers par le besoin de nourriture.
Certes, il est incontestable que lŌĆÖon peut comparer le plaisir au d├®plaisir, et d├®terminer le surplus de lŌĆÖun ou de lŌĆÖautre, comme on ferait pour un gain et une perte. Mais si le pessimisme croit que le surplus est du c├┤t├® du d├®plaisir, et sŌĆÖil en conclut ├Ā la non-valeur de la vie, il se trompe tout dŌĆÖabord en ce sens quŌĆÖil fait une addition qui, dans la vie, nŌĆÖa jamais occasion dŌĆÖ├¬tre faite.
Notre d├®sir converge, en chaque cas particulier, vers un certain objet. La valeur de la satisfaction sera, comme nous lŌĆÖavons vu, dŌĆÖautant plus grande que la somme de plaisir est plus grande en proportion du d├®sir [nota: nous faisons abstraction, ici, du cas o├╣ lŌĆÖexc├©s de plaisir se transforme en souffrance]. CŌĆÖest ├®galement de la grandeur du d├®sir que d├®pend la somme de d├®plaisir au prix de laquelle nous acceptons dŌĆÖacheter le plaisir. Nous comparons ce d├®plaisir, non pas au plaisir lui-m├¬me, mais ├Ā la grandeur de notre d├®sir. LŌĆÖhomme qui a beaucoup de plaisir ├Ā manger se tire beaucoup mieux dŌĆÖune p├®riode de je├╗ne, parce quŌĆÖil se promet la joie de ses repas futurs, que lŌĆÖhomme auquel manque cette facult├® de plaisir. La femme qui veut avoir un enfant ne compare pas la somme de douleurs que cet enfant lui co├╗tera, ├Ā la joie quŌĆÖil lui procurera r├®ellement, mais bien ├Ā la force de son d├®sir dŌĆÖavoir un enfant.
Jamais nous nŌĆÖaspirons ├Ā une joie con├¦ue abstraitement, et de grandeur d├®finie ; nous voulons des satisfactions concr├©tes et particuli├©res. Lorsque nous d├®sirons une joie qui doit nous ├¬tre donn├®e par tel objet ou par telle sensation, nous ne saurions aucunement ├¬tre satisfaits par quelque autre objet ou quelque autre sensation nous apportant une joie de grandeur ├®gale. Celui qui a faim, on ne le contentera pas en rempla├¦ant la joie quŌĆÖil aurait ├Ā manger par lŌĆÖautre joie, tout aussi grande par ailleurs, dŌĆÖune promenade. Si notre d├®sir aspirait seulement ├Ā une quantit├® donn├®e de plaisir, dŌĆÖune fa├¦on toute g├®n├®rale, alors il se tairait d├©s que cette quantit├® de plaisir devrait ├¬tre achet├®e au prix dŌĆÖun d├®plaisir encore plus grand. Mais comme cŌĆÖest toujours une satisfaction dŌĆÖune certaine sorte que nous recherchons, cette satisfaction nous cause de la joie, m├¬me au cas o├╣ elle est achet├®e au prix dŌĆÖun d├®plaisir plus grand quŌĆÖelle. Les d├®sirs des ├¬tres vivants se tendent vers certains buts concrets, et dans certaines directions pr├®cises ; ce fait leur enl├©ve la possibilit├® de mettre en ligne de compte, avec leurs joies, le d├®plaisir au prix duquel ils les ach├©tent. Il suffit que le d├®sir soit assez fort pour exister encore apr├©s quŌĆÖon a triomph├® de ce d├®plaisir, f├╗t-il aussi grand que lŌĆÖon voudra, pour que la satisfaction soit go├╗t├®e encore dans sa pl├®nitude. Le d├®sir nŌĆÖ├®tablit donc pas de rapport direct entre le plaisir atteint et le d├®plaisir subi, mais un rapport indirect seulement, en comparant sa propre force ├Ā celle de ce d├®plaisir.
Il ne sŌĆÖagit pas de savoir si la joie ├Ā atteindre est plus grande ou non que la souffrance ├Ā subir, mais seulement si le d├®sir triomphera de lŌĆÖobstacle que cette souffrance lui oppose. Lorsque lŌĆÖobstacle est plus grand que le d├®sir, celui-ci se rend ├Ā lŌĆÖin├®vitable, se paralyse et sŌĆÖarr├¬te. La sp├®cialisation forc├®e de tous nos d├®sirs conf├©re ├Ā la joie qui en r├®sulte une certaine ind├®pendance ├Ā lŌĆÖ├®gard des souffrances ├Ā franchir, et nous permet de nŌĆÖen tenir compte que dans la mesure o├╣ elles pourraient att├®nuer notre d├®sir. Admettons que je sois un amateur passionn├® de ┬½points de vue┬╗ ; je ne calculerai pas : 1┬░ combien de plaisir me procurera celui dont je jouirai du sommet de la montagne, et 2┬░ combien, en revanche, jŌĆÖaurai eu de peine pour y monter et pour en descendre. Mais je me demanderai si mon d├®sir de voir ce point de vue subsistera apr├©s que jŌĆÖaurai triomph├® de toutes ces difficult├®s. CŌĆÖest seulement par lŌĆÖinterm├®diaire du d├®sir que le plaisir et le d├®plaisir peuvent ├¬tre compar├®s. Il ne sŌĆÖagit donc pas de savoir sŌĆÖil existe au monde plus de plaisir ou plus de d├®plaisir, mais de savoir si la volont├® de jouir est assez forte dans le monde pour triompher du d├®plaisir existant.
Il y a un fait qui prouve la justesse de notre assertion, cŌĆÖest que la valeur dŌĆÖune joie para├«t plus grande lorsque cette joie a ├®t├® ch├©rement achet├®e que lorsquŌĆÖelle tombe sur nous comme un pr├®sent du ciel. En effet, lorsque les souffrances ont ├®mouss├® notre d├®sir et que nous atteignons quand m├¬me notre but, alors notre joie est dŌĆÖautant plus grande en proportion de ce qui nous reste de d├®sir. Cette proportion, nous lŌĆÖavons vu, d├®termine la valeur de la joie. Une autre preuve, cŌĆÖest que les ├¬tres vivants, y compris lŌĆÖhomme, cherchent ├Ā r├®aliser leurs instincts et leurs d├®sirs aussi longtemps quŌĆÖils peuvent supporter les souffrances qui y font obstacle. Et la lutte pour lŌĆÖexistence est la cons├®quence de ce fait. La vie qui existe sŌĆÖefforce de sŌĆÖ├®panouir, et seuls abandonnent le combat les ├¬tres qui ont ├®t├® ├®touff├®s par lŌĆÖexc├©s des difficult├®s pr├®sentes. Aussi, tout ├¬tre vivant cherche ├Ā se nourrir jusquŌĆÖ├Ā ce que le manque de nourriture d├®truise sa vie. Et lŌĆÖhomme ne porte la main sur lui-m├¬me que lorsque, ├Ā tort ou ├Ā raison, il croit ne pas pouvoir atteindre les buts qui, ├Ā ses yeux, donnent un prix ├Ā lŌĆÖexistence. Aussi longtemps quŌĆÖil croit ├Ā la possibilit├® dŌĆÖatteindre ces buts, qui seuls lui semblent dignes dŌĆÖ├¬tre d├®sir├®s, il lutte contre les douleurs de lŌĆÖexistence. Il faudrait quŌĆÖune certaine philosophie v├«nt dire ├Ā lŌĆÖhomme : ┬½Vivre et vouloir nŌĆÖont de sens que si les joies de la vie surpassent ses souffrances┬╗ ; mais la nature lui enseigne, au contraire, ├Ā rechercher les objets de ses d├®sirs et ├Ā supporter tous les d├®plaisirs qui en sont le prix, si grands quŌĆÖils soient. Cette philosophie dŌĆÖailleurs, se tromperait en son assertion, car elle ferait d├®pendre le vouloir de lŌĆÖhomme dŌĆÖun certain terme (surplus de joie ou de douleur) qui est originellement ├®tranger ├Ā lŌĆÖhomme. Le crit├®rium naturel de lŌĆÖhomme, cŌĆÖest le d├®sir, et ce dernier tend ├Ā ses fins aussi longtemps quŌĆÖil le peut. Le bilan quŌĆÖ├®tablit, non plus une philosophie trop rationnelle, mais la vie, entre le plaisir et le d├®plaisir inh├®rents ├Ā la satisfaction dŌĆÖun d├®sir, ressemble ├Ā celui-ci : lorsque achetant une certaine quantit├® de pommes, je me vois oblig├® dŌĆÖen accepter deux fois plus de mauvaises que de bonnes, parce que le marchand veut sŌĆÖen d├®barrasser, je nŌĆÖh├®site pas un instant ├Ā emporter ces mauvaises pommes, pourvu que la petite quantit├® de bonne marchandise me paraisse valoir, en sus de son prix dŌĆÖachat, les frais de d├®placement de la marchandise g├ót├®e. Cet exemple fait comprendre le rapport qui sŌĆÖ├®tablit entre les quantit├®s de plaisir et de d├®plaisir que procure un d├®sir. Je ne d├®termine pas la valeur des bonnes pommes en soustrayant leur somme de celle des mauvaises, mais en ├®tablissant si, malgr├® la pr├®sence de ces derni├©res les pommes intactes conservent encore une valeur.
Pendant la jouissance que me procureront ces pommes intactes, je ne me pr├®occuperai plus des pommes g├ót├®es. De m├¬me, lŌĆÖhomme sŌĆÖadonne pleinement ├Ā la satisfaction de ses d├®sirs apr├©s quŌĆÖil a ├®loign├® le souvenir des souffrances n├®cessaires.
Les moralistes pessimistes, pour inciter les hommes ├Ā participer dŌĆÖune mani├©re d├®sint├®ress├®e au travail de la civilisation, veulent leur prouver quŌĆÖen ce monde la souffrance surpasse la joie ; mais la volont├® humaine est dŌĆÖune nature telle que cette assertion ne la saurait influencer.
Les hommes tendent leurs efforts vers ce qui reste de satisfaction possible apr├©s quŌĆÖils ont ├®cart├® toutes les difficult├®s ; lŌĆÖespoir de cette satisfaction est le fondement des activit├®s humaines ; cŌĆÖest de l├Ā que na├«t tout travail individuel et tout progr├©s de la civilisation. Le pessimisme croit que lŌĆÖhomme ne se voue ├Ā des t├óches morales que si on lui a prouv├® lŌĆÖinanit├® de la ┬½chasse au bonheur┬╗. Mais ces t├óches morales ne sont que des d├®sirs concrets, naturels et spirituels ; et lŌĆÖhomme cherche ├Ā les satisfaire malgr├® la souffrance qui peut en r├®sulter. La ┬½chasse au bonheur┬╗ que le pessimisme d├®conseille ├Ā lŌĆÖhomme, nŌĆÖexiste r├®ellement pas. LŌĆÖhomme remplit ses devoirs parce quŌĆÖil est dans la nature de son ├¬tre de les reconna├«tre et de les vouloir. LŌĆÖ├®thique pessimiste pr├®tend que lŌĆÖhomme ne sŌĆÖadonne ├Ā sa v├®ritable mission que lorsquŌĆÖil a renonc├® ├Ā la joie. Mais aucune ├®thique ne pourra jamais imaginer pour lŌĆÖhomme dŌĆÖautre mission que celle de r├®aliser les satisfactions que r├®clame la nature humaine, et dŌĆÖaccomplir ses id├®als moraux. Aucune ├®thique ne pourra enlever ├Ā lŌĆÖhomme la joie quŌĆÖil ├®prouve de cette r├®alisation de ses d├®sirs. Lorsque le pessimiste lui dit : ┬½Ne recherchez pas la joie, car vous ne sauriez lŌĆÖatteindre, recherchez ce que vous reconnaissez ├¬tre votre devoir┬╗, lŌĆÖhomme peut r├®pondre : ┬½Vous me prescrivez ce qui mŌĆÖest naturel ; la pr├®tendue ┬½chasse au bonheur┬╗ nŌĆÖest quŌĆÖune invention de lŌĆÖ├®garement des philosophes. Je cherche ├Ā satisfaire les exigences de mon ├¬tre, et jŌĆÖai en vue non point un ┬½bonheur┬╗ abstrait, mais les r├®sultats concrets de mes efforts. La r├®alisation de mes exigences me procure de la joie.┬╗ Les buts d├®sint├®ress├®s que propose la morale pessimiste co├»ncident donc avec ce que lŌĆÖhomme veut de par sa nature la plus intime. Il est inutile que la philosophie d├®forme lŌĆÖ├¬tre humain ; il est inutile que lŌĆÖ├¬tre humain rejette sa nature pour devenir moral. La moralit├®, cŌĆÖest la recherche dŌĆÖune fin que lŌĆÖon a reconnue l├®gitime ; il est naturel de la poursuivre tant que les souffrances li├®es ├Ā cette recherche nŌĆÖen ├®moussent pas le d├®sir. CŌĆÖest l├Ā quŌĆÖest lŌĆÖessence de toute volont├® v├®ritable. La moralit├® nŌĆÖest pas un abandon de tout d├®sir de joie, de toute volont├® de vivre, elle nŌĆÖest pas le triomphe des id├®es abstraites ; elle est un vouloir ├®nergique, que sustentent de fortes intuitions id├®elles, et qui, m├¬me par des voies sem├®es dŌĆÖ├®pines, sait atteindre son but.
Les id├®als moraux naissent de lŌĆÖ┬½imagination morale┬╗ de lŌĆÖhomme. Ils se r├®alisent ├Ā la condition que lŌĆÖhomme les d├®sire suffisamment pour triompher de toutes les souffrances. Ils sont ses intuitions, les forces motrices quŌĆÖengendre son esprit. Il les veut parce que leur r├®alisation est sa joie la plus haute. Il nŌĆÖa pas besoin que lŌĆÖ├ēthique lui d├®fende de d├®sirer la joie, et lui ordonne ce quŌĆÖil doit d├®sirer. Il poursuit des id├®als moraux d├©s lŌĆÖinstant o├╣ son imagination morale est assez active pour lui fournir des intuitions ; et, dans ces intuitions, sa volont├® puise la force de franchir tous les obstacles, souvent douloureux, que lui oppose une certaine part de sa nature.
Lorsque lŌĆÖhomme sŌĆÖefforce vers un id├®al dŌĆÖun caract├©re ├®lev├®, cŌĆÖest que cet id├®al est inn├® ├Ā son ├¬tre, et la r├®alisation lui en est une joie infiniment plus grande que ne le sont aux m├®diocres leurs petites satisfactions quotidiennes.
Les id├®alistes, lorsque leur id├®al se transforme en r├®alit├®, connaissent des transports de joie spirituelle.
Pour enlever ├Ā lŌĆÖhomme la joie de ses satisfactions, il faut commencer par en faire un esclave, qui agit non pas parce quŌĆÖil veut, mais parce quŌĆÖil doit. Car lŌĆÖex├®cution de ce quŌĆÖon veut procure de la joie. Ce quŌĆÖon nomme bon nŌĆÖest pas ce que lŌĆÖhomme doit, mais ce quŌĆÖil veut lorsquŌĆÖil ├®panouit en lui-m├¬me la pl├®nitude de sa vraie nature. CŌĆÖest parce quŌĆÖil m├®conna├«t cette v├®rit├® que le pessimisme croit devoir faire oublier ├Ā lŌĆÖhomme ses propres volont├®s, pour lui en prescrire du dehors.
Si lŌĆÖhomme accorde une valeur ├Ā la satisfaction dŌĆÖun d├®sir, cŌĆÖest que ce d├®sir est issu de lui-m├¬me. Sa r├®alisation vaut pour autant quŌĆÖelle a ├®t├® voulue. Lorsque lŌĆÖon d├®pr├®cie les fins de la volont├® humaine, en tant, que telle, on est oblig├® dŌĆÖemprunter des fins valables ├Ā ce que lŌĆÖhomme ne veut pas.
Toute ├®thique ├Ā base pessimiste sŌĆÖexplique par une m├®connaissance de ┬½lŌĆÖimagination morale┬╗. Consid├®rer le d├®sir de joie comme la somme du vouloir humain, cŌĆÖest sous-entendre que lŌĆÖesprit humain est incapable dŌĆÖengendrer de lui-m├¬me les fins de son vouloir. LŌĆÖhomme d├®pourvu dŌĆÖimagination ne cr├®e pas dŌĆÖid├®es morales. Il faut lui en donner. Certes, il satisfait ses besoins inf├®rieurs, car la nature physique sŌĆÖen acquitte. Mais lŌĆÖ├®panouissement de lŌĆÖhomme total exige aussi la pr├®sence de d├®sirs spirituels. LorsquŌĆÖon croit que lŌĆÖhomme nŌĆÖen a pas, on pense quŌĆÖil est n├®cessaire de lui en fournir du dehors. Et lŌĆÖon a ├®galement le droit de lui imposer des devoirs quŌĆÖil ne veut pas. Les morales qui exigent, de la sorte, que lŌĆÖhomme comprime son propre vouloir pour accomplir des devoirs quŌĆÖil ne veut pas, sont des morales qui ne tiennent pas compte de lŌĆÖhomme entier, mais seulement dŌĆÖun homme priv├® de tout d├®sir spirituel. Pour un individu harmonieusement ├®volu├®, les id├®es du bien ne sont pas ext├®rieures ├Ā son ├¬tre, elles sont contenues en lui. LŌĆÖaction morale nŌĆÖest pas dans lŌĆÖaccomplissement dŌĆÖun d├®sir ├®go├»ste, mais dans le d├®veloppement total de la nature humaine. Si lŌĆÖon croit que pour r├®aliser un id├®al moral, lŌĆÖhomme doit tuer ses volont├®s individuelles, cŌĆÖest que lŌĆÖon ignore que cet id├®al est une de ces volont├®s individuelles, et quŌĆÖil le d├®sire aussi bien que la satisfaction de ses besoins animaux.
Nous ne nous dissimulons pas que notre pr├®sente opinion peut pr├¬ter au malentendu. Des hommes imparfaitement m├╗ris, incapables dŌĆÖ┬½imagination morale┬╗ croiront voir dans les instincts de leur demi-nature un vouloir humain complet, et rejetteront toutes les id├®es morales quŌĆÖils nŌĆÖont pas con├¦ues eux-m├¬mes, afin de tranquillement ┬½vivre leur vie┬╗. Il va de soi, que ce qui a ├®t├® dit de lŌĆÖhomme complet ne sŌĆÖapplique pas aux hommes ├Ā moiti├® ├®volu├®s. Il ne faudrait pas que nos assertions fussent ├®tendues ├Ā ceux qui ont encore besoin de toute une ├®ducation pour que leur nature morale perce enfin la coquille de lŌĆÖoeuf, ├Ā savoir, lŌĆÖenveloppe des passions inf├®rieures. Nous nŌĆÖavons pas ├Ā d├®terminer ici ce quŌĆÖil faut enseigner aux hommes non ├®volu├®s, mais ├Ā d├®crire les facult├®s de lŌĆÖhomme moralement ┬½adulte┬╗. Car nous avons ├Ā d├®montrer lŌĆÖexistence de la libert├® ; et celle-ci appara├«t, non pas dans les actions dues ├Ā une n├®cessit├® sensible ou psychique, mais seulement dans les actions que sustente lŌĆÖintuition spirituelle.
Cet homme moralement ┬½adulte┬╗ se donne ├Ā lui-m├¬me sa propre valeur. La joie, il nŌĆÖa pas ├Ā la rechercher, car elle lui est offerte en gr├óce par la nature ou par le Cr├®ateur ; il ne remplit pas un devoir abstrait, reconnu comme tel apr├©s abandon de tout d├®sir de joie. Il agit parce quŌĆÖil veut, dans la mesure de ses intuitions ├®thiques ; et il ├®prouve, dans la r├®alisation de ses volont├®s, la v├®ritable jouissance de sa vie. Il d├®termine la valeur de la vie dŌĆÖapr├©s le rapport de ses d├®sirs ├Ā leur r├®alisation. Les morales qui remplacent le vouloir par le devoir, et lŌĆÖinclination par le commandement, d├®terminent la valeur de la vie dŌĆÖapr├©s le rapport de ce quŌĆÖon doit ├Ā ce quŌĆÖon accomplit. Elles mesurent lŌĆÖhomme ├Ā un ├®talon ext├®rieurement ├®tabli.
LŌĆÖopinion que nous repr├®sentons ici ram├©ne lŌĆÖhomme en lui-m├¬me. La vraie valeur de la vie ne peut ├¬tre, ├Ā nos yeux, que ce que lŌĆÖindividu estime digne dŌĆÖ├¬tre d├®sir├®, et ceci, ├Ā la mesure de son vouloir. Nous rejetons aussi bien toute ┬½valeur de la vie┬╗ que lŌĆÖindividu ne reconna├«trait pas, que nous avons rejet├® pr├®c├®demment toute ┬½fin de la vie┬╗ qui ne serait pas n├®e de la volont├® individuelle. Nous estimons que lŌĆÖindividu, dans son essence et dans son d├®veloppement int├®gral, est ├Ā la fois son propre ma├«tre et le propre juge de sa valeur.
APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
Il est possible que lŌĆÖon m├®connaisse la justesse de ce qui pr├®c├©de, pour peu quŌĆÖon se laisse retenir par lŌĆÖobjection apparente que voici : le vouloir humain, dira-t-on, est pr├®cis├®ment un ├®l├®ment d├®raisonnable. Il faut d├®masquer cette d├®raison, nous nous apercevrons d├©s lors que tout progr├©s moral consiste ├Ā nous d├®livrer du vouloir. Cette objection apparente mŌĆÖa ├®t├® faite par une personnalit├® de valeur, qui mŌĆÖa dit : ┬½Le r├┤le du philosophe est pr├®cis├®ment dŌĆÖ├®tablir ce que ne fait ni lŌĆÖanimal, ni la majorit├® des humains : le bilan r├®el des valeurs de la vie┬╗. Cette objection nŌĆÖest possible que si lŌĆÖon ferme les yeux sur le point capital de la question : lorsque la libert├® doit se r├®aliser, il faut que la volont├® humaine soit support├®e par la pens├®e intuitive ; mais il appert quŌĆÖun vouloir peut ├¬tre d├®termin├® par autre chose que par lŌĆÖintuition ; et seule la libre r├®alisation de lŌĆÖintuition, qui jaillit de la nature humaine, donne naissance ├Ā la valeur morale des actions. LŌĆÖindividualisme ├®thique conf├©re ├Ā la morale sa pleine valeur et toute sa dignit├®. Il nous d├®clare moraux, non pas lorsque nous ├®tablissons un accord tout ext├®rieur de notre vouloir avec une norme, mais lorsque notre volont├® ├®thique est devenue un membre constitutif de notre ├¬tre, au point que toute action immorale nous para├«trait une ali├®nation et une infirmit├® de notre personne.
14. LŌĆÖindividualit├® et lŌĆÖesp├©ce
Il y a une contradiction apparente entre lŌĆÖid├®al dŌĆÖune individualit├® humaine compl├©te par elle-m├¬me et libre, et le fait que tout homme appartient ├Ā des collectivit├®s (race descendance, famille, sexe) et agit au sein de groupements (├ētat, ├ēglise). LŌĆÖ├¬tre humain porte toujours les caract├©res g├®n├®raux du groupe dont il fait partie, et ses agissements sont d├®termin├®s par la place quŌĆÖil occupe au milieu de ses semblables.
LŌĆÖindividualit├® est-elle encore possible dans ces conditions-l├Ā ? Est-il permis de nommer lŌĆÖhomme un tout, alors quŌĆÖil semble ├¬tre la ramification dŌĆÖ├¬tres plus grands, auxquels il sŌĆÖincorpore ?
En qualit├® de membre dŌĆÖun groupe, lŌĆÖhomme est d├®termin├® par ce groupe quant ├Ā ses qualit├®s et quant ├Ā ses fonctions. LŌĆÖarbre de descendance dŌĆÖun peuple, par exemple, constitue un tout, et les hommes qui sŌĆÖy rattachent ont des mani├©res dŌĆÖ├¬tre conditionn├®es par ce tout. Leurs physionomies et leurs actes individuels prennent un aspect sp├®cifique. LorsquŌĆÖon cherche ├Ā sŌĆÖexpliquer telle ou telle mani├©re dŌĆÖ├¬tre de ces hommes, on est ramen├® de lŌĆÖindividu ├Ā lŌĆÖesp├©ce.
Mais lŌĆÖhomme se lib├©re de ces caract├©res sp├®cifiques. LorsquŌĆÖil en tient compte dŌĆÖune fa├¦on normale, ils cessent dŌĆÖ├¬tre des entraves ├Ā sa libert├® ; il ne faut pas quŌĆÖils le deviennent par des institutions artificielles. LŌĆÖhomme d├®veloppe, de lui-m├¬me, certaines qualit├®s, et accomplit certaines fonctions, dont lŌĆÖimpulsion premi├©re nŌĆÖest quŌĆÖen lui. Les caract├©res sp├®cifiques ne lui sont que des moyens gr├óce auxquels il arrive ├Ā exprimer son entit├® personnelle. Il utilise les particularit├®s groupales, que lui a donn├®es la nature, comme une mati├©re quŌĆÖil fa├¦onne dŌĆÖapr├©s les tendances de son ├¬tre le plus intime. Ce serait en vain quŌĆÖon chercherait dans les lois de lŌĆÖesp├©ce de quoi expliquer les manifestations de cet ├¬tre intime. Nous avons affaire ├Ā un individu qui ne se peut expliquer que par lui-m├¬me, et si nous nous ├®vertuons ├Ā lŌĆÖexpliquer par lŌĆÖesp├©ce, cŌĆÖest que nous nŌĆÖavons pas le sens de lŌĆÖindividuel.
Il est impossible de comprendre enti├©rement un homme tant que lŌĆÖon sŌĆÖobstine ├Ā partir de lŌĆÖesp├©ce. Cette obstination se montre particuli├©rement accentu├®e lorsquŌĆÖil sŌĆÖagit du sexe dŌĆÖun ├¬tre humain.
Dans la femme, lŌĆÖhomme aper├¦ois surtout les caract├©res g├®n├®raux du sexe oppos├®s au sien, et fort peu les caract├©res individuels ; la femme fait de m├¬me pour lŌĆÖhomme. Dans la vie pratique, cela nuit plus aux femmes quŌĆÖaux hommes. Si la situation sociale de la femme est si indigne, cŌĆÖest quŌĆÖelle est d├®termin├®e, sous bien des rapports, non pas, comme il devrait ├¬tre, par les qualit├®s individuelles des femmes en particulier, mais par les id├®es g├®n├®rales que lŌĆÖon se fait des besoins et des devoirs naturels de la femme. Tandis que les occupations dŌĆÖun homme sont orient├®es dŌĆÖapr├©s ses capacit├®s et ses go├╗ts personnels, on voudrait que celles dŌĆÖune femme d├®pendissent uniquement du fait quŌĆÖelle est femme. La femme doit ├¬tre esclave de lŌĆÖesp├©ce, de la collectivit├® f├®minine. Tant que les hommes discuteront pour savoir si ┬½la nature┬╗ de la femme la pr├®dispose ├Ā certaines fonctions, la question f├®ministe en restera au stade le plus primitif. QuŌĆÖon laisse aux femmes le soin de juger de ce que ┬½leur nature┬╗ leur permet de faire et de vouloir. SŌĆÖil est vrai quŌĆÖelles ne sont bonnes quŌĆÖ├Ā la fonction quŌĆÖon leur a jusquŌĆÖ├Ā pr├®sent assign├®e, elles nŌĆÖarriveront certes pas ├Ā en atteindre dŌĆÖautres. On craint un ├®branlement de lŌĆÖordre social actuel, au cas o├╣ les femmes cesseraient dŌĆÖ├¬tre trait├®es comme membres de lŌĆÖesp├©ce, pour devenir des individus. Mais un ordre social au sein duquel la moiti├® de lŌĆÖhumanit├® m├©ne une existence indigne dŌĆÖelle-m├¬me, a pr├®cis├®ment grand besoin d ├¬tre am├®lior├®. [nota: d├©s la parution de ce livre (1894) on mŌĆÖa object├® que la femme peut d├®velopper sa vie individuelle au sein m├¬me de ses attributions sp├®cifiques, et beaucoup plus librement que lŌĆÖhomme auquel le coll├©ge, lŌĆÖarm├®e et les fonctions sociales enl├©vent son individualit├®. Je sais que cette remarque aurait aujourdŌĆÖhui plus de force que jamais. Mais je laisse les lignes ci-dessus : jŌĆÖesp├©re quŌĆÖil y aura des lecteurs pour comprendre que lŌĆÖobjection cit├®e se heurte au concept de la libert├® tel quŌĆÖil a ├®t├® d├®fini dans ce livre, et pour juger mon expos├® dŌĆÖapr├©s tout autre chose que dŌĆÖapr├©s lŌĆÖinfluence anti-individuelle quŌĆÖexercent sur lŌĆÖhomme le coll├©ge, lŌĆÖarm├®e et les fonctions sociales]
Celui qui juge des hommes dŌĆÖapr├©s leurs caract├©res sp├®cifiques sŌĆÖarr├¬te, pr├®cis├®ment, ├Ā la limite au del├Ā de laquelle ils commencent ├Ā ├¬tre des personnes dont lŌĆÖactivit├® est librement d├®termin├®e. Ce qui se trouve au-dessous de cette limite peut, naturellement, ├¬tre objet de science. ├ētudier les qualit├®s des races, des peuples, des sexes, cŌĆÖest le r├┤le de certaines sciences pr├®cises. Mais, pour pouvoir se reconna├«tre dans lŌĆÖimage g├®n├®rale de lŌĆÖhomme que ces sciences ont trac├®e, il faudrait se d├®cider ├Ā ne plus ├¬tre quŌĆÖun exemplaire de son esp├©ce. Elles ne p├®n├©trent pas jusquŌĆÖau contenu particulier de lŌĆÖ├¬tre individuel. L├Ā o├╣ commence le domaine de la libert├® (pens├®e et action), les lois de lŌĆÖesp├©ce cessent dŌĆÖ├¬tre d├®terminantes. LŌĆÖintuition conceptuelle, par laquelle la pens├®e de lŌĆÖhomme sŌĆÖunit ├Ā la perception, pour saisir la r├®alit├® int├®grale, nŌĆÖest pas une chose quŌĆÖon puisse fixer une fois pour toutes et laisser toute faite ├Ā la post├®rit├®. LŌĆÖindividu doit acqu├®rir ses concepts par son intuition propre. La mani├©re dont il pense ne se peut d├®duire dŌĆÖaucune loi sp├®cifique, mais seulement de sa propre personnalit├®. De m├¬me, il est impossible de d├®duire des caract├©res g├®n├®raux de lŌĆÖhumanit├® les buts concrets quŌĆÖun homme va proposer ├Ā sa volont├®. Pour comprendre lŌĆÖindividu, il faut non point sŌĆÖen tenir ├Ā juger de ses propri├®t├®s typiques, mais entrer dans lŌĆÖ├®tude de son entit├® particuli├©re. En ce sens, chaque ├¬tre humain est un probl├©me ; et toute la science, avec ses conceptions abstraites et g├®n├®rales, nŌĆÖest quŌĆÖune pr├®paration ├Ā la connaissance plus profonde qui nous ├®choit lorsquŌĆÖun homme nous communique sa mani├©re dŌĆÖenvisager lŌĆÖunivers, dŌĆÖune part, et les buts quŌĆÖil propose ├Ā sa volont├®, dŌĆÖautre part.
Lorsque nous sentons quŌĆÖun homme est lib├®r├® de tout mode collectif de pens├®e, et de tout vouloir sp├®cifique, alors il nous faut, pour le comprendre, ├®viter de puiser aucun concept ├Ā notre propre esprit. En effet, la connaissance consiste en une union du concept et de la perception, union effectu├®e par la pens├®e. Pour tous les autres objets de perception, lŌĆÖobservateur doit puiser le concept en lui-m├¬me. Mais pour comprendre une libre individualit├®, il ne sŌĆÖagit plus que de recevoir en notre esprit les concepts m├¬mes de cette individualit├®, dŌĆÖapr├©s lesquels elle d├®termine son vouloir, et de les recevoir dans toute leur puret├®, sans y rien m├¬ler qui vienne de nous. Les gens qui, pour juger les autres, emploient leurs propres concepts, nŌĆÖarriveront jamais ├Ā la compr├®hension dŌĆÖune individualit├®. De m├¬me que lŌĆÖindividu se lib├©re des caract├©res de lŌĆÖesp├©ce, la connaissance de lŌĆÖindividu doit se lib├®rer des m├®thodes qui servent ├Ā comprendre lŌĆÖesp├©ce.
CŌĆÖest seulement dans la mesure o├╣ lŌĆÖhomme a accompli cette lib├®ration, quŌĆÖil peut se compter au rang de libre esprit dans la collectivit├® humaine. Nul nŌĆÖappartient enti├©rement ├Ā lŌĆÖesp├©ce, et nul nŌĆÖest un pur individu. Mais chaque homme lib├©re, peu ├Ā peu, une part de plus en plus large de son ├¬tre, soit des entraves de la vie sp├®cifique et animale, soit des commandements et de lŌĆÖinfluence des autorit├®s humaines.
Quant ├Ā la part de lui-m├¬me que lŌĆÖhomme nŌĆÖa pas lib├®r├®e de la sorte, elle sŌĆÖincorpore ├Ā des organismes naturels ou spirituels ; par elle, lŌĆÖhomme se laisse vivre ├Ā la fa├¦on dont il voit vivre ses semblables, ou ├Ā la fa├¦on dont ils le lui ordonnent. Seule, la part de son activit├® qui ├®mane de ses propres intuitions a une valeur vraiment ├®thique. Les instincts moraux, quŌĆÖil poss├©de par h├®r├®dit├®, deviennent ├®thiques lorsquŌĆÖil les fait p├®n├®trer jusquŌĆÖen ses intuitions. Toute lŌĆÖactivit├® morale de lŌĆÖhumanit├® provient donc dŌĆÖintuitions ├®thiques individuelles, et de leur r├®ception dans les collectivit├®s. Autrement dit : la vie morale de lŌĆÖhumanit├® est la somme des imaginations morales engendr├®es par les libres individualit├®s. Telle est la conclusion du monisme.
DERNIERS PROBL├łMES
15. Les cons├®quences du monisme
LŌĆÖexplication unitaire du monde, - autrement dit le monisme, tel que nous lŌĆÖavons expos├® dans cet ouvrage, - emprunte ├Ā lŌĆÖexp├®rience humaine les principes dont il a besoin pour la compr├®hension de lŌĆÖunivers. Il cherche ├®galement les sources de lŌĆÖaction humaine, sans sortir du champ de notre observation, dans ce que notre propre nature a dŌĆÖaccessible ├Ā lŌĆÖintrospection, ├Ā savoir, dans lŌĆÖimagination morale. Ce monisme se refuse ├Ā ├®chafauder, par des sp├®culations abstraites, en dehors du monde que la perception et la pens├®e nous pr├®sentent, les principes fondamentaux qui le soutiennent. Pour le monisme, lŌĆÖunit├® que lŌĆÖobservation pensante, telle que nous pouvons tous la pratiquer, ├®tablit parmi la multiplicit├® complexe des perceptions, est en m├¬me temps celle que r├®clame la soif de connaissance de lŌĆÖhomme, et celle par laquelle il sŌĆÖefforce de p├®n├®trer dans le domaine physique comme dans le domaine spirituel. Chercher une autre unit├®, cŌĆÖest m├®conna├«tre lŌĆÖidentit├® de ce que r├®clame notre soif de connaissance et de ce que trouve notre pens├®e. LŌĆÖindividu humain, nŌĆÖest pas s├®par├®, en fait, du reste de lŌĆÖunivers. Il est une partie de lŌĆÖunivers, et il existe entre toutes les parties de lŌĆÖunivers une solidarit├® qui nŌĆÖest rompue que pour notre perception. Cette partie que nous sommes, nous croyons tout dŌĆÖabord quŌĆÖelle m├©ne une existence ind├®pendante de lŌĆÖunivers, parce que nous nŌĆÖapercevons pas les rouages par lesquels le cours de notre vie se relie aux forces fondamentales du cosmos. LorsquŌĆÖon en reste ├Ā ce point de vue, on consid├©re cette partie de lŌĆÖunivers comme un tout existant ind├®pendamment du reste, comme une ┬½monade┬╗, qui re├¦oit des nouvelles du dehors par telle ou telle m├®thode. Le monisme expos├® dans cet ouvrage montre que lŌĆÖon cesse de croire ├Ā cette ind├®pendance d├©s que lŌĆÖon ins├©re le r├®sultat de ses perceptions dans le r├®seau du monde des concepts. D├©s Que cet acte est accompli, le morcellement se r├®v├©le comme une simple illusion de la perception. LŌĆÖhomme ne peut saisir son existence int├®grale et compl├©te au sein de lŌĆÖunivers que gr├óce ├Ā lŌĆÖexp├®rience intuitive de la pens├®e. La pens├®e an├®antit lŌĆÖapparence morcel├®e de la perception, et ins├©re notre existence individuelle dans la vie du cosmos. LŌĆÖunit├® du monde des concepts, qui contient les perceptions objectives, contient ├®galement notre personnalit├® subjective. La pens├®e nous livre la v├®ritable forme de la r├®alit├®, cŌĆÖest-├Ā-dire une unit├® parfaite, tandis que la multiplicit├® des perceptions nŌĆÖest quŌĆÖune apparence conditionn├®e par notre organisation. Remplacer la connaissance de lŌĆÖillusion par celle de la r├®alit├®, ce fut de tout temps le but de la pens├®e humaine. La science sŌĆÖeffor├¦a dŌĆÖacc├®der ├Ā la r├®alit├® des perceptions en d├®couvrant entre elles des rapports r├®guliers. Mais ceux qui estimaient que les rapports transmis par la pens├®e humaine nŌĆÖavaient quŌĆÖune valeur subjective, cherch├©rent la base dŌĆÖune v├®ritable unit├® dans quelque objet situ├® au del├Ā de notre exp├®rience (divinit├® suppos├®e, volont├®, esprit absolu, etc.). Et, partant de cette conviction, ils sŌĆÖefforc├©rent dŌĆÖajouter ├Ā la science des rapports connaissables (trouv├®s dans le champ de lŌĆÖexp├®rience) une seconde connaissance, qui devait d├®passer lŌĆÖexp├®rience, et d├®couvrir les rapports de celle-ci avec les entit├®s m├®taphysiques inconnaissables (inaccessibles ├Ā lŌĆÖexp├®rience, mais trouv├®es par sp├®culation logique). On crut alors que si notre pens├®e, bien conduite, nous permet de comprendre le fonctionnement de lŌĆÖunivers, cŌĆÖest quŌĆÖune entit├® originelle a construit cet univers dŌĆÖapr├©s les lois de la logique ; et lŌĆÖon voulut placer les sources de lŌĆÖaction humaine dans la volont├® de cette entit├® originelle. On ne sŌĆÖapercevait pas que la pens├®e embrasse ├Ā la fois le subjectif et lŌĆÖobjectif, et que par la r├®union de la perception au concept, la r├®alit├® totale nous est livr├®e. Certes, tant que nous consid├®rons seulement lŌĆÖordonnance int├®rieure des perceptions sous la forme abstraite du concept, nous avons affaire ├Ā quelque chose de subjectif. Mais le contenu du concept, que nous unissons ├Ā la perception, nŌĆÖest pas subjectif. Ce contenu nŌĆÖest pas puis├® au sujet, mais ├Ā la r├®alit├®. Il est la partie de la r├®alit├® que la perception ne saurait atteindre. Il est une exp├®rience, mais une exp├®rience qui ne nous parvient point par la voie de la perception. Ceux qui nŌĆÖarrivent pas ├Ā se repr├®senter que le concept est une chose r├®elle, ne pensent quŌĆÖ├Ā la forme abstraite quŌĆÖils en gardent dans leur esprit.
Mais le concept, comme la perception, nŌĆÖexiste sous cette forme abstraite et isol├®e que pour et par notre organisation humaine. Cet arbre, que je per├¦ois, nŌĆÖa, si je lŌĆÖisole, aucune existence. Il nŌĆÖest quŌĆÖun rouage de la grande machine naturelle et son existence nŌĆÖest possible quŌĆÖen rapport r├®el avec toute la nature. De m├¬me un concept abstrait nŌĆÖa, en soi, aucune r├®alit├®, et une perception prise ├Ā part nŌĆÖen a pas davantage. La perception est la partie de la r├®alit├® qui nous est offerte objectivement, et le concept est la partie de la r├®alit├® qui nous est offerte subjectivement (par intuition) [voir: chapitre "5. La connaissance du monde" - rechercher "Nous appellerons intuition la forme"]. Notre conformation spirituelle divise la r├®alit├® en deux facteurs, dont lŌĆÖun appara├«t ├Ā la perception, lŌĆÖautre, ├Ā lŌĆÖintuition. La pleine r├®alit├®, cŌĆÖest lŌĆÖunion de deux facteurs, la perception r├®int├®gr├®e par la pens├®e dans lŌĆÖaccord universel. Seule, la perception ne constitue point une r├®alit├®, mais un chaos d├®pourvu de toute harmonie interne. Seuls, les rapports d├®couverts au sein des perceptions ne constituent quŌĆÖun ensemble de concepts abstraits. Ce nŌĆÖest pas le concept abstrait qui contient la r├®alit├®, mais cŌĆÖest lŌĆÖobservation pensante, laquelle ne consid├©re dŌĆÖune mani├©re unilat├®rale ni le concept isol├®, ni la perception isol├®e, mais le rapport de ces deux termes. LŌĆÖid├®alisme le plus orthodoxe ne saurait aller jusquŌĆÖ├Ā nier que nous vivons dans la r├®alit├® (que nous y plongeons les racines de notre existence r├®elle). Il doute seulement que notre connaissance puisse atteindre (id├®ellement) cette base r├®elle de notre vie. Le monisme, au contraire, montre que la pens├®e nŌĆÖest ni subjective, ni objective, mais quŌĆÖelle embrasse les deux c├┤t├®s de la r├®alit├®. Lorsque nous pratiquons lŌĆÖobservation pensante, nous accomplissons un acte qui rentre dans la s├®rie des ph├®nom├©nes r├®els. Nous triomphons, dans lŌĆÖexp├®rience m├¬me, du caract├©re unilat├®ral de la simple perception. Ce ne sont point nos hypoth├©ses abstraites (r├®flexion purement conceptuelle) qui peuvent nous faire deviner lŌĆÖessence de la r├®alit├®, mais, lorsque nous trouvons les id├®es correspondantes ├Ā nos perceptions, nous vivons dans la r├®alit├®. Le monisme ne cherche pas ├Ā ajouter ├Ā lŌĆÖexp├®rience une r├®alit├® non-exp├®rimentale (au-del├Ā) ; il voit dans lŌĆÖunion du concept et de la perception toute la r├®alit├®. Il ne construit pas avec de purs concepts une m├®taphysique abstraite, parce quŌĆÖil consid├©re le concept en soi comme un seul cot├® de la r├®alit├®, le c├┤t├® que la perception nŌĆÖatteint pas, et qui ne prend sa signification quŌĆÖen rapport avec la perception. Le monisme inspire ├Ā lŌĆÖhomme la conviction quŌĆÖil vit dans la r├®alit├® elle-m├¬me, et quŌĆÖil nŌĆÖa point ├Ā la chercher dans un domaine ext├®rieur ├Ā son univers, dans un monde sup├®rieur et inconnaissable. Il se refuse ├Ā situer la r├®alit├® absolue autre part que dans lŌĆÖexp├®rience, parce quŌĆÖil la reconna├«t dans le contenu m├¬me de lŌĆÖexp├®rience. Et cette r├®alit├®-l├Ā le satisfait enti├©rement, parce quŌĆÖil sait que la pens├®e a la force de la cautionner. Ce que le, dualisme cherche derri├©re le monde de lŌĆÖobservation, le monisme le trouve en celui-ci. Le monisme montre que notre connaissance appr├®hende la r├®alit├® sous sa forme v├®ritable, et non pas une image subjective qui sŌĆÖinterpose entre la r├®alit├® et lŌĆÖhomme. Au regard du monisme, le contenu conceptuel de lŌĆÖunivers est le m├¬me pour tous les hommes [voir: chapitre "5. La connaissance du monde" - rechercher "caract├®ristiques de la perception"]. Un individu humain en consid├©re un autre comme son semblable, parce que cŌĆÖest le m├¬me fonds universel qui se manifeste en eux. Il nŌĆÖy a pas, dans le monde unitaire des concepts, autant de concepts de ┬½lion┬╗ quŌĆÖil y a dŌĆÖindividus qui pensent le lion. Il nŌĆÖy a quŌĆÖun concept de lion. Et le concept que A ajoute ├Ā la perception dŌĆÖun lion est le m├¬me que celui de B, il est simplement con├¦u par un autre sujet percepteur [voir: chapitre "5. La connaissance du monde" - rechercher "caract├®ristiques de la perception"]. La pens├®e conduit tous les sujets percepteurs ├Ā contempler lŌĆÖunit├® id├®elle qui se trouve au fond de la multiplicit├®. Comme cette unit├® id├®elle se manifeste ├Ā travers la pluralit├® de leurs individus, tant que lŌĆÖhomme prend conscience de lui-m├¬me par lŌĆÖauto-perception, il se consid├©re comme un individu particulier, mais, d├©s quŌĆÖil se tourne vers le monde dŌĆÖid├®es qui sŌĆÖ├®claire en lui, et qui supprime toute s├®parativit├®, il voit r├®gner en lui le r├®el absolu. Le dualisme d├®finit sous le nom dŌĆÖ├¬tre primordial, dŌĆÖ├¬tre divin, lŌĆÖessence qui p├®n├©tre toutes les personnes humaines et qui vit en elles toutes. Le monisme trouve cette essence commune et divine dans la r├®alit├® m├¬me ; car le tr├®sor id├®el de nŌĆÖimporte quel autre homme est ├®galement le mien, et si cet autre homme est diff├®rent de moi tant que je per├¦ois, il est identique ├Ā moi d├©s que je pense. Chaque homme, en pensant, nŌĆÖembrasse quŌĆÖune partie du monde id├®el total, et cela cr├®e une diff├®rence de fait entre les contenus id├®els des individus. Mais ces contenus forment ├Ā eux tous un monde complet et unique. CŌĆÖest donc dans la pens├®e que lŌĆÖhomme peut se saisir de lŌĆÖ├¬tre originel commun qui p├®n├©tre tous les hommes. LŌĆÖunion de lŌĆÖ├¬tre pensant avec la r├®alit├® peut ├¬tre nomm├®e la vie en Dieu. LŌĆÖau-del├Ā quŌĆÖon ├®tablit par des sp├®culations, et que lŌĆÖon croit inaccessible ├Ā lŌĆÖexp├®rience, r├®sulte de lŌĆÖaberration de ceux qui ont cru que lŌĆÖexistence imm├®diate ne porte pas en elle son principe r├®el. Ceux-l├Ā ne se sont pas aper├¦us que cŌĆÖ├®tait la pens├®e qui leur procurait ce dont ils avaient besoin pour expliquer les perceptions. CŌĆÖest pourquoi lŌĆÖon nŌĆÖa jamais vu une philosophie sp├®culative fournir des principes qui ne fussent pas emprunt├®s ├Ā la r├®alit├® qui nous est donn├®e. La divinit├® que lŌĆÖon obtient par sp├®culation nŌĆÖest quŌĆÖune transposition de lŌĆÖhomme dans lŌĆÖau-del├Ā ; - la volont├® de Schopenhauer nŌĆÖest que la force volontaire de lŌĆÖhomme mise ├Ā lŌĆÖ├®tat absolu ; - lŌĆÖ├¬tre originel de Hartmann, compos├® de lŌĆÖId├®e et de la Volont├®, nŌĆÖest quŌĆÖune abstraction tir├®e de lŌĆÖexp├®rience. On peut en dire autant de tous les autres principes m├®taphysiques, tant quŌĆÖils ne reposent pas sur lŌĆÖexp├®rience de la pens├®e.
En r├®alit├®, lŌĆÖesprit humain ne sŌĆÖ├®vade jamais de lŌĆÖunivers dans lequel il vit, et il nŌĆÖa aucun besoin dŌĆÖen sortir, puisque cet univers contient tout ce qui est n├®cessaire ├Ā sa propre explication. Si les philosophes se d├®clarent satisfaits de principes quŌĆÖils empruntent ├Ā lŌĆÖexp├®rience, quŌĆÖils transportent dans un au-del├Ā hypoth├®tique, et dont ils font d├®couler lŌĆÖunivers, il nous est ├®galement possible de nous d├®clarer satisfaits en laissant ces principes dans lŌĆÖunivers lui-m├¬me, o├╣ notre pens├®e a la possibilit├® de les trouver. Toute ├®vasion de lŌĆÖesprit hors de cet univers nŌĆÖest quŌĆÖapparente, et les principes ext├®rioris├®s de la sorte nŌĆÖexpliquent pas mieux lŌĆÖunivers que des principes inclus en lui. DŌĆÖailleurs, la pens├®e, lorsquŌĆÖelle comprend bien sa fonction, nŌĆÖaspire aucunement ├Ā sŌĆÖ├®vader du monde, car cŌĆÖest en lui, et non hors de lui, quŌĆÖelle doit trouver les perceptions auxquelles elle peut sŌĆÖunir pour engendrer le r├®el. M├¬me les objets de lŌĆÖimagination ne peuvent se l├®gitimer que lorsquŌĆÖils deviennent des repr├®sentations relatives ├Ā certaines perceptions. CŌĆÖest par leur contenu perceptible quŌĆÖils sŌĆÖins├©rent dans la r├®alit├®. Un concept que lŌĆÖon croit repr├®sentatif dŌĆÖune r├®alit├® situ├®e hors du monde donn├®, nŌĆÖest quŌĆÖune abstraction qui ne correspond ├Ā rien. Nous ne pouvons trouver en notre esprit que les concepts, de la r├®alit├® ; pour trouver la r├®alit├® elle-m├¬me, il faut que nous en ayons, de plus, la perception. Une pens├®e consciente dŌĆÖelle-m├¬me se refusera toujours ├Ā admettre des principes universels purement sp├®culatifs. Ce nŌĆÖest pas que le monisme nie la valeur de lŌĆÖ├®l├®ment id├®el ; bien au contraire, il le croit indispensable pour compl├®ter la demi-r├®alit├® des perceptions. Mais dans tout le domaine de la pens├®e, il ne trouve rien qui n├®cessite une ├®vasion au del├Ā de ce domaine, et qui en fasse m├®conna├«tre la r├®alit├® spirituelle objective. Le monisme estime que la science demeure incompl├©te tant quŌĆÖelle se borne ├Ā d├®crire les perceptions sans parvenir ├Ā leur compl├®ment id├®el. Mais il d├®clare ├®galement incompl├©te toute abstraction conceptuelle qui ne trouve pas son ach├©vement dans la perception, et qui ne sŌĆÖins├©re pas quelque part dans le r├®seau de concepts qui enveloppe lŌĆÖunivers perceptible. Il nŌĆÖadmet donc point dŌĆÖid├®es relatives ├Ā un monde objectif situ├® au del├Ā de notre exp├®rience, et destin├®es ├Ā fonder une m├®taphysique hypoth├®tique. Toutes les id├®es de cette sorte que lŌĆÖhumanit├® a enfant├®es, ne sont que des abstractions tir├®es de lŌĆÖexp├®rience, des emprunts dont les philosophes ne se sont pas rendu compte.
Quant aux buts de lŌĆÖaction humaine, ils ne peuvent pas davantage, au regard du monisme, d├®couler dŌĆÖune sph├©re extra-humaine. Dans la mesure o├╣ ces buts sont pens├®s, ils doivent na├«tre de lŌĆÖintuition humaine. LŌĆÖindividu nŌĆÖaccepte pas les buts dŌĆÖune entit├® objective extra-humaine, mais il r├®alise ses propres fins qui lui sont donn├®es par lŌĆÖimagination morale. LŌĆÖid├®e qui se r├®alise en une action a ├®t├® prise, par lŌĆÖhomme, au monde unitaire des id├®es, et mise ├Ā la base de son vouloir individuel. Ce ne sont donc pas les commandements dict├®s par lŌĆÖau-del├Ā qui se r├®alisent dans lŌĆÖaction humaine, mais les intuitions humaines appartenant ├Ā notre propre monde. Le monisme nŌĆÖadmet point de gouverneur universel qui nous impose ses fins et ses directives, si ce nŌĆÖest nous-m├¬mes. LŌĆÖhomme ne trouve point dŌĆÖ┬½├¬tre primordial┬╗ dont il puisse ├®tudier les intentions pour apprendre dans quel sens il doit orienter ses actions. Le monisme le ram├©ne en lui-m├¬me. Il faut que lui-m├¬me d├®termine ses actions. CŌĆÖest en vain quŌĆÖil chercherait, hors du monde dans lequel il vit, des motifs qui les d├®terminent. D├©s quŌĆÖil d├®passe la simple satisfaction de ses app├®tits, auxquels la nature pourvoit, il lui faut chercher les buts, de ses actions dans sa propre imagination morale, ├Ā moins que, par nonchalance, il ne se les laisse dicter par lŌĆÖimagination morale des autres ; cŌĆÖest-├Ā-dire que, sŌĆÖil ne renonce pas ├Ā toute esp├©ce dŌĆÖaction, il lui faut ob├®ir ├Ā des motifs quŌĆÖil a puis├®s dans le monde des id├®es ou que dŌĆÖautres y ont puis├®s pour lui. D├®passe-t-il la satisfaction de ses app├®tits, dŌĆÖune part, et lŌĆÖex├®cution des ordres de ses semblables, dŌĆÖautre part, il ne peut plus ├¬tre d├®termin├® que par lui-m├¬me. Il ne peut plus agir que par une impulsion n├®e de lui-m├¬me, et qui ne d├®pend plus de rien dŌĆÖext├®rieur ├Ā lui-m├¬me. Certes, cette impulsion est n├®e id├®ellement du monde unitaire des id├®es. Mais pour se r├®aliser en fait, cette impulsion doit passer par lŌĆÖhomme, et lŌĆÖhomme seul peut la transformer en une r├®alit├®. La raison de cette transformation dŌĆÖune id├®e en un acte r├®el, le monisme ne la peut trouver quŌĆÖau sein m├¬me de lŌĆÖhomme. Pour quŌĆÖune id├®e devienne action, il faut avant tout que lŌĆÖhomme le veuille. Ce vouloir-l├Ā nŌĆÖest absolument fond├® que sur lŌĆÖ├¬tre humain. LŌĆÖhomme est alors le seul d├®terminant de son action. Il est libre.
PREMI├łRE APPENDICE ├Ć LA NOUVELLE ├ēDITION (1918):
Dans la seconde partie de ce livre, nous avons essay├® dŌĆÖ├®tablir que la libert├® fait partie constitutive de la nature de lŌĆÖaction humaine. Pour cela, nous avons d├╗ isoler, de la totalit├® des actions humaines, celles qui, soumises ├Ā un examen sinc├©re, permettent de conclure ├Ā la r├®alit├® de la libert├®. Ces actions sont les r├®alisations dŌĆÖintuitions id├®elles. En ce qui concerne toutes les autres actions, lŌĆÖexamen sinc├©re ne saurait les d├®clarer libres. Mais lŌĆÖhomme qui sŌĆÖ├®tudie lui-m├¬me, sans parti-pris, trouve en lui une aptitude bien nette ├Ā progresser dans la conception des intuitions morales et dans leur r├®alisation. Certes, cet examen de la nature morale de lŌĆÖhomme ne constitue pas, ├Ā lui seul, une preuve de la libert├®. Car, si la pens├®e intuitive jaillissait dŌĆÖautre chose que dŌĆÖelle-m├¬me, si elle ne reposait pas enti├©rement sur sa propre existence, la conscience de notre libert├®, telle que nous la trouvons dans nos actions morales, ne serait quŌĆÖune image trompeuse. Mais la seconde partie de ce livre sŌĆÖappuie tout naturellement sur la premi├©re. Dans cette premi├©re partie, nous avons d├®crit la pens├®e intuitive comme lŌĆÖactivit├® spirituelle int├®rieure dont lŌĆÖhomme a conscience. Comprendre par exp├®rience cette nature intuitive de la pens├®e, cŌĆÖest en m├¬me temps reconna├«tre sa libert├®. Et lorsque lŌĆÖon sait que la pens├®e humaine est libre, il est facile de d├®terminer la sph├©re du vouloir ├Ā laquelle cette m├¬me libert├® sŌĆÖ├®tend. Celui qui accorde ├Ā la nature intuitive de la pens├®e un caract├©re absolu, parce quŌĆÖil a eu lŌĆÖexp├®rience int├®rieure de cet absolu, celui-l├Ā sait aussi que lŌĆÖhomme agit librement. Mais celui qui ne peut avoir cette exp├®rience int├®rieure cherchera bien en vain des preuves irr├®futables de la libert├®. Par lŌĆÖexp├®rience dont nous parlons ici, lŌĆÖhomme trouve la pens├®e intuitive dans sa conscience, mais la r├®alit├® de cette pens├®e intuitive nŌĆÖest pas limit├®e ├Ā la conscience. La libert├® est, au regard de lŌĆÖexp├®rience humaine, le signe distinctif des actions vraiment issues des intuitions de la pens├®e.
SECOND APPENDICE:
Les consid├®rations qui font lŌĆÖobjet de ce livre sont bas├®es sur lŌĆÖexp├®rience purement spirituelle que nous pouvons faire de la pens├®e intuitive ; par elle notre connaissance replace chaque perception dans lŌĆÖordre de la r├®alit├®. Nous nŌĆÖavions rien de plus ├Ā exposer dans ce livre, que les ├®claircissements d├╗s ├Ā lŌĆÖexp├®rience intuitive de la pens├®e. Mais nous avions ├®galement ├Ā signaler les cons├®quences philosophiques de cette exp├®rience ; la pens├®e qui sŌĆÖy manifeste r├®clame que sa nature absolue soit pleinement reconnue. Elle r├®clame quŌĆÖon ne lui m├®connaisse pas la possibilit├® de saisir, en union avec la perception, la pleine r├®alit├®, et quŌĆÖon cesse de chercher celle-ci dans un monde dŌĆÖau-del├Ā purement sp├®culatif, vis-├Ā-vis duquel lŌĆÖactivit├® pensante ne serait plus consid├®r├®e que comme un ├®l├®ment subjectif.
Nous avons donc d├®fini la pens├®e comme ├®tant lŌĆÖ├®l├®ment gr├óce auquel la vie spirituelle de lŌĆÖhomme p├®n├©tre au sein de la r├®alit├®. (Personne ne confondra cette conception, bas├®e sur la vie de la pens├®e, avec un simple rationalisme.) Mais, dŌĆÖautre part, il ressort clairement de tout lŌĆÖesprit qui anime cet ouvrage, que lŌĆÖ├®l├®ment ┬½perception┬╗ ne porte le signe distinctif de la r├®alit├®, quŌĆÖ├Ā partir du moment o├╣ la pens├®e sŌĆÖen empare. En dehors de la pens├®e, il nŌĆÖest point de crit├®rium de r├®alit├®.
Par cons├®quent, on nŌĆÖa pas le droit dŌĆÖimaginer, par exemple, que le mode sensible de la perception soit le seul garant de la v├®rit├®. LŌĆÖhomme, au cours de son existence, doit constamment attendre que telle ou telle perception se pr├®sente. Tout ce quŌĆÖon peut se demander, cŌĆÖest si le point de vue qui r├®sulte de la seule exp├®rience de la pens├®e intuitive permet ├Ā lŌĆÖhomme dŌĆÖattendre, en surplus de ses perceptions sensibles, dŌĆÖautres perceptions de nature spirituelle ? La r├®ponse ne peut ├¬tre quŌĆÖaffirmative. Car si la pens├®e intuitivement con├¦ue est, dŌĆÖune part, un ph├®nom├©ne actif se d├®roulant dans lŌĆÖesprit humain, elle est, dŌĆÖautre part, et en m├¬me temps, une perception spirituelle, re├¦ue sans organe sensoriel. CŌĆÖest une perception dans laquelle le sujet percepteur lui-m├¬me est actif, et cŌĆÖest une auto-activit├® qui, en m├¬me temps quŌĆÖelle se produit, est per├¦ue. Dans lŌĆÖacte intuitif, lŌĆÖhomme se trouve transport├® comme sujet percepteur dans un monde spirituel. Les perceptions qui lui viennent de ce monde spirituel, comme lui est venu le contenu spirituel de sa propre pens├®e, constituent, pour lŌĆÖhomme, le monde perceptible de lŌĆÖesprit. Ce monde perceptible de lŌĆÖesprit occupe vis-├Ā-vis de la pens├®e la m├¬me situation que le monde perceptible des sens. Ce monde perceptible de lŌĆÖesprit ne semble pas ├®tranger ├Ā lŌĆÖhomme qui y acc├©de, parce que celui-ci a connu d├®j├Ā, dans la pens├®e intuitive, une exp├®rience de caract├©re purement spirituel. Un grand nombre des ouvrages que jŌĆÖai publi├®s ├Ā la suite du pr├®sent livre traitent de ce monde perceptible de lŌĆÖesprit. Cette ┬½Philosophie de la libert├®┬╗ ├®tablit les bases philosophiques de mes ouvrages post├®rieurs. Car jŌĆÖy ai essay├® de montrer que lŌĆÖexp├®rience de la pens├®e, lorsqu'elle est correctement comprise, est d├®j├Ā une exp├®rience du monde spirituel. CŌĆÖest pourquoi il mŌĆÖappara├«t que quiconque admet s├®rieusement le point de vue expos├® dans cette "Philosophie de la libert├®" ne saurait avoir de repos quŌĆÖil nŌĆÖait acc├®d├® au monde perceptible de lŌĆÖesprit. Certes, on ne saurait tirer des consid├®rations de cet ouvrage, par des d├®ductions logiques, les r├®sultats expos├®s dans mes livres suivants. Mais la pens├®e intuitive dont il est question ici, lorsquŌĆÖon lŌĆÖa int├®rieurement comprise et v├®cue, m├©ne tout naturellement ├Ā progresser plus loin dans la connaissance vivante du monde perceptible de lŌĆÖesprit.
Premier suppl├®ment ├Ā la nouvelle ├®dition de 1918:
Les objections qui mŌĆÖont ├®t├® faites par certains philosophes, lors de la premi├©re publication de ce livre, mŌĆÖont incit├® ├Ā ajouter ├Ā cette nouvelle ├®dition le bref compl├®ment que voici. Je me rends bien compte que certains de mes lecteurs, pour lesquels tout le reste du livre aura eu de lŌĆÖint├®r├¬t, consid├®reront ce qui suit comme une sp├®culation abstraite, indiff├®rente et superflue. Ceux-l├Ā peuvent sŌĆÖ├®viter la lecture de ce passage. Mais dans la consid├®ration philosophique du monde, il surgit quelquefois des probl├©mes qui r├®sultent plut├┤t du parti-pris des penseurs que du cours normal de la pens├®e humaine elle-m├¬me. Tout le reste de cet ouvrage me para├«t concerner strictement la t├óche que tout homme se propose d├©s quŌĆÖil aspire ├Ā comprendre clairement lŌĆÖ├¬tre humain, et ses relations avec le monde. Ce qui va suivre, par contre, est plut├┤t un probl├©me dont certains philosophes exigent quŌĆÖon le traite lorsquŌĆÖon ├®tudie les questions qui font lŌĆÖobjet de ce livre, parce que ces philosophes se sont cr├®├®, par leur mentalit├® sp├®ciale, certaines difficult├®s qui nŌĆÖexistent pas pour lŌĆÖhomme ordinaire. LorsquŌĆÖon se permet de passer enti├©rement sous silence les probl├©mes de ce genre, certaines personnes sŌĆÖempressent de vous accuser de dilettantisme, etc.. Et lŌĆÖon reproche ├Ā lŌĆÖauteur de nŌĆÖavoir pas discut├® telle ou telle th├®orie, dont le livre ne mentionne pas lŌĆÖexistence.
Voici le probl├©me que jŌĆÖai en vue. Il y a des penseurs qui trouvent particuli├©rement difficile de comprendre comment la vie dŌĆÖune autre ├óme humaine peut agir sur la leur (celle de lŌĆÖobservateur). Ils disent : le monde dont je suis conscient est un monde inclus en moi ; le monde conscient dŌĆÖun autre homme lŌĆÖest ├®galement en lui. Je ne puis voir ce qui se passe dans la conscience dŌĆÖun autre homme. Comment arriv├®-je ├Ā conna├«tre que je vis dans le m├¬me monde que lui ? Voici comment cette difficult├® a ├®t├® tourn├®e par les philosophies qui admettent, au del├Ā du monde conscient, un autre monde inconscient ├Ā jamais. Elles disent : le monde que jŌĆÖai dans ma conscience est la repr├®sentation en moi, dŌĆÖun monde r├®el que ma conscience ne peut atteindre. CŌĆÖest en ce dernier que r├®sident les causes, inconnues de moi, de mon monde conscient. CŌĆÖest ├®galement en ce dernier que r├®side mon entit├® v├®ritable, et je nŌĆÖai dŌĆÖelle quŌĆÖun reflet dans ma conscience. Mais, toujours dans ce monde inconnaissable, se trouve lŌĆÖentit├® r├®elle de mon semblable. Or, ce qui se manifeste dans la conscience de cet autre homme a comme correspondance, dans son entit├®, une r├®alit├® ind├®pendante de la conscience. Cette r├®alit├® agit (dans ce domaine qui ne peut jamais devenir conscient) sur ma propre entit├® r├®elle inconsciente, et il se cr├®e ainsi dans ma conscience une repr├®sentation de ce qui se passe compl├©tement en dehors dŌĆÖelle. Ainsi, on ajoute au monde que ma conscience peut atteindre un second monde hypoth├®tique qui lui est inaccessible, parce que, sans cela, on se trouverait oblig├® dŌĆÖaffirmer que tout le monde ext├®rieur que je crois avoir devant moi nŌĆÖest que le monde de ma conscience, et que cela entra├«nerait la conclusion absurde de dire que mes semblables nŌĆÖexistent quŌĆÖ├Ā lŌĆÖint├®rieur de ma conscience.
Tel est le probl├©me qui sŌĆÖest pos├® au sein de certaines conceptions philosophiques, modernes, en ce qui regarde la th├®orie de la connaissance. On peut lŌĆÖ├®clairer lorsquŌĆÖon tend ├Ā se placer au point de vue qui a ├®t├® adopt├® dans ce livre : celui dŌĆÖune observation normale appliqu├®e aux lois de lŌĆÖesprit humain. QuŌĆÖai-je imm├®diatement devant moi lorsque je me trouve en face dŌĆÖune autre personne ? Tout dŌĆÖabord la perception qui mŌĆÖest donn├®e de lŌĆÖapparence corporelle de cette personne ; puis la perception auditive, par exemple, de ce que dit cette personne, etc.. Tout cela, je ne le per├¦ois pas passivement ; tout cela suscite mon activit├® pensante. D├©s lŌĆÖinstant o├╣ je me place, vis-├Ā-vis de cette autre personne, dans lŌĆÖattitude pensante, la perception que jŌĆÖai dŌĆÖelle mŌĆÖappara├«t, pour ainsi dire, avec une transparence psychique. Je me vois oblig├® de conc├®der que cette perception, dont ma pens├®e se saisit, nŌĆÖest pas du tout ce quŌĆÖelle paraissait ├¬tre ├Ā mes sens ext├®rieurs. LŌĆÖapparence sensible de la personne r├®v├©le, parmi les ├®l├®ments qui la composent imm├®diatement, un autre ├¬tre, quŌĆÖelle nŌĆÖest que m├®diatement. Du fait quŌĆÖelle se pr├®sente ├Ā ma pens├®e, la personne ├®teint, pour ainsi dire, son apparence purement sensible. Mais ce quŌĆÖelle r├®v├©le ├Ā la place agit sur mon ├¬tre pensant et le contraint ├Ā sŌĆÖoublier lui-m├¬me pendant le temps que dure cette action, pour faire place ├Ā la pens├®e de lŌĆÖautre personne. Je mŌĆÖempare de cette pens├®e qui appartient ├Ā lŌĆÖautre personne, je la saisis dans ma pens├®e ├Ā moi, et jŌĆÖen fais une exp├®rience qui mŌĆÖest propre. JŌĆÖai r├®ellement per├¦u la pens├®e de mon semblable. Donc la perception sensible imm├®diate, qui sŌĆÖ├®teint dans ce contact, est saisie par ma pens├®e, et il se produit un ph├®nom├©ne qui se d├®roule enti├©rement dans ma conscience, et qui consiste en ce que lŌĆÖautre pens├®e sŌĆÖinstalle ├Ā la place de la mienne. Par lŌĆÖ├®vanouissement de lŌĆÖapparence sensible, la s├®paration cesse r├®ellement entre les deux sph├©res conscientes. Ceci se manifeste dans ma conscience par le fait quŌĆÖau moment o├╣ je per├¦ois ainsi la pens├®e dŌĆÖune autre personne, ma propre vie consciente mŌĆÖ├®chappe comme dans un profond sommeil. De m├¬me que ma conscience diurne est enti├©rement ├®limin├®e dans lŌĆÖ├®tat de sommeil, de m├¬me ma propre conscience dispara├«t dans lŌĆÖacte de percevoir une conscience ├®trang├©re. Si cet ├®tat de fait passe inaper├¦u, cŌĆÖest que : 1┬░ lors de cet ├®vanouissement de notre conscience, nous ne tombons pas dans lŌĆÖinconscience totale qui caract├®riserait le sommeil profond, mais le contenu conscient de lŌĆÖautre personne sŌĆÖ├®claire en nous ; 2┬░ lŌĆÖ├®vanouissement et la r├®apparition de la conscience que jŌĆÖai de moi-m├¬me alternent si vite quŌĆÖon ne peut g├®n├®ralement les remarquer. Le probl├©me dont il sŌĆÖagit ici ne saurait ├¬tre r├®solu par des constructions artificielles de concepts, o├╣ lŌĆÖon conclut de ce qui est conscient, ├Ā ce qui jamais ne peut lŌĆÖ├¬tre, mais il sŌĆÖ├®claire gr├óce ├Ā la v├®ritable exp├®rience de ce qui se produit lorsque pens├®e et perception entrent en contact. Il en va de m├¬me pour un grand nombre des questions qui se pr├®sentent dans la litt├®rature philosophique. Les penseurs devraient chercher la voie de lŌĆÖobservation int├®rieure normale et impartiale, au lieu de masquer la r├®alit├® derri├©re lŌĆÖ├®difice artificiel de leurs th├®ories.
Dans un essai dŌĆÖ├ēd. von Hartman, "Les questions derni├©res de la th├®orie de la connaissance et de la m├®taphysique" [nota: paru dans le "Zeitschrift f├╝r Philosophie und philosophische Kritik", volume 108, page 55 et suivantes], ma "Philosophie de la Libert├®" est rang├®e au nombre des courants philosophiques qui tendent ├Ā baser la th├®orie de connaissance sur un point de vue moniste. Ce point de vue para├«t inadmissible ├Ā ├ēd. von Hartmann, et voici pour quelles raisons. Selon les convictions quŌĆÖil exprime dans lŌĆÖessai ci-dessus nomm├®, il nŌĆÖy a, en ce qui concerne la th├®orie de la connaissance, que trois diff├®rentes possibilit├®s. La premi├©re est dŌĆÖen demeurer au point de vue du r├®alisme primitif, qui prend les apparences per├¦ues pour des objets r├®els existant hors de la conscience humaine. CŌĆÖest, alors, quŌĆÖon manque de r├®flexion critique. On ne sŌĆÖaper├¦oit pas que tout le contenu de la conscience est forc├®ment ├Ā lŌĆÖint├®rieur de la conscience. On ne comprend pas quŌĆÖon a devant les yeux non pas une ┬½table en soi┬╗, mais un objet de sa propre conscience. Que lŌĆÖon en reste ├Ā ce point de vue, ou quŌĆÖon y revienne par tel ou tel d├®tour, on est un r├®aliste primitif. Or, ce point de vue est inadmissible. SŌĆÖy placer, cŌĆÖest m├®conna├«tre que la conscience ne peut jamais contenir que ses propres objets. La seconde possibilit├®, cŌĆÖest de se rendre parfaitement compte de lŌĆÖ├®tat des choses. On devient alors tout dŌĆÖabord un id├®aliste transcendantal. Mais il faut nier alors r├®solument que le moindre ├®l├®ment de la chose ┬½en soi┬╗ puisse jamais p├®n├®trer dans la conscience humaine. Et lŌĆÖon nŌĆÖ├®chappe point, sur cette voie, ├Ā lŌĆÖillusionnisme absolu, pourvu que lŌĆÖon soit assez cons├®quent avec soi-m├¬me pour pousser son raisonnement jusque-l├Ā. Car le monde, en face duquel le penseur se trouve, se transforme alors en une simple somme dŌĆÖobjets de conscience, ├Ā savoir dŌĆÖobjets de la propre conscience du penseur. Celui-ci est alors contraint dŌĆÖadmettre une absurdit├®, ├Ā savoir que tous les autres hommes nŌĆÖexistent que dans sa propre conscience. Une troisi├©me possibilit├®, cŌĆÖest le r├®alisme transcendantal. Celui-ci admet quŌĆÖil existe des ┬½choses en soi┬╗, mais que notre conscience ne peut, en aucun cas, en avoir lŌĆÖexp├®rience directe. Elles agissent au del├Ā de la conscience humaine et, par des modalit├®s qui ne tombent pas dans le champ de la conscience, elles op├©rent lŌĆÖapparition en celle-ci des objets de conscience. On ne peut conna├«tre ces ┬½choses en soi┬╗ que par induction, en partant des exp├®riences qui ont lieu dans la conscience, et qui ne sont que des exp├®riences repr├®sentatives. ├ēd. von Hartmann, toujours dans le m├¬me essai, ├®met lŌĆÖopinion quŌĆÖune th├®orie moniste de la connaissance, puisquŌĆÖil comprend ma conception sous ce terme, doit forc├®ment se rallier ├Ā une des trois possibilit├®s quŌĆÖil ├®nonce, et que si cette th├®orie moniste ne le fait pas, cŌĆÖest quŌĆÖelle ne va pas jusquŌĆÖau bout de ses propres cons├®quences. Il ├®crit ensuite, toujours dans le m├¬me essai : ┬½LorsquŌĆÖon veut savoir ├Ā quel point de vue appartient r├®ellement, quant ├Ā la th├®orie de la connaissance, un des dits ┬½monistes┬╗, il suffit de lui poser quelques questions et de lŌĆÖobliger ├Ā y r├®pondre. Car, de lui-m├¬me, ce moniste ├®vitera toujours de traiter ces questions, et il cherchera toujours ├Ā ├®chapper ├Ā lŌĆÖobligation dŌĆÖy r├®pondre, parce que chacune de ses r├®ponses d├®c├©lera, sous la pr├®tention au monisme, lŌĆÖexistence dŌĆÖun des trois points de vue susdits. Voici ces questions :
1┬░ Les objets sont-ils, quant ├Ā leur consistance, continus ou intermittents ? Si le moniste r├®pond quŌĆÖils sont continus, on a affaire ├Ā une forme quelconque du r├®alisme primitif. SŌĆÖil r├®pond quŌĆÖils sont intermittents, cŌĆÖest de lŌĆÖid├®alisme transcendantal. Si enfin le moniste r├®pond ce qui suit : les objets sont dŌĆÖune part continus (comme contenus de la conscience absolue, ou comme repr├®sentations inconscientes, ou comme possibilit├®s de perception), et dŌĆÖautre part intermittents (comme contenus de la conscience limit├®e), - alors le r├®alisme transcendantal est apparent.
2┬░ Lorsque trois personnes sont assises ├Ā une table, combien y a-t-il dŌĆÖexemplaires de la table ? Celui qui r├®pond : un, est r├®aliste primitif. Celui qui r├®pond : trois, est id├®aliste transcendantal. Enfin celui qui r├®pond : quatre, est le r├®aliste transcendantal. Il est sous-entendu que lŌĆÖon se donne alors licence de comprendre sous le terme g├®n├®ral dŌĆÖ┬½exemplaires de la table┬╗ les choses aussi radicalement diff├®rentes que sont la ┬½chose en soi┬╗ de la table et les trois tables-perceptions des trois consciences humaines. Si cette licence paraissait abusive, on pourrait dire, au lieu de quatre, trois et un.
3┬░ Lorsque deux personnes sont r├®unies dans une pi├©ce, combien y a-t-il dŌĆÖexemplaires de ces personnes ? Celui qui r├®pond : deux, est r├®aliste primitif. Celui qui r├®pond : quatre (├Ā savoir, dans chaque conscience, un moi et une autre personne), est id├®aliste transcendantal. Celui enfin qui r├®pond : six (deux personnes ┬½en soi┬╗ et deux repr├®sentations de personnes dans chacune des deux consciences) est r├®aliste transcendantal. Si la th├®orie moniste de la connaissance veut prouver quŌĆÖelle sŌĆÖ├®carte de ces trois points de vue, il faut quŌĆÖelle donne ├Ā chacune de ces questions une autre r├®ponse que les susdites. Et je me demande quelles pourraient bien ├¬tre ces autres r├®ponses.┬╗
Or, voici les r├®ponses que la Philosophie de la Libert├® fait ├Ā ces trois questions :
1┬░ Celui qui ne saisit que le contenu perceptible des choses, et le tient pour une r├®alit├®, est un r├®aliste primitif ; il ne se rend pas compte quŌĆÖil nŌĆÖa le droit de croire ├Ā lŌĆÖexistence de ces contenus perceptibles quŌĆÖaussi longtemps quŌĆÖil dirige son attention sur les objets et que, par cons├®quent, il devrait consid├®rer comme intermittent ce quŌĆÖil a devant lui. Mais d├©s quŌĆÖil se rend compte quŌĆÖil nŌĆÖy a de r├®alit├® que dans le contenu perceptible p├®n├®tr├® et ordonn├® par la pens├®e, il comprend aussi que si ce contenu perceptible tel quŌĆÖil se pr├®sente ├Ā lui seul, est intermittent, il se r├®v├©le comme une continuit├® lorsquŌĆÖil a ├®t├® ├®labor├® par la pens├®e. Nous estimons donc que le contenu des perceptions, une fois que la pens├®e vivante sŌĆÖen est empar├®e, est continu ; tandis quŌĆÖil serait intermittent sŌĆÖil ├®tait r├®el dans son ├®tat de simple perception, ce qui nŌĆÖest pas le cas.
2┬░ Lorsque trois personnes sont assises ├Ā une table, combien y a-t-il dŌĆÖexemplaires de la table ? Il nŌĆÖy a quŌĆÖune table ; mais tant que les trois personnes veulent en demeurer ├Ā leurs images de perception, il leur faut dire : ces images de perception ne constituent pas une r├®alit├®. LorsquŌĆÖelles passent, par contre, ├Ā la table dont sŌĆÖest empar├® leur pens├®e, elles voient se manifester la r├®alit├® unique de la table ; leurs trois contenus de conscience sŌĆÖunissent dans cette r├®alit├® unique.
3┬░ Lorsque deux personnes se trouvent ensemble dans une pi├©ce, combien y a-t-il dŌĆÖexemplaires de ces personnes ? Certainement pas six - m├¬me au sens o├╣ lŌĆÖentend le r├®alisme transcendantal - mais seulement deux. Seulement, chaque personne a tout dŌĆÖabord, aussi bien dŌĆÖelle-m├¬me que de lŌĆÖautre personne, une image de perception, qui, ├Ā elle seule, ne constitue pas la r├®alit├®. Ces images de perception sont quatre. Leur pr├®sence clans la pens├®e des deux personnes constitue la pr├®hension de la r├®alit├®. Par lŌĆÖactivit├® pensante, chacune des deux personnes saisit plus que sa propre sph├©re consciente, celle de lŌĆÖautre personne sŌĆÖ├®claire ├®galement en elle. ├Ć lŌĆÖinstant de cet ├®veil, les personnes ne sont pas davantage enferm├®es dans leur propre conscience quŌĆÖ├Ā lŌĆÖ├®tat de sommeil. Seulement, ├Ā lŌĆÖinstant imm├®diatement suivant, la conscience de cet ├®veil dans lŌĆÖautre personne est remplac├®e par le retour ├Ā sa propre conscience. De telle sorte que lŌĆÖexp├®rience pensante de chacune dŌĆÖelles sŌĆÖempare : et de sa propre conscience, et de celle de lŌĆÖautre. Je sais que le r├®aliste transcendantal verra en ceci un retour au r├®alisme primitif. Mais jŌĆÖai d├®j├Ā signal├® dans cet ouvrage que le r├®alisme primitif est enti├©rement l├®gitime en ce qui concerne notre exp├®rience int├®rieure de la pens├®e. Le r├®alisme transcendantal ne se pr├®occupe pas de la v├®ritable mani├©re dont sŌĆÖeffectue lŌĆÖacte de connaissance. Il sŌĆÖen d├®tourne pour sŌĆÖengager dans un ├®cheveau de th├®ories, dans lequel il sŌĆÖentrem├¬le et se perd. Il nŌĆÖa aucun droit, dŌĆÖailleurs, de nommer le monisme qui est expos├® dans cette Philosophie de la Libert├® une ┬½th├®orie moniste de la connaissance┬╗, mais, plut├┤t, sŌĆÖil veut absolument un qualificatif, un ┬½monisme de la pens├®e┬╗. ├ēdouard von Hartmann a m├®connu tout cela. Il nŌĆÖa pas entrevu la modalit├® sp├®ciale des conceptions propres ├Ā cette Philosophie de la Libert├®, mais il a pr├®tendu que jŌĆÖy ai essay├® dŌĆÖunir le panlogisme universaliste de Hegel avec le ph├®nom├®nalisme individualiste de Hume [voir: "Zeitschrift f├╝r Philosophie", volume 108 page 71, remarque]. En r├®alit├®, cette "Philosophie de la Libert├®" nŌĆÖa rien ├Ā faire avec ces deux points de vue, quŌĆÖelle aurait, soi-disant, voulu r├®unir ; cŌĆÖest pour cette raison que je nŌĆÖai aucunement ├®t├® tent├® de mŌĆÖexpliquer sur les vues de la ┬½th├®orie moniste de la connaissance┬╗ de Johann Rehmke. Car les conceptions de la Philosophie de la Libert├® sont tout autre chose que ce que Hartmann et dŌĆÖautres nomment ┬½th├®orie moniste de la connaissance┬╗.
Second supplément:
Ce qui va suivre nŌĆÖest, en somme, que la r├®p├®tition de ce que contenait ma ┬½pr├®face┬╗ ├Ā la premi├©re ├®dition de ce livre. Comme ce sont des consid├®rations relatives ├Ā la disposition dŌĆÖid├®es qui ├®tait mienne il y a vingt-cinq ans, lors de la parution de ce livre, et quŌĆÖelles ne se rapportent pas directement au contenu de lŌĆÖouvrage, je ne les place que comme ┬½suppl├®ment┬╗ ├Ā la fin de cette nouvelle ├®dition. Je ne voudrais pas les supprimer compl├©tement, parce quŌĆÖil se produit toujours ├Ā nouveau que lŌĆÖon me soup├¦onne de renier quelque chose de mes anciens ├®crits ├Ā cause des mes nouveaux ouvrages de science spirituelle.
LŌĆÖhomme, ├Ā notre ├®poque, ne peut plus tendre quŌĆÖ├Ā puiser la v├®rit├® dans les profondeurs m├¬mes de lŌĆÖ├¬tre humain [nota: on nŌĆÖa supprim├® ici que les phrases pr├®liminaires (de la premi├©re ├®dition) de ces consid├®rations, qui me paraissent aujourdŌĆÖhui tout ├Ā fait inutiles. Ce qui suit, au contraire, me semble n├®cessaire ├Ā dire, malgr├® la mentalit├® scientifique moderne, peut-├¬tre en raison m├¬me de cette mentalit├®]. Des deux voies dont parle Schiller : ┬½Tous deux nous cherchons la v├®rit├® ; toi au dehors, dans la vie, moi au dedans, dans le coeur, et tous deux nous la trouverons s├╗rement. LŌĆÖoeil, sŌĆÖil est sain, rencontre au dehors le Cr├®ateur ; le coeur, sŌĆÖil est sain, refl├©te s├╗rement en lui lŌĆÖunivers┬╗, - notre ├®poque ne peut certainement que pr├®f├®rer la seconde. Une v├®rit├® qui nous arrive du dehors nous para├«t toujours empreinte dŌĆÖincertitude. Nous nŌĆÖaimons ├Ā croire quŌĆÖaux v├®rit├®s qui se d├®couvrent au fond de chacun de nous.
La v├®rit├® seule nous permet de d├®velopper avec s├╗ret├® nos forces individuelles. Celui qui est rong├® de doutes voit se paralyser ses forces. Il ne trouve, en un univers qui lui demeure ├®nigmatique, aucun but valable ├Ā proposer ├Ā ses actions.
Nous ne voulons plus simplement croire, nous voulons savoir. La foi exige que nous admettions des v├®rit├®s que nous ne connaissons pas enti├©rement. Or, ce que nous ne connaissons pas enti├©rement est ennemi de notre ├¬tre individuel, qui veut tout exp├®rimenter au plus profond de lui-m├¬me. Seul, le savoir nous satisfait, parce quŌĆÖil ne se soumet point ├Ā des normes ext├®rieures, mais jaillit de la vie int├®rieure de la personnalit├®.
Nous ne voulons pas non plus de ce savoir glacial qui a ├®t├® fix├® une fois pour toutes dans des formules dŌĆÖ├®cole, et conserv├® dans des codes que lŌĆÖon a d├®clar├®s valables pour tous les temps ├Ā venir. Chacun de nous se trouve autoris├® ├Ā prendre comme point de d├®part ses exp├®riences les plus directes, ses intuitions imm├®diates, et ├Ā sŌĆÖ├®lever, de l├Ā, ├Ā la connaissance de tout lŌĆÖunivers. Nous aspirons ├Ā un savoir certain, mais que chacun de nous obtiendrait par le mode qui lui est propre.
Il ne faut plus que nos doctrines scientifiques affectent une telle apparence que lŌĆÖon semble contraint ├Ā les accepter. Aucun de nous ne voudrait plus intituler un ├®crit philosophique comme le fit un jour Fichte ┬½Rapport lumineusement clair, fait au grand public, sur la nature v├®ritable de la philosophie nouvelle. Une tentative pour obliger le lecteur ├Ā comprendre┬╗.
De nos jours, personne ne peut plus ├¬tre oblig├® ├Ā comprendre. Nous ne r├®clamons ni approbation, ni adh├®rence ├Ā nos opinions de ceux qui nŌĆÖont pas le besoin sp├®cial et individuel de ces opinions. Nous ne voulons m├¬me plus, de nos jours, entonner des connaissances ├Ā lŌĆÖhomme en voie de d├®veloppement, ├Ā lŌĆÖenfant, mais nous cherchons ├Ā favoriser lŌĆÖ├®volution de ses facult├®s, afin quŌĆÖil nŌĆÖait plus besoin dŌĆÖ├¬tre oblig├® ├Ā comprendre, mais que de lui-m├¬me il veuille comprendre.
Je ne me fais dŌĆÖailleurs pas dŌĆÖillusions sur cette caract├®ristique de mon ├®poque. Je sais combien s├®vit et combien se r├®pand la mentalit├® de lŌĆÖesp├©ce, priv├®e de toute individualit├®. Mais je sais aussi que beaucoup de mes contemporains cherchent ├Ā orienter leur vie dans le sens qui est indiqu├® ici. CŌĆÖest ├Ā eux que je voudrais d├®dier cet ouvrage. Il ne pr├®tend pas montrer ┬½le seul chemin┬╗ de la v├®rit├®, mais il veut d├®crire le chemin dans lequel sŌĆÖest engag├® un homme qui aspirait ├Ā la v├®rit├®.
Cet ouvrage m├©ne tout dŌĆÖabord le lecteur dans des domaines assez abstraits, o├╣ la pens├®e doit suivre des lignes pr├®cises, si elle veut gagner des points fermes. Mais ces concepts arides ram├©nent ensuite le lecteur ├Ā la vie concr├©te. Car je suis dŌĆÖavis que lŌĆÖon doit, pour conna├«tre lŌĆÖexistence sous toutes ses faces, sŌĆÖ├®lever aussi dans le royaume ├®th├®r├® des concepts. LŌĆÖhomme qui ne veut jouir que par les sens ignore les plaisirs les plus d├®licats de la vie. Les sages de lŌĆÖOrient obligent leurs disciples ├Ā vivre des ann├®es de renoncement et dŌĆÖasc├®tisme avant de recevoir la science quŌĆÖils ont ├Ā leur communiquer. LŌĆÖOccident nŌĆÖexige, pour conf├®rer sa science, ni exercices de pi├®t├®, ni asc├®tisme. Mais, en revanche, il r├®clame quŌĆÖon ait la bonne volont├® de se retirer ├Ā certains instants loin des impressions imm├®diates de la vie, et de sŌĆÖadonner au monde de la pure pens├®e.
La vie comprend un grand nombre de domaines. En chacun dŌĆÖeux, une science sp├®ciale se d├®veloppe. Mais la vie elle-m├¬me est une unit├®, et plus chaque science sŌĆÖefforce dŌĆÖapprofondir son domaine sp├®cial, plus elle perd la vue g├®n├®rale de lŌĆÖunivers vivant. Il faut quŌĆÖil y ait une science qui puise, en chaque science sp├®ciale, les ├®l├®ments propres ├Ā conduire lŌĆÖ├¬tre humain vers la pl├®nitude de la vie. Les savants sp├®cialis├®s tendent ├Ā acqu├®rir la connaissance du monde et de ses ph├®nom├©nes. Mais le but de cet ouvrage-ci est un but philosophique : la science elle-m├¬me doit y devenir un tout organique et vivant. Les sciences sp├®ciales sont des phases pr├®paratoires de la science vers laquelle on tend ici. Il se passe, dans les arts, un fait semblable : le compositeur travaille sur les bases de la science musicale. Celle-ci est une somme de connaissances, dont la possession est une pr├®paration indispensable ├Ā lŌĆÖart de composer. Mais, dans lŌĆÖart de composer, les lois de la science musicale sont mises au service de la vie, de la r├®alit├® la plus essentielle. CŌĆÖest exactement dans ce sens que la philosophie est un art. Tous les philosophes v├®ritables ont ├®t├® des artistes du concept. Les id├®es humaines leur ├®taient une mati├©re ├Ā art, et les m├®thodes scientifiques leur ├®taient une technique artistique. CŌĆÖest par l├Ā que la pens├®e abstraite acquiert une vie concr├©te et individuelle. Les id├®es deviennent des forces de vie. On ne se borne plus alors ├Ā savoir certaines choses. Le savoir devient un organisme r├®el qui se gouverne de lui-m├¬me ; notre conscience v├®ritable, active, sŌĆÖest ├®lev├®e au-dessus de la simple r├®ception passive des v├®rit├®s.
Les questions fondamentales qui se posent en mon ouvrage sont celles de savoir comment la philosophie, en tant quŌĆÖart, se comporte vis-├Ā-vis de la libert├® de lŌĆÖhomme, ce quŌĆÖest cette libert├®, et si nous y prenons part ou si nous pouvons y devenir participants. Les autres d├®veloppements philosophiques ne se trouvent en ce livre que parce quŌĆÖils finissent par jeter plus de lumi├©re sur ces questions qui, ├Ā mon avis, int├®ressent le plus directement le destin de lŌĆÖ├óme humaine. Cet ouvrage pr├®tend donc apporter une ┬½Philosophie de la Libert├®┬╗.
Toute la science ne serait que la satisfaction dŌĆÖune curiosit├® oisive si elle ne tendait pas ├Ā ├®lever les valeurs vitales de la personnalit├® humaine.
Une science nŌĆÖacquiert un v├®ritable prix que lorsquŌĆÖelle peut montrer la signification humaine de ses r├®sultats. Le but de lŌĆÖindividu ne saurait ├¬tre dŌĆÖennoblir une seule de ses facult├®s int├®rieures, mais dŌĆÖ├®panouir toutes les facult├®s qui sommeillent en lui. Le savoir nŌĆÖa de prix que parce quŌĆÖil collabore ├Ā lŌĆÖ├®panouissement complet de toute la nature humaine.
CŌĆÖest pourquoi nous ne concevons pas les rapports entre la science et la vie de telle sorte que lŌĆÖhomme ait ├Ā sŌĆÖincliner devant lŌĆÖid├®e et ├Ā mettre ses forces ├Ā son service ; mais, au contraire, ├Ā sŌĆÖemparer du monde des id├®es pour lŌĆÖutiliser dans le sens de ses intentions humaines, qui d├®passent les fins purement scientifiques.
Il faut absolument vivre int├®rieurement les id├®es, sans quoi, lŌĆÖon devient leur esclave.
┬® BnF (domaine public libre non commercial)